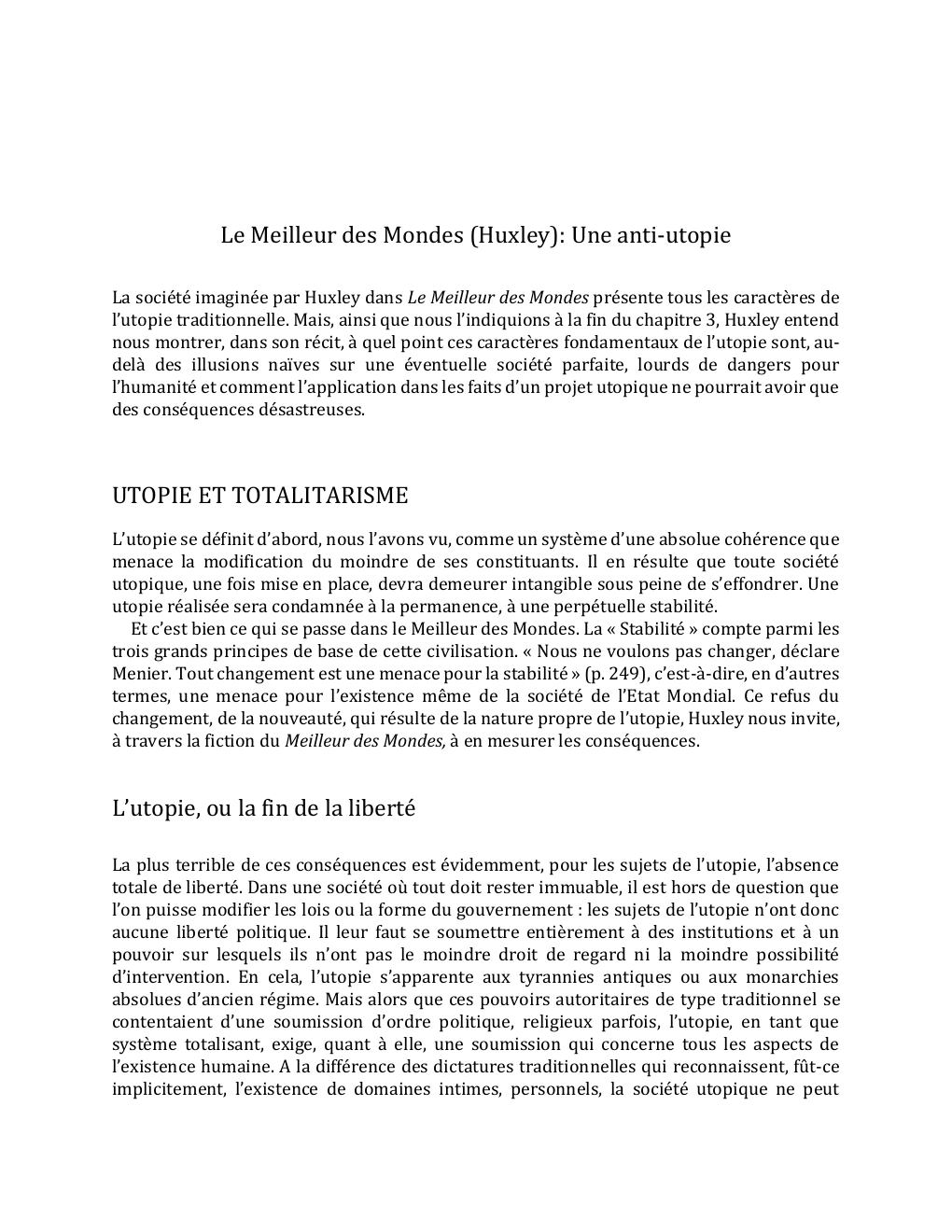Le Meilleur des Mondes (Huxley): Une anti-utopie La société imaginée par Huxley dans Le Meilleur des Mondes présente tous les...
Extrait du document
«
Le Meilleur des Mondes (Huxley): Une anti-utopie
La société imaginée par Huxley dans Le Meilleur des Mondes présente tous les caractères de
l’utopie traditionnelle.
Mais, ainsi que nous l’indiquions à la fin du chapitre 3, Huxley entend
nous montrer, dans son récit, à quel point ces caractères fondamentaux de l’utopie sont, audelà des illusions naïves sur une éventuelle société parfaite, lourds de dangers pour
l’humanité et comment l’application dans les faits d’un projet utopique ne pourrait avoir que
des conséquences désastreuses.
UTOPIE ET TOTALITARISME
L’utopie se définit d’abord, nous l’avons vu, comme un système d’une absolue cohérence que
menace la modification du moindre de ses constituants.
Il en résulte que toute société
utopique, une fois mise en place, devra demeurer intangible sous peine de s’effondrer.
Une
utopie réalisée sera condamnée à la permanence, à une perpétuelle stabilité.
Et c’est bien ce qui se passe dans le Meilleur des Mondes.
La « Stabilité » compte parmi les
trois grands principes de base de cette civilisation.
« Nous ne voulons pas changer, déclare
Menier.
Tout changement est une menace pour la stabilité » (p.
249), c’est-à-dire, en d’autres
termes, une menace pour l’existence même de la société de l’Etat Mondial.
Ce refus du
changement, de la nouveauté, qui résulte de la nature propre de l’utopie, Huxley nous invite,
à travers la fiction du Meilleur des Mondes, à en mesurer les conséquences.
L’utopie, ou la fin de la liberté
La plus terrible de ces conséquences est évidemment, pour les sujets de l’utopie, l’absence
totale de liberté.
Dans une société où tout doit rester immuable, il est hors de question que
l’on puisse modifier les lois ou la forme du gouvernement : les sujets de l’utopie n’ont donc
aucune liberté politique.
Il leur faut se soumettre entièrement à des institutions et à un
pouvoir sur lesquels ils n’ont pas le moindre droit de regard ni la moindre possibilité
d’intervention.
En cela, l’utopie s’apparente aux tyrannies antiques ou aux monarchies
absolues d’ancien régime.
Mais alors que ces pouvoirs autoritaires de type traditionnel se
contentaient d’une soumission d’ordre politique, religieux parfois, l’utopie, en tant que
système totalisant, exige, quant à elle, une soumission qui concerne tous les aspects de
l’existence humaine.
A la différence des dictatures traditionnelles qui reconnaissent, fût-ce
implicitement, l’existence de domaines intimes, personnels, la société utopique ne peut
admettre de terrains neutres ou privés.
Pour elle, tout est politique, tout s’inscrit dans la
collectivité.
Ainsi, pour prendre un exemple en apparence des plus anodins, il semble de prime abord
évident que le fait de ne pas aimer tel ou tel sport relève du seul goût personnel et que nul
ne devrait se sentir contraint de s’adonner au tennis, au « Golf-Obstacles » ou au « Golf
Electro-Magnétique ».
Mais quand la pratique généralisée de ces sports constitue, ce qui est
le cas dans le Meilleur des Mondes, un moyen, pour le gouvernement, d’encadrer la
population en même temps que le débouché, au sein d’une économie planifiée, d’un nombre
important de produits, ce qui apparaissait au départ comme une question de goût individuel
se transforme en affaire publique.
Et le désintérêt pour les sports en question devient une
faute contre la société.
Lorsque Bernard Marx refuse les activités sportives instituées par
l’État Mondial et leur préfère les « promenades dans la Région des Lacs5 » (p.
109), il commet
une « faute » de ce genre : il donne un « mauvais exemple » qui risquerait, s’il était suivi,
d’affecter tout un pan de l’édifice social, voire, par contagion, l’édifice social en son entier.
En
utopie, rien n’est anodin.
Les membres de la société utopique doivent donc se plier aux règles de comportement que
celle-ci a promulguées et qui régissent jusqu’aux plus infimes détails de la vie humaine : ils
sont de la sorte privés non seulement de droits civiques mais encore de toute liberté d’action
et d’initiative.
Car, comme le souligne Menier à maintes reprises, dans le Meilleur des
Mondes, « tout l’ordre social serait bouleversé si les hommes se mettaient à faire les choses
de leur propre initiative » (p.
261).
Pour la société utopique, intégralement organisée,
l’homme qui agit en dehors ou, pire, à l’encontre de ce qui a été prévu, l’homme qui, fût-ce
avec les meilleures intentions de la terre, prend des initiatives personnelles, est
nécessairement un élément déstabilisateur, un criminel.
Le D.I.C.
se montre on ne peut plus
clair à ce propos : « Il n’est pas de crime aussi odieux que le manque d’orthodoxie dans la
conduite.
[...] Le manque d’orthoxie menace bien autre chose que la vie d’un simple individu
: il frappe la Société même » (p.
170).
L’utopie, ou la mort de la pensée
Faut-il préciser que, dans une société qui refuse la liberté politique et criminalise la liberté
de comportement, la liberté de pensée n’a pas non plus sa place ?
On ne peut demander à des gens une docilité absolue aux règles d’un système que si l’on
requiert d’eux, en même temps, une adhésion sans réserve aux doctrines, aux conceptions
philosophiques et politiques qui justifient ledit système.
L’utopie ne connaît donc qu’une
seule forme de pensée, qu’une seule vérité, unique, officielle : la sienne.
Dans le Meilleur des
Mondes, qui représente une utopie reposant sur des bases exclusivement économiques et
matérialistes, toutes les notions, attitudes ou philosophies d’inspiration idéaliste
(préoccupations spirituelles, religion, art, sentiments désintéressés...) sont bannies.
Une
utopie fondée sur des principes religieux ou des valeurs morales prononcerait sans doute
des exclusives tout à fait opposées.
Mais ce qui ressort, dans les deux cas, est que la société
utopique se caractérise par la présence d’une idéologie qui exclut tout ce qui entre en
contradiction avec elle.
Les effets d’un tel dogmatisme intellectuel sont absolument catastrophiques, on l’aura
compris, dans le domaine des savoirs, des idées, de la culture.
L’utopie, qui refuse l’évolution,
se condamne au rejet de la pensée vivante, au ressassement infini d’un fonds culturel jamais
renouvelé, à la stérilité, à la stagnation créatrice.
Elle ne saurait avoir d’art authentique
puisque ce dernier est par essence créateur, c’est-à-dire producteur de formes inédites et
d’idées nouvelles.
Ce n’est donc pas seulement en raison de son caractère matérialiste que le
Meilleur des Mondes prohibe ce que Mustapha Menier lui-même appelle le « grand art » (p.
244) : c’est la structure même de l’utopie qui ne peut s’accommoder de la pratique artistique
— laquelle, par définition, est mouvante, évolutive, imprévisible.
Et il semble légitime de
penser que même une utopie reposant sur des principes opposés à ceux du Meilleur des
Mondes connaîtrait une comparable pauvreté artistique.
D’ailleurs, il est frappant de constater que l’univers hautement scientifique de l’Etat
Mondial, où la foi dans les pouvoirs de la science a valeur de dogme, interdit en fait toute
recherche véritable.
C’est que la « science pure » se moque des idéologies et serait bien
capable d’effectuer des découvertes dont les implications pourraient contredire les dogmes
de l’utopie et dont les applications pourraient bouleverser son système social.
Aussi, Menier
précise-t-il très clairement au chapitre 16 : « La science est un danger public.
Elle est aussi
dangereuse qu’elle a été bienfaisante.
Elle nous a donné l’équilibre le plus stable que
l’histoire ait enregistré.
[...] Mais nous ne pouvons pas permettre à la science de défaire le
bon travail qu’elle a accompli » (p.
252).
Il convient donc, pour les Administrateurs, de
proscrire toute vraie science afin d’éviter que n’aient lieu d’intempestives découvertes,
susceptibles de troubler l’ordre utopique.
C’est clair : si l’utopie ne peut s’accorder avec la liberté, elle ne fait pas meilleur ménage
avec la vérité, avec l’amour du savoir, la recherche de la vérité.
Elle rejette ainsi deux des plus
importantes parmi les valeurs qu’a forgées l’histoire de l’humanité – les deux plus
importantes peut-être.
LA MYSTIFICATION UTOPIQUE
Il est vrai que, si l’on se place dans la logique de l’utopie, le sacrifice de la liberté ou celui de
la vérité sont sans conséquence puisque la société utopique est censée représenter la forme
parfaite d’organisation sociale.
Si une telle société n’accorde aucune place à ces valeurs, il
faudrait donc en conclure que celles-ci n’en méritent pas davantage, qu’elles ne sont pas des
valeurs authentiques.
On mesure ici la gravité et les implications de ce qui constitue, avant même son aspect
systématique, le caractère fondamental de l’utopie, c’est-à-dire, rappelons-le, sa prétention
à constituer un modèle idéal de société.
Car l’assimilation de l’utopie à une sorte de Paradis Terrestre autorise évidemment, a
priori, l’emploi de tous les moyens pour l’instaurer puis pour la maintenir.
En se proclamant
société parfaite, l’utopie légitime toutes les exigences qu’elle peut avoir vis-à-vis de ses
sujets.
En se définissant comme monde idéal, elle justifie du même coup son immobilisme,
son refus du changement, son rejet des idées nouvelles ou extérieures.
Dans une société «
parfaite », les pensées qui ne s’intègrent pas au système de cette perfection ne peuvent être
que néfastes, perverses, intrinsèquement mauvaises.
Dans une société « parfaite », les
évolutions qui risquent de se produire ne peuvent être que reculs, retours en arrière ou
processus de dégradation.
Dans une société « parfaite », les hommes qui se rebellent ou se
sentent insatisfaits ne peuvent être que des méchants qu’il faut éliminer ou des fous qu’il
convient de soigner (le Meilleur des Mondes dispose à cet effet, dans les cas les plus graves,
de « Centre(s) de Reconditionnement pour Adultes6 ») (p.
191).
En se proclamant Paradis Terrestre, l’utopie instaure ainsi une logique d’ordre religieux
dans le cadre de laquelle les sceptiques ou les opposants sont nécessairement définis comme
monstrueux, diaboliques.
On aura, d’ailleurs, sans doute remarqué à ce propos qu’Huxley
prête aux responsables du Meilleur des Mondes un vocabulaire digne de l’Inquisition : les
mots d’« hérésie » ou d’« orthodoxie », comme en témoignent divers extraits du texte cités
plus haut, reviennent constamment dans leur bouche.
L’utopie, donc, s’énonce et s’annonce comme le Paradis sur terre.
Reste à savoir si, une fois
réalisée, elle constitue effectivement le paradis annoncé.
Or, à en juger d’après l’exemple du
Meilleur des Mondes, c’est loin d’être le cas.
D’abord, parce que cette société en théorie
paradisiaque a besoin du conditionnement pour être acceptée de ses sujets (ce à quoi les
dirigeants de l’État Mondial objecteraient sans doute que le conditionnement fait partie des
institutions nécessaires à la réalisation du Paradis Terrestre).
Mais ensuite, parce que,
malgré le conditionnement, de nombreux citoyens du Meilleur des Mondes se sentent mal à
l’aise dans leur univers.
Le roman met en scène deux mécontents, Bernard Marx et Helmholtz
Watson ; toutefois, ces derniers sont loin d’être les seuls si l’on en croit les propos de
Mustapha Menier en personne qui déclare, en parlant des individus que ne satisfait pas le
système social du Meilleur des Mondes et qu’on a pris l’habitude d’expédier dans des îles : «
Il est heureux [...] qu’il y ait tant d’îles au monde.
Je ne sais pas ce que nous ferions sans elles
» (p.
253).
Le mal de vivre est donc des plus répandus dans la société de l’État Mondial ; cela
seul suffirait à prouver que cet univers ne constitue en aucun cas une société parfaite.
L’utopie, ou le délire communautaire
En fait, à travers la fiction futuriste du Meilleur des Mondes, Huxley met le doigt sur l’erreur
fondamentale de la démarche utopique, celle qui est à l’origine de la notion de société
parfaite et qui consiste à penser que tous les problèmes humains seraient justiciables d’une
solution collective, que le bonheur des individus pourrait être obtenu grâce à une
organisation sociale adéquate.
Huxley nous montre que cette idée, sans doute généreuse
dans son inspiration, est en réalité dangereuse et fausse car en contradiction avec la vraie
nature de l’homme.
En effet, quand on croit que le bonheur individuel dépend de l’organisation sociale, on finit
par donner à la collectivité et à ce qui la représente - État, administration — un droit de
regard, de contrôle sur les domaines les plus intimes, les plus personnels.
Et, de façon
générale, on en vient à estimer que plus la société sera organisée, plus les hommes seront
heureux.
(C’est là l’origine du systématisme utopique dont nous avons plus haut analysé les
manifestations et les terrifiants effets.) Quand on est persuadé que toutes les difficultés des
hommes pourraient se régler par l’établissement de la structure sociale appropriée, on finit
par sacraliser cette structure, par en faire, non un moyen, mais une fin en soi.
Et l’on en arrive
à considérer qu’elle a plus d’importance que les gens auxquels elle est censée rendre service,
que la communauté organisée a infiniment plus de prix que les personnes qui la composent
— « que l’ensemble social a plus de valeur [...] que ses éléments individuels », comme l’écrit
Huxley à la page 37 de Retour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓