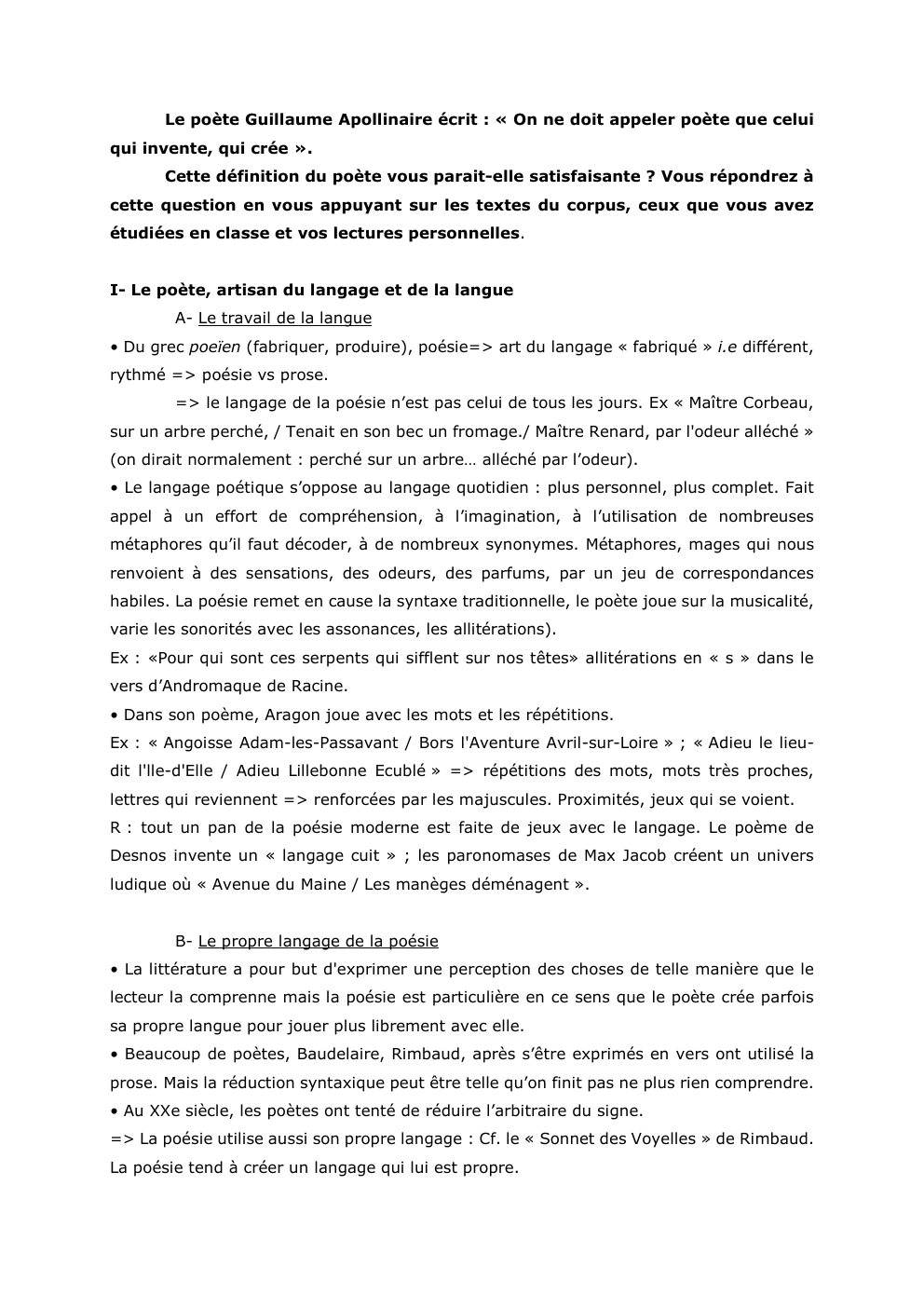Le poète Guillaume Apollinaire écrit : « On ne doit appeler poète que celui qui invente, qui crée ». Cette...
Extrait du document
«
Le poète Guillaume Apollinaire écrit : « On ne doit appeler poète que celui
qui invente, qui crée ».
Cette définition du poète vous parait-elle satisfaisante ? Vous répondrez à
cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, ceux que vous avez
étudiées en classe et vos lectures personnelles.
I- Le poète, artisan du langage et de la langue
A- Le travail de la langue
• Du grec poeïen (fabriquer, produire), poésie=> art du langage « fabriqué » i.e différent,
rythmé => poésie vs prose.
=> le langage de la poésie n’est pas celui de tous les jours.
Ex « Maître Corbeau,
sur un arbre perché, / Tenait en son bec un fromage./ Maître Renard, par l'odeur alléché »
(on dirait normalement : perché sur un arbre… alléché par l’odeur).
• Le langage poétique s’oppose au langage quotidien : plus personnel, plus complet.
Fait
appel à un effort de compréhension, à l’imagination, à l’utilisation de nombreuses
métaphores qu’il faut décoder, à de nombreux synonymes.
Métaphores, mages qui nous
renvoient à des sensations, des odeurs, des parfums, par un jeu de correspondances
habiles.
La poésie remet en cause la syntaxe traditionnelle, le poète joue sur la musicalité,
varie les sonorités avec les assonances, les allitérations).
Ex : «Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes» allitérations en « s » dans le
vers d’Andromaque de Racine.
• Dans son poème, Aragon joue avec les mots et les répétitions.
Ex : « Angoisse Adam-les-Passavant / Bors l'Aventure Avril-sur-Loire » ; « Adieu le lieudit l'lle-d'Elle / Adieu Lillebonne Ecublé » => répétitions des mots, mots très proches,
lettres qui reviennent => renforcées par les majuscules.
Proximités, jeux qui se voient.
R : tout un pan de la poésie moderne est faite de jeux avec le langage.
Le poème de
Desnos invente un « langage cuit » ; les paronomases de Max Jacob créent un univers
ludique où « Avenue du Maine / Les manèges déménagent ».
B- Le propre langage de la poésie
• La littérature a pour but d'exprimer une perception des choses de telle manière que le
lecteur la comprenne mais la poésie est particulière en ce sens que le poète crée parfois
sa propre langue pour jouer plus librement avec elle.
• Beaucoup de poètes, Baudelaire, Rimbaud, après s’être exprimés en vers ont utilisé la
prose.
Mais la réduction syntaxique peut être telle qu’on finit pas ne plus rien comprendre.
• Au XXe siècle, les poètes ont tenté de réduire l’arbitraire du signe.
=> La poésie utilise aussi son propre langage : Cf.
le « Sonnet des Voyelles » de Rimbaud.
La poésie tend à créer un langage qui lui est propre.
C- Un langage de l’émotion
• La poésie : condensé d'écriture qui rassemble une grande quantité d'émotions (VS prose
ou théâtre qui sont souvent de longs développements).
Ex : « il a deux trous rouges dans la poitrine » => Rimbaud avec son poème « Le Dormeur
du Val», dépeint en quelques lignes toute l'horreur de la guerre que l'on retrouve dans la
littérature en prose dans de longs développements.
• Cf.
le texte d’H.
Michaux => il crée de nouveaux mots « Il l'emparouille et l'endosque
contre terre ;/ Il le rague et le roupéte jusqu'à son drâle ; / Il le pratéle et le libucque et
lui baroufle les ouillais ».
Travail des mots, travail de la langue.
Mots-valises, néologismes… Même si on ne connaît
pas les mots, on comprend dans ce poème l’horreur de la guerre.
NB : => Le langage poétique n’est pas simple jeu, il « cède l’initiative aux mots »
(Mallarmé, Crise du vers).
Ainsi le poète ne va pas rechercher un sens préexistant ; il
n’est pas celui qui pense, mais celui à
• Talent du poète qui sait manier la langue.
Ex « Marie, qui voudrait votre beau nom
tourner,/ Il trouverait Aimer : aimez-moi donc, Marie ».
Chez Ronsard, référence à
l’Antiquité : le culte de Vénus vient remplacer celui de Marie (rime avec prie au vers
suivant : prière de l’aimer + anagramme).
∆) Les mots, leur choix, leur agencement est primordial en poésie, comme le
souligne Mallarmé.
Le poète est donc celui qui travaille la langue et crée un univers différent
avec.
Le poète n’est pas qu’un « artisan » de la langue => il semble d’abord être un être
différent :
II- Le poète, un « bohémien »
A- Le poète est différent
• Le poète a souvent été considéré comme un être à part, différent.
Certains vivent en
marge de la société.
NB : Dans la langue ordinaire, dire de quelqu’un « Celui-là, c’est un poète » c’est le
désigner comme un rêveur hors du monde, avec lequel on ne peut communiquer.
Deuxième moitié du XIXe siècle : poètes « maudits » => incompris.
• Sentiment de rejet ressenti par certains poètes.
Cf.
le poème de Baudelaire
« L’albatros » : comme le « vaste oiseau des mers », le poète est moqué, on cherche à lui
faire mal…
• Le poète ne semble pas apte à communiquer avec le monde.
Différent de l’homme
ordinaire, plus sensible, souvent supérieur au vulgaire, il est en décalage par rapport à ses
contemporains.
« Moi, je vis la vie à côté,
Pleurant alors que c’est la fête.
Les gens disent : Comme il est bête.
» Se plaint le poète Charles Cros dans Le collier....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓