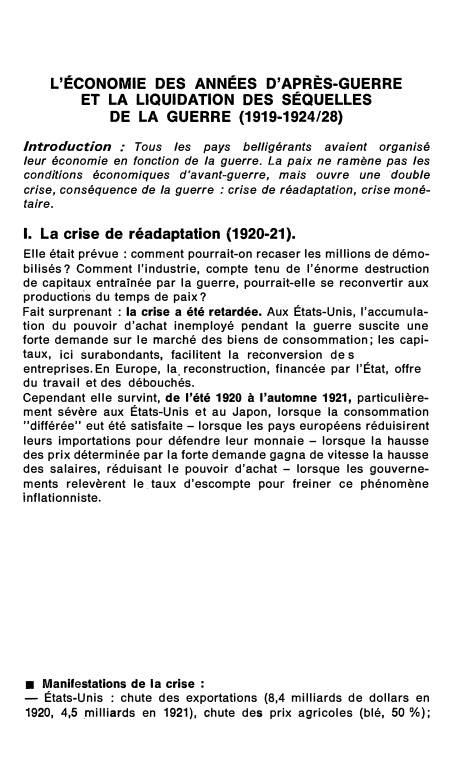L'ÉCONOMIE DES ANNÉES D'APRÈS-GUERRE ET LA LIQUIDATION DES SÉQUELLES DE LA GUERRE (1919-1924/28) Introduction : Tous les pays belligérants avaient...
Extrait du document
«
L'ÉCONOMIE DES ANNÉES D'APRÈS-GUERRE
ET LA LIQUIDATION DES SÉQUELLES
DE LA GUERRE (1919-1924/28)
Introduction : Tous les pays belligérants avaient organisé
leur économie en fonction de la guerre.
La paix ne ramène pas les
conditions économiques d'avant-guerre, mais ouvre une ·double
ctise, conséquence de la guerre : crise de réadaptation, ctise moné
taire.
1.
La crise de réadaptation (1920-21).
Elle était prévue : comment pourrait-on recaser les millions de démo
bilisés? Comment l'industrie, compte tenu de l'énorme destruction
de capitaux entraînée par la guerre, pourrait-elle se reconvertir aux
productions du temps de paix?
Fait surprenant : la crise a été retardée.
Aux États-Unis, l'accumula
tion du pouvoir d'achat inemployé pendant la guerre suscite une
forte demande sur le marché des biens de consommation; les capi
taux, ici surabondants, facilitent la reconversion d.e s
entreprises.
En Europe, la_ reconstruction, financée par l'État, offre
du travail et des débouchés.
Cependant elle survint, de l'été 1920 à l'automne 1921, particulière
me.nt sévère aux États-Unis et au Japon, lorsque· 1a.
consommation
"différée" eut été satisfaite - lorsque les pays européens réduisirent
leurs importations pour défendre leur monnaie - lorsque la hausse
des prix déterminée par la forte dèmande gagna de vitesse la hausse
des salaires, rêduisant le pouvoir d'achat - lorsque les gouverne
ments relevèrent le.
taux d'escompte pour freiner ce phénomène
inflationniste.
■ Manifestations de la crise :
- États-Unis : chute des exportations (8,4 milliards de dollars en
1920, 4,5 .milliards en 1921), chute des prix agricoles (blé, 50 %);
chute de la production industrielle (15 % de 1920 à 1921); 4,5 millions
de chômeurs.
- Japon : chute des exportations (35 %), de la construction navale
(50 %).
Crise sensible au Canada, dans les pays disloqués d'Europe centrale
(misère à Vienne).
11 Crise résorbée par .les mécanismes naturels (retour à l'équilibre
du marché à un niveau plus bas grâce à la baisse de la production
et des prix) et par une intervention limitée de l'État
- Aux États-Unis, défense du marché national par relèvement des
droits de douane (tarif Mac Cumber, 1922), défense du travail nation.al
par restriction de l'immigration (loi de 1921 : nombre annuel d'immi
grants limité pour chaque pays, sauf États américains, à 3 % du
nombre des originaires de ce pays établis aux États-Unis en 1910;
plafond de 360 000 immigrants par an; loi de 1924 : taux ramené à 2 %,
date de référence reportée à 1890).
- Au Japon, solution monétaire : dévaluation du yen de 50 % qui
relance l'exportation (1922).
Il.
La crise monétaire.
Touche tous les ex-belligérants européens; surprend les contempo
rains qui croyaient au dogme de la stabilité des monnaies; offre deux
aspects : chute du taux de change des monnaies (dépréciation),
baisse de leur pouvoir d'achat.
Rendue possible par le maintien de l'inconvertibilité des monnaies
(impossibilité de revenir à la convertibilité car l'encaisse des ins,
tituts d'émission, qui n'a pas augmenté ou a légèrement diminué,
ne couvre plus qu'une très faible fraction de la circulation fiduciaire
démesurément gonflée).
■ Due 1) au déficit de la balance générale des paiements, 2) à
l'inflation ( = accroissement de la masse monétaire disproportionné
à celui de la production).
Causes du déficit de la bal;mce des paiements, qui entraîne la chute
des taux de change : 1) · l'importance des importations nécessitées
par la reconstruction et la faiblesse des exportations de pays à peine
sortis de la guerre; 2) la réduction des "exportations invisibles",
conséquence de la perte d'une partie des avoirs à l'étranger; 3) la
spéculation à la baisse sur la monnaie nat.ionale (achat de mon
naie.s étrangères stables,· dollar, franc suisse, qui, motivée par la
co�viction que la monnaie nationale baissera, en précipite la chute).
Causes de l'inflation, qui entraîne la baisse du pouvoir d'achat :
1) l'énormité des indemnités aux victimes de la guerre et des dépenses
de reconstruction qui entretiennent le déficit budgétaire et alimentent,
par le recours de l'État aux avances de l'institut d'émission, l'aug
mentation de la circulation fiduciaire; 2) la hausse des prix qui en
résulte, qui impose des hausses de salaires couvertes par de nou
velles émissions de billets (phénomène de spirale); 3) la politique
de crédit bon marché, donc abondant, pour soutenir l'activité pro
ductrice des entreprises.
■ Les cas nationaux.
■ La chute de la livre, comme celle du franc, commence en mars 1919
avec la dênonciation des accords interalliés qui maintenaient auto
ritairement le taux de change de 1914 entre le dollar, la livre et le
franc sur les places financières des trois pays.
Elle reste limitée
(1920, i f: = 3,68 $, contre 4,86 en 1914, dépréciation : 24 %) : la
Grande-Bretagne avait couvert les frais de guerre en grande partie
par l'emprunt; les émissions de la Banque d'Angleterre n'ont été
multipliées que par 3; les revenus des capitaux placés à l'étranger
restent importants; le civisme anglais répugne à la spéculation
contre la livre.
·
■ En France, on prodigue les indemnités, on reconstruit somptueu
sement les villages du front; le déficit budgétaire est permanent,
simples avances que les Réparations allemandes rembourseront,
croit-on; la balance des paiements redevient bénéficiaire dès 1920,
mais les capitalistes préfèrent "se couvrir" en vendant d.u franc, et
la balance des mouvements de capitaux est bien plus largement
déficitaire.
La situation s'aggrave avec les dépenses que Poincaré,
président du Conseil de 1922 à 1924, expose en occupant la Ruhr
(1923) : au début de 1924, le dollar est à 20 F (dépréciation du franc
de 80 %); depuis 1914, la circulation fiduciaire a été multipliée par 7,
les prix par 5.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓