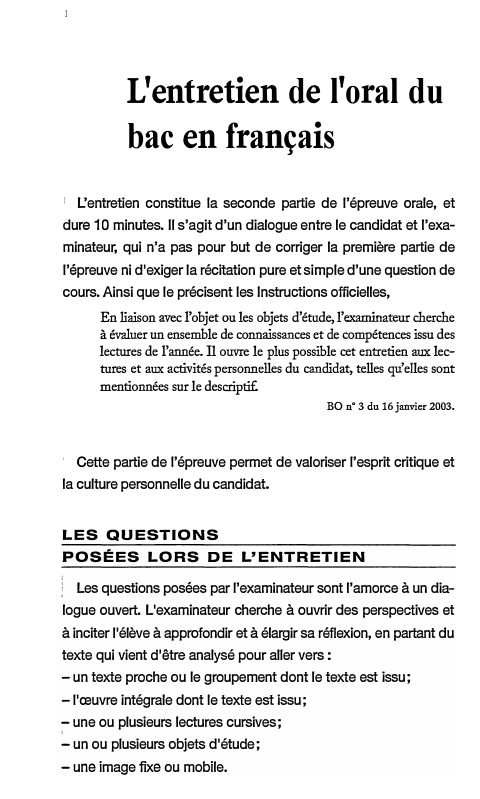L'entretien de l'oral du bac en français 1 L'entretien constitue la seconde partie de l'épreuve orale, et dure 10 minutes....
Extrait du document
«
L'entretien de l'oral du
bac en français
1 L'entretien constitue la seconde partie de l'épreuve orale, et
dure 10 minutes.
Il s'agit d'un dialogue entre le candidat et l'exa
minateur, qui n'a pas pour but de corriger la première partie de
l'épreuve ni d'exiger la récitation pure et simple d'une question de
cours.
Ainsi que le précisent les Instructions officielles,
En liaison avec l'objet ou les objets d'étude, l'examinateur cherche
à évaluer un ensemble de connaissances et de compétences issu des
lectures de l'année.
Il ouvre le plus possible cet entretien aux lec
tures et aux activités personnelles du candidat, telles qu'elles sont
mentionnées sur le descriptif:
BO n° 3 du 16 janvier 2003.
' Cette partie de l'épreuve permet de valoriser l'esprit critique et
la culture personnelle du candidat.
LES QUESTIONS
POSÉES LORS DE L'ENTRETIEN
Les questions posées par l'examinateur sont l'amorce à un dia
logue ouvert.
L'examinateur cherche à ouvrir des perspectives et
à inciter l'élève à approfondir et à élargir sa réflexion, en partant du
texte qui vient d'être analysé pour aller vers :
- un texte proche ou le groupement dont le texte est issu;
- l'œuvre intégrale dont le texte est issu;
- une ou plusieurs lectures cursives;
- un ou plusieurs objets d'étude;
- une image fixe ou mobile.
Questions en relation avec un texte proche
ou avec le groupement de textes
Il s'agit de questions qui amènent le candidat à établir des relations entre le texte qui vient d'être analysé et le groupement dont
il est issu, ou à établir une comparaison avec un texte proche, proposé par l'examinateur.
L.:entretien permet ainsi à l'examinateur
d'évaluer la capacité du candidat à:
- circuler à l'intérieur d'un groupement de textes;
- envisager les différents textes en fonction de la problématique
retenue;
- confronter les textes pour en comparer le fonctionnement;
- s'interroger sur des analogies ou des différences.
Circuler à l'intérieur d'un groupement de textes
Ces groupements proposés dans le descriptif des lectures et
des activités s'ordonnent autour d'un objet d'étude et d'une problématique.
Ainsi, le poème de Louise Labé « Las! Que tu me
sers...
» s'inscrit dans le cadre de la première séquence sur la
poésie et l'évolution du sonnet et fait partie d'un groupement de
cinq textes.
Le candidat doit également pouvoir parler des
poèmes de Ronsard, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et Tristan Corbière (➔ TEXTES 2 à 5) qui ont été sélectionnés, pour montrer la pertinence du groupement.
On pourra lui poser la question
suivante:
• La structure du sonnet est-elle traditionnelle dans les autres
textes du groupement? Justifiez votre rép,onse.
L'élève devra alors montrer que si Ronsard reste dans la tradition de la poésie amoureuse pétrarquiste, Baudelaire, Rimbaud et
Corbière s'autorisent, au fil des siècles, à jouer avec les codes du
sonnet, multipliant dysharmonies et licences poétiques, comme
pour ouvrir sur une poésie plus expressive et moderne et libérer
ainsi le sonnet d'un carcan jugé trop sévère.
Envisager les différents textes en fonction de la problématique retenue
' L'examinateur posera des questions concernant la problématique
soulevée par le candidat au cours de sa lecture analytique, pour
l'inciter à se demander si elle s'applique ou non aux autres textes du
groupement.
Cette lecture croisée est particulièrement pertinente
quand il s'agit de textes relativement proches, mais qui obéissent à
des problématiques différentes.
C'est le cas dans la séquence 2
sur l'expression de la passion dans le théâtre de Racine.
Certes, les quatre textes, extraits des tragédies Bérénice, Britannicus, Iphigénie et Phèdre (➔TEXTES 1 à 4) ont en commun une même
force des images pour exprimer le souvenir amoureux, mais la
richesse du langage théâtral montre des nuances différentes qu'il
convient de distinguer devant l'examinateur.
Confronter les textes pour en comparer le fonctionnement
On trouvera alors des questions du type :
• Pour quelle raison le lyrisme s'exprime de façon différente entre
t.
le texte 1 et le texte 2?
• Quel texte préférez-vous? Justifiez votre choix.
•· Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'unité des textes du groupement?
Dans le cadre de la séquence 3 sur la question du mythe et de
l'utopie au XVIll8 siècle, l'examinateur pourrait demander à l'élève
de confronter la mise en scène de l'utopie dans les cinq textes du
groupement.
Montesquieu, Louis-Sébastien Mercier, Diderot,
Voltaire et Marivaux ont en commun d'.utiliser les artifices rhétoriques de l'utopie pour dénoncer la société de leurs contemporains
fondée sur l'injustice et sur l'intolérance.
Mais il serait intéressant
de montrer par exemple que Mercier n'est pas un philosophe, mais
un romancier et que son texte, extrait de L 'An 2440, rêve s'il en fut
jamais, joue avec les codes de la science-fiction.
De même, l'art de
l'ironie utilisé par Voltaire place son texte, extrait de Candide, à
contre-courant des autres, alors que le texte de Marivaux, extrait
de L'lie des esclaves, offre des ressources théâtrales indéniables.
S'interroger sur les analogies ou sur les différences
Les questions portent sur des comparaisons qui montrent que
le candidat sait réagir avec pertinence sur les enjeux du texte.
On
trouvera alors des questions du type :
• Quelle figure de style retrouve t-on dans les textes 1 et 2?
• Quel est le thème commun à ces deux textes?
• Quels sont les deux registres utilisés par ces textes?
• Quelle est la différence de traitement de l'ironie entre les textes
3et4?
Dans le cadre de la séquence 1, par exemple, il est particulièrement intéressant de comparer les textes de Louise Labé, « Las!
Que tu me sers ••• » (-+TEXTE 1) et de Ronsard,« Je parangonne au
Soleil que j'adore
» (➔ TEXTE
2), qui relèvent tous les deux de la
poésie amoureuse.
Le candidat pourra alors relever les mêmes
topai pétrarquistes pour louer la beauté de la femme, et ainsi mon-
trer l'originalité poétique des deux poètes qui comptèrent parmi
les plus grands poètes du xvi• siècle.
C'est l'occasion aussi de
faire preuve d'esprit critique et de valoriser sa culture personnelle,
en montrant comment les poètes lyonnais ont influencé les
membres de la Pléiade.
Questions en relation
avec l'œuvre intégrale
Dans ce cas de figure, les questions posées amènent alors le
candidat à établir des relations entre un extrait et l'œuvre intégrale dont il est tiré.
Aussi, l'entretien permet à l'examinateur d'évaluer la capacité du candidat à :
- circuler dans une œuvre pour mener une étude transversale;
- établir des relations entre le texte et un ou plusieurs extrait(s) différent(s) de l'œuvre;
- émettre un jugement personnel.
Circuler dans une œuvre pour mener une étude transversale
· L'élève devra être capable d'identifier la fonction et/ou l'enjeu
particulier de l'extrait dans l'économie de l'œuvre.
1
', La question qui revient le plus souvent est :
• Quelle est la fonction de ce passage dans l'œuvre?
, L'élève devra, par exemple, réfléchir sur le rôle de l'incipit dans
un roman, puisque ce passage de l'œuvre est souvent décisif : il
livre la plupart du temps des informations essentielles à l'intrigue,
annonçant le futur déroulement de l'action.
Il en va de même pour
1
la fin, ou excipit, qu'il faut envisager comme un écho à l'incipit.
Dans la séquence 4 sur l'étude d'une œuvre intégrale, Le Neveu
de Rameau de Diderot, le texte 5,
«
La pantomime des gueux
»,
prend une dimension particulière : il invite le candidat à s'interroger sur les composantes théâtrales du dialogue philosophique de
Diderot.
Ainsi, Le Neveu de Rameau présente un ensemble de
scènes mimées qui apparentent ce dialogue à une pièce de
théâtre.
On dénombre quinze pantomimes qui semblent mimer la
grandeur et la décadence du neveu, au rythme d'une symphonie.
Qu'il s'agisse d'un récital de soliste donné par un violon, puis un
clavecin imaginaire, ou d'une fugue esquissée a capella et qui va
se transformer en opéra tout entier, l'illusion est déjà créée : les
chanteurs, l'orchestre, la salle même des spectateurs, tous les
rôles sont tenus à la fois par un seul homme dans un crescendo
de musique et de poésie.
Les pantomimes sont couronnées par la
plus célèbre d'entre elles : « La pantomime des gueux ».
Il s'agit
de mettre en scène, « le grand branle de la terre », lorsque le spectacle s'étend à la folle vision d'un monde réglé comme un gigantesque ballet.
La pantomime rythme le dialogue et s'offre comme
le miroir de la création poétique.
Sa fonction est de montrer que la
folie de Rameau porte en elle les germes de vérités neuves.
Établir des relations entre le texte étudié et un ou plusieurs
extrait(s) de I' œuvre
Il s'agit du texte étudié par le candidat au cours de la première
partie de l'épreuve.
Les questions peuvent porter sur la place de
chaque extrait dans l'œuvre.
Leur confrontation permettra à l'élève de tracer l'évolution de tel ou tel personnage, du rôle qu'il joue,
des relations que les personnages entretiennent entre eux, de la
relation de l'auteur avec son public ou avec ses personnages, de
l'implication croissante ou non du lecteur.
Il est à ce titre intéressant d'étudier, au fil des différents extraits choisis, l'évolution entre
le narrateur et Rameau dans Le Neveu de Rameau.
La relation est
placée tantôt sous le signe de l'agacement, de l'énervement, et
tantôt sous le signe de l'admiration, de la passion et permet de
montrer comment ils s'ouvrent mutuellement des horizons jusqu'alors peu entrevus.
Émettre un jugement personnel
Le candidat sera amené à formuler ce qu'il a apprécié ou pas
dans l'œuvre intégrale.
On pourra demander à l'élève :
• Quels sont les choix de mise en scène que vous feriez si vous
deviez monter cette pièce au théâtre?
Il ne s'agit pas de répondre par la négative (« Je ne sais pas, je
n'ai pas d'idées ») ou de façon péremptoire.
Même si ces questions sont personnelles, elles admettent des réponses construites
et argumentées.
Répondre à cette question implique de montrer,
dans le cadre de l'objet d'étude sur le théâtre, texte et représentation, que vous avez compris le rôle des objets, de l'espace, de
l'éclairage, de la position des comédiens dans la représentation
théâtrale.
N'ayez pas peur de donner votre avis si vous n'avez pas
aimé un texte.
Peut-être l'examinateur ressent-il la même chose
que vous, mais il est important que vous argumentiez de façon
pertinente votre réponse et que vous restiez ouvert au dialogue, en
vous montrant capable de rebondir sur les arguments avancés par
l'examinateur.
Questions en relation
avec une ou plusieurs lectures cursives
, Les questions posées par l'examinateur amènent le candidat à
établir des relations entre un extrait et une œuvre n'ayant pas fait
l'objet d'une étude approfondie, comme c'est le cas pour une
étude intégrale.
Les attentes ne peuvent donc pas être les mêmes
que dans le cas de l'élargissement du texte à l'œuvre intégrale,
mais on peut retrouver le même type de questions.
Dans ce cas,
l'entretien tendra à évaluer la capacité du candidat à:
- analyser des ressemblances ou des analogies;
-;- analyser des différences ou des variantes;
- formuler un jugement critique.
On peut retrouver les questions suivantes, qui portent sur des
1
notions plus générales que celles relevant des œuvres intégrales :
~ Quels sont les aspects de la poésie, du théâtre, de l'autobiographie, de l'écriture épistolaire, etc.
que la lecture cursive vous a
permis de découvrir et de mieux comprendre?
• Qu'avez-vous appris sur les choix de mise en scène en lisant
cette lecture cursive?
• A la lumière
de la lecture cursive, avez-vous l'impression de
mieux appréhender le mouvement culturel étudié dans le cadre de
cette séquence?
• Quelles sont les relations qu'entretient l'œuvre abordée en lecture cursive avec le groupement et/ou l'œuvre intégrale étudié(s)
en classe?
Dans la séquence 7 sur le mythe de Dom Juan et sa réécriture,
la lecture cursive de l'ouvrage Dom Juan et son double, d'Otto
Rank, peut constituer un éclairage intéressant sur le mythe de
Dom Juan et ses interprétatiors.
Questions en relation
avec une ou plusieurs objets d'étude
Les questions posées par l'examinateur amènent alors le
candidat à établir des relations entre le texte proposé et l'objet
d'étude envisagé dans son ensemble et qui a été en principe
étudié au cours de l'année.
Comme nous l'avons rappelé plus
haut, cinq objets d'études sont au programme dans les séries
générales S et ES, et sept dans les séries littéraires.
L'entretien
permet ainsi d'évaluer la capacité du candidat à :
- replacer le texte dans son contexte à la fois littéraire, artistique
et culturel;
- appréhender, en fonction du contexte, l'originalité du texte;
- envisager différents aspects de l'objet d'étude.
Replacer le texte dans son contexte littéraire, artistique et
culturel
C'est l'occasion pour le candidat de ne pas limiter ses connaissances au seul champ littéraire, en citant des artistes, des philosophes, des savants, témoins de ce mouvement culturel, et en ne
limitant pas....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓