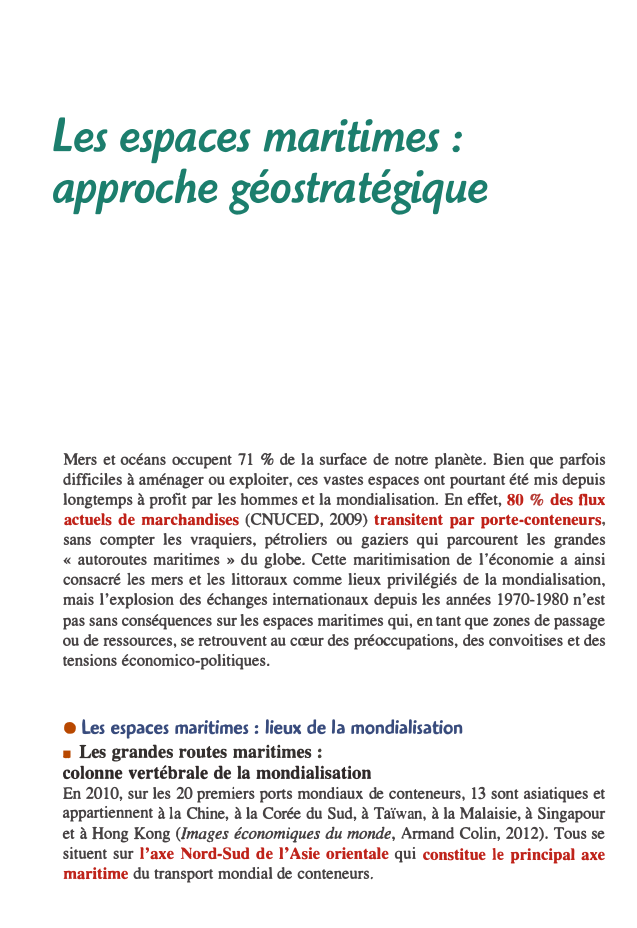Les espaces maritimes : approche géostratégique Mers et océans occupent 71 % de la surface de notre planète. Bien que...
Extrait du document
«
Les espaces maritimes :
approche géostratégique
Mers et océans occupent 71 % de la surface de notre planète.
Bien que parfois
difficiles à aménager ou exploiter, ces vastes espaces ont pourtant été mis depuis
longtemps à profit par les hommes et la mondialisation.
En effet, 80 % des flux
actuels de marchandises (CNUCED, 2009) transitent par porte-conteneurs,
sans compter les vraquiers, pétroliers ou gaziers qui parcourent les grandes
« autoroutes maritimes » du globe.
Cette maritimisation de l'économie a ainsi
consacré les mers et les littoraux comme lieux privilégiés de la mondialisation,
mais l'explosion des échanges internationaux depuis les années 1970-1980 n'est
pas sans conséquences sur les espaces maritimes qui, en tant que zones de passage
ou de ressources, se retrouvent au cœur des préoccupations, des convoitises et des
tensions économico-politiques.
• les espaces maritimes : lieux de la mondialisation
■ Les grandes routes maritimes :
colonne vertébrale de la mondialisation
En 2010, sur les 20 premiers ports mondiaux de conteneurs, 13 sont asiatiques et
appartiennent à la Chine, à la Corée du Sud, à Taïwan, à la Malaisie, à Singapour
et à Hong Kong (lma.ges économiques du monde, Armand Colin, 2012).
Tous se
situent sur l'axe Nord-Sud de l'Asie orientale qui constitue le principal axe
maritime du transport mondial de conteneurs.
À partir de cet axe se déploient, à l'ouest, la route vers l'Europe par le détroit de
Malacca et, à l'est, la route transpacifique vers l'Amérique du Nord.
Ces deux
routes constituent chacune un segment de l'artère circumterrestre qui relie entre
eux les pôles de la Triade selon un axe Est-Ouest.
Bien moins importantes, les
routes Nord-Sud reflètent la hiérarchie des puissances : le centre* reste la Triade
située dans l'hémisphère Nord, tandis que le Sud ne constitue qu'une périphérie
plus ou moins intégrée aux échanges maritimes.
La hiérarchie de ces trois segments du transport maritime circumterrestre reflète
aussi les rythmes de croissance et de développement sur la planète.
La domination
de l'axe asiatique s'explique, en effet, par le rôle d'« atelier du monde » tenu
par l'Asie, mais également par le commerce maritime intra-asiatique sans cesse
grandissant entre la Chine et le Japon ou la Corée du Sud, par exemple.
Ces deux
axes secondaires se placent ainsi respectivement en 4e et 5e places derrière les
grandes routes transocéaniques.
Enfin, l'origine des armateurs traduit aussi la montée de l'Asie dans les échanges
mondiaux.
On trouve 6 armateurs asiatiques parmi les 10 premiers mondiaux
en 2010 : le Sino-Taïwanais Evergreen Line (4e), les Singapouriens APL et
Coscon (5e et 6e), le Chinois China Shipping (8e), le Coréen Hanjin (9e) et enfin,
très révélateur, le Japonais NYK (loe), dépassé par ses jeunes rivaux.
Il n'existe
plus d'armateurs américains, absorbés par leurs concurrents ; seuls les Européens
font face avec le Danois Maersk (leî), l'italien MSC (Mediterranean Shipping
Company, 2e) et le Français CMA-CGM (3e).
Ces grandes routes maritimes contribuent donc à renforcer la polarisation et la
hiérarchisation des territoires, en n'en reliant que quelques-uns et en contournant
ou ignorant les autres.
Elles aboutissent à des lieux spécifiques : les interfaces
maritimes, chargées de traiter les cargaisons qu'elles acheminent d'un bout à
l'autre de la planète.
■ Les interfaces maritimes :
lieux majeurs de la mondialisation
Ceci explique que les façades maritimes des pôles de la Triade aient été aménagées
en de vastes espaces portuaires standardisés par la conteneurisation et que seule
une poignée de façades concentrent le trafic maritime
- les façades américaines ouvertes sur l'Atlantique et le Pacifique ;
- la Northern Range, ouverte sur la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique ;
- la façade de la mégalopole* japonaise, désormais concurrencée par la façade
asiatique en construction, moins dense mais abritant parmi les plus grands ports
du monde, de Singapour à Pusan en Corée du Sud en passant par Hong Kong et
Yangshan (nouveau port en eaux profondes de Shanghai).
Ces interfaces maritimes sont organisées sur le même modèle : des grands ports
aux terminaux spécialisés (vrac, hydrocarbures et conteneurs) sont reliés à un
hinterland* par de puissants réseaux de transports variés.
On peut observer deux types de ports : celui de transbordement et celui à
hinterland* classique.
Le port de transbordement n'est pas relié à un hinterland
et joue donc le rôle d'un hub* qui concentre les flux maritimes (essentiellement
des conteneurs) en un point et les redistribue à des échelles inférieures : c'est le cas
du port d'Algésiras, situé sur le détroit de Gibraltar, qui redistribue ainsi les flux
dans tout le bassin méditerranéen, évitant aux grands navires transocéaniques de
multiplier les escales pour décharger des volumes de moins en moins importants.
Le port classique, avec son hinterland, accueille, quant à lui, des navires reliant
directement deux façades maritimes.
Ces deux types de ports peuvent être
combinés, notamment dans les plus grands ports comme celui de Rotterdam.
Le but de ces interfaces est de mettre en relation deux zones différenciées de
production et de consommation ou une zone de production et une zone de
consommation situées de part et d'autre du globe.
C'est ainsi que ces interfaces
sont devenues les premières bénéficiaires de la mondialisation, mais elles ne
furent pas les seules.
Les détroits et les canaux ont aussi profité des échanges
mondiaux.
■ Détroits et canaux :
lieux de passage stratégiques de la mondialisation
Outre les interfaces, qui sont les points de départ et d'arrivée des grandes routes
maritimes, les détroits (bras de mer étroits cernés par des terres) et canaux
constituent également des lieux de passage et de transit obligés des flux maritimes.
Leur importance dans les échanges internationaux réside dans :
- leur rôle à faire communiquer deux espaces maritimes entre eux et les terres qui
les entourent ;
- leur localisation sur le tracé des grandes routes maritimes qui en fait des espaces
de transit incontournables sous peine de rallonger les trajets ;
- les ressources auxquelles ils donnent accès.
L'étroitesse et la localisation des détroits et canaux créent ainsi un phénomène
de concentration des flux et font d'eux, eu égard aux ressources qu'ils traitent,
de véritables portes maritimes que l'on peut contrôler, fermer, ouvrir ou pirater
(leur gestion, de ce fait, pouvant alors entrer en contradiction avec l'exercice de la
mondialisation fondé sur la libre circulation des marchandises !).
Ainsi, le détroit
d'Ormuz et le canal de Suez donnent accès aux ressources pétrolières du Moyen
Orient et assurent la communication avec les marchés américain, européen et
asiatique.
Les détroits de Malacca et de Singapour ouvrent sur l'« atelier du
monde » que constitue l'Asie de l'Est.
Le canal de Panama fait communiquer
deux océans et permet d'éviter le passage du cap Horn.
Le détroit de Gibraltar
contrôle, quant à lui, l'accès à la Méditerranée.
Cette capacité de relier ou isoler des espaces maritimes ou des territoires et celle
de donner ou non accès à des ressources expliquent donc que les détroits et
leurs jumeaux artificiels que sont les canaux constituent des maillons sensibles
de la mondialisation et soient l'objet d'enjeux géopolitiques cruciaux pour
l'économie globale.
Rien d'étonnant donc à ce que ces détroits soient, dans
l'ensemble, des zones très militarisées, comme le détroit d'Ormuz qui abrite la
ve flotte des États-Unis, ancrée à Bahreïn, et pas moins de 8 bases militaires !
■ Des espaces privilégiés de la mondialisation souterraine
De par leur immensité, les espaces maritimes sont difficiles à surveiller et
deviennent alors des zones de circulation et de transit privilégiées pour tous les
flux de la mondialisation souterraine (cf.
aussi p.
59): trafics de drogue ou d'armes,
passage de clandestins...
C'est ainsi le cas dans l'espace caraibe (voir l'étude de
cas, p.
137), véritable plaque tournante mondiale de la drogue entre les espaces
de production d'Amérique latine (la Colombie et, dans une moindre mesure, le
Brésil, le Venezuela et l'Argentine) et les espaces de consommation, tels que
les États-Unis (via le Mexique ou la Floride) et les pays européens (Espagne,
Portugal, Pays-Bas et Belgique).
Depuis les années 2000, une relocalisation de
la production et de la commercialisation de la drogue (laboratoires, stockage
et marché de gros) s'effectue, à l.'initiative des Colombiens, vers l'Afrique de
l'Ouest au détriment des Caraibes.
Les cargaisons au départ de l'Amérique latine sont transportées essentiellement
par bateaux de pêche ou vraquiers, puis transbordées sur de petites embarcations
de pêcheurs en haute mer.
Trois routes maritimes auraient été identifiées : la route
Caraibe/ Açores/ péninsule Ibérique ; la route Amérique latine/ Cap-Vert/ îles
Canaries/ Europe ; la route Amérique latine/ Afrique de l'Ouest/ Europe.
La
drogue entre ensuite en Europe essentiellement dissimulée dans le fret maritime,
puis transportée par « mules » sur des vols continentaux.
L'Afrique du Nord peut également constituer un espace de transit pour la drogue
ou les clandestins à destination de l'Union européenne.
Les passages humains
se font alors sur des embarcations de fortune généralement surchargées, causant
souvent leur naufrage et de nombreux décès et amenant les rescapés jusque sur les
plages italiennes, entre autres.
L'île sicilienne de Lampedusa, proche de la Tunisie
et de la Libye, constitue un point d'entrée privilégié des migrants clandestins dans
l'Union européenne ; plus de 5 000 Tunisiens auraient ainsi débarqué sur l'île en
février 2011, au moment de la révolution tunisienne.
• Les espaces maritimes :
enjeux et nouvelles frontières de la mondialisation
La mondialisation ne cessant de sélectionner les territoires en fonction de leurs
atouts pour l'économie mondiale, il est inévitable que les espaces maritimes
soient à leur tour concernés pour les ressources qu'ils abritent et le rôle qu'ils
jouent dans le commerce international.
■ Des ressources convoitées
La mer, pourvoyeuse en ressources alimentaires et énergétiques, est, à ce titre, un
espace convoité, exploité et aménagé par les hommes.
• De la pêche à la « surpêcbe »
La ressource halieutique (pêche) fut la première que l'homme exploita au sein du
milieu marin.
Essentiellement côtières, les principales zones de pêche sont inégalement réparties
à la surface du globe, celles offrant le meilleur rendement annuel se situant le long
des côtes américaines, européennes, et sur la côte atlantique de l'Afrique.
L'activité de la pêche a subi d'importantes mutations depuis les années
1950 dans les pays développés, passant d'une pêche artisanale à une pêche dite
« industrielle », alors que, dans les pays en développement, 95 % des pêcheurs
(sur)vivent encore d'une pêche artisanale.
Les chalutiers des pays de la Triade
sont devenus de véritables usines flottantes, assurant à la fois la pêche, la
transformation, la congélation et le transport: alors qu'il fallait près de 336 jours
de pêche pClur rapporter 1,5 million de tonnes d'anchois en 1987, il n'en faut plus
désormais que 12 ! Cette industrialisation de la pêche, associée à une demande
alimentaire en constante hausse (passant de 10 kg par personne et par an en 1960
à 17 kg en.
2008), a fait de ce secteur une activité économique rentable, voire
lucrative, rnais en danger à plus ou moins court terme.
Ainsi, on parle de plus
en plus de « surpêche », qui se traduit par une surexploitation des ressources
halieutiques, ponctionnées chaque année de près de 80 millions de tonnes, soit
4 fois plus qu'en 1950.
Pire: la pêche industrielle est aujourd'hui entrée dans un
cercle vicieux où le coût des équipements des navires impose aux pêcheurs de
rapporter toujours plus de prises et conduit ainsi à l'épuisement des stocks et à la
fin de leur activité.
Cette situation contradictoire est logiquement source de tensions, notamment
entre les pays pour lesquels cette industrie est vitale et pour qui l'agrandissement
des zones de pêche devient un enjeu économique mais aussi politique.
• Du pétrole on shore au pétrole offshore
Il en va de même pour les hydrocarbures, dont le sous-sol marin pourrait
compenser l'épuisement du sous-sol terrestre.
En effet, depuis les chocs pétroliers
des années 1970, les puissances de la Triade, au premier rang desquelles les
États-Unis, ont décidé de diminuer leur dépendance énergétique à l'égard des
pays du Moyen-Orient en exploitant des gisements offshores.
Ainsi, le pétrole
offshore représente actuellement 30 % de la production pétrolière mondiale
(source INPEN), provenant essentiellement de gisements peu profonds (moins
de 500 m de fond) des zones côtières.
Ces gisements d'hydrocarbures sont
inégalement répartis sur la planète mais restent néanmoins bien plus dispersés que
ne le sont les zones on shore, concentrées au Moyen-Orient (62 % des réserves
environ) : citons le golfe du Mexique (première exploitation offshore en 1947),
la mer du Nord (1971) et, plus récemment, au large du Brésil et du Venezuela et
dans les eaux du golfe de Guinée.
Là aussi, la technologie a permis d • accroître les rendements, d'exploiter et de forer
des gisements de plus en plus profonds, donc de plus en plus éloignés des côtes,
mais avec un risque accru d'accidents pétroliers, comme l'actualité récente en a
témoigné (cf.
p.
103).
Et même si cette exploitation offshore dans des conditions
extrêmes (offshore profond et zones polaires) est encore considérée comme non
rentable, la perspective de l'épuisement des gisements on shores conduit peu à
peu les États, par le biais de leurs compagnies pétrolières, à convoiter telle ou
telle zone, notamment le golfe de Guinée et l'océan Glacial Arctique, au risque
de faire surgir de nouvelles tensions à propos de la délimitation des frontières
maritimes.
■ Des zones de tensions: la territorialisation* de l'espace maritime
L'accès aux ressources marines ainsi que le contrôle et la sécurisation des voies
maritimes ont conduit à accroître la territorialisation de l'espace maritime et,
par là même, les tensions entre États.
Se sont donc multipliées récemment les
revendications de souveraineté sur des territoires sous-marins.
Ainsi, en aofit
2007, les Russes ont planté un drapeau en titane par 4 000 m de fond dans l'océan
Glacial Arctique.
Un drapeau planté illégalement dans des eaux internationales, qui,
par définition, n'appartiennent à personne...
Aussi, comment en est-on arrivé là?
• Des frontières sous la mer
Depuis 1609 et sur une idée du juriste néerlandais Grotius (1583-1645), l'espace
maritime était considéré comme un territoire international régi par la liberté de
navigation.
C'est ce principe qui fut appliqué avec la construction du canal de Suez
(1869) reliant l'Europe à l'Asie, lequel obtint un statut international fondé sur la
libre circulation maritime en temps de paix comme de guerre lors de la conférence
de Constantinople de 1888.
Mais ce principe fût contesté après 1945 lors de la
mise en place de zones de pêche et parce qu'on voulait exploiter les ressources du
sous-sol marin ou contrôler certains passages maritimes, comme ce fût le cas en
1956 lorsque le colonel Nasser, dirigeant égyptien, décida de nationaliser le canal
de Suez, entraînant alors une réplique militaire immédiate des Français et des
Britanniques qui exploitaient ce canal.
En 1982, la me conférence sur le droit de
la mer, organisée par l'ONU (de 1973 à 1982), aboutit à la signature, à Montego
Bay (Jamaïque), d'une convention.
Ratifiée par la plupart des pays industrialisés
(sauf les États-Unis), elle définit les différentes zones maritimes bordant les États
côtiers et le droit qui les régit.
À partir du trait de côte, Pespace maritime se divise en 6 zones:
-d'abord, les eaux intérieures, entre la côte et la ligne de base (limite de la marée
la plus basse) ;
- puis les eaux territoriales, jusqu'à 12 milles des côtes (1 mille marin équivaut
à 1 852 m);
- les eaux contiguës, 12 milles plus loin;
- puis la ZEE (Zone Économique Exclusive), qui s'étend jusqu'à 200 milles des
côtes;
- le plateau continental (prolongement sous-marin du territoire terrestre);
- enfin, les eaux internationales.
L'État côtier exerce sa totale souveraineté sur les eaux intérieures, territoriales
et contiguës qui sont soumises au droit national.
Il doit simplement laisser
circuler sans contraintes les navires, sauf les engins à propulsion nucléaire qui
ont obligation d'arborer le drapeau de leur pays et de naviguer en surface.
Dans
cette zone, l'État peut donc arraisonner tout navire pour des raisons fiscales,
douanières, sanitaires, environnementales, militaires ou politiques (immigration).
Au-delà, la ZEE et le plateau continental sont régis par le droit international
fixé à Montego Bay et la circulation y est totalement libre, y compris pour les
bâtiments militaires et le passage d'oléoducs ou de câbles sous-marins.
Dans
sa ZEE, l'État n'y est pas souverain mais peut y explorer, exploiter et protéger
librement les ressources.
La France possède la 2e ZEE du monde avec
11 millions de km2, derrière les États-Unis mais devant l'Australie.
Les eaux internationales (ou « haute mer ») sont, quant à elles, gérées comme un
patrimoine de l'humanité par l'Autorité internationale des fonds marins basée
à Kingston en Jamaïque.
Cette législation ne suffit cependant pas à éviter les
tensions au sujet des délimitations des souverainetés maritimes, tant les enjeux
économiques pesant sur ces espaces sont décisifs.
• Les litiges maritimes : contrôler la circulation et les ressources
Malgré ce droit international maritime, une frontière sous la mer reste beaucoup
plus....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓