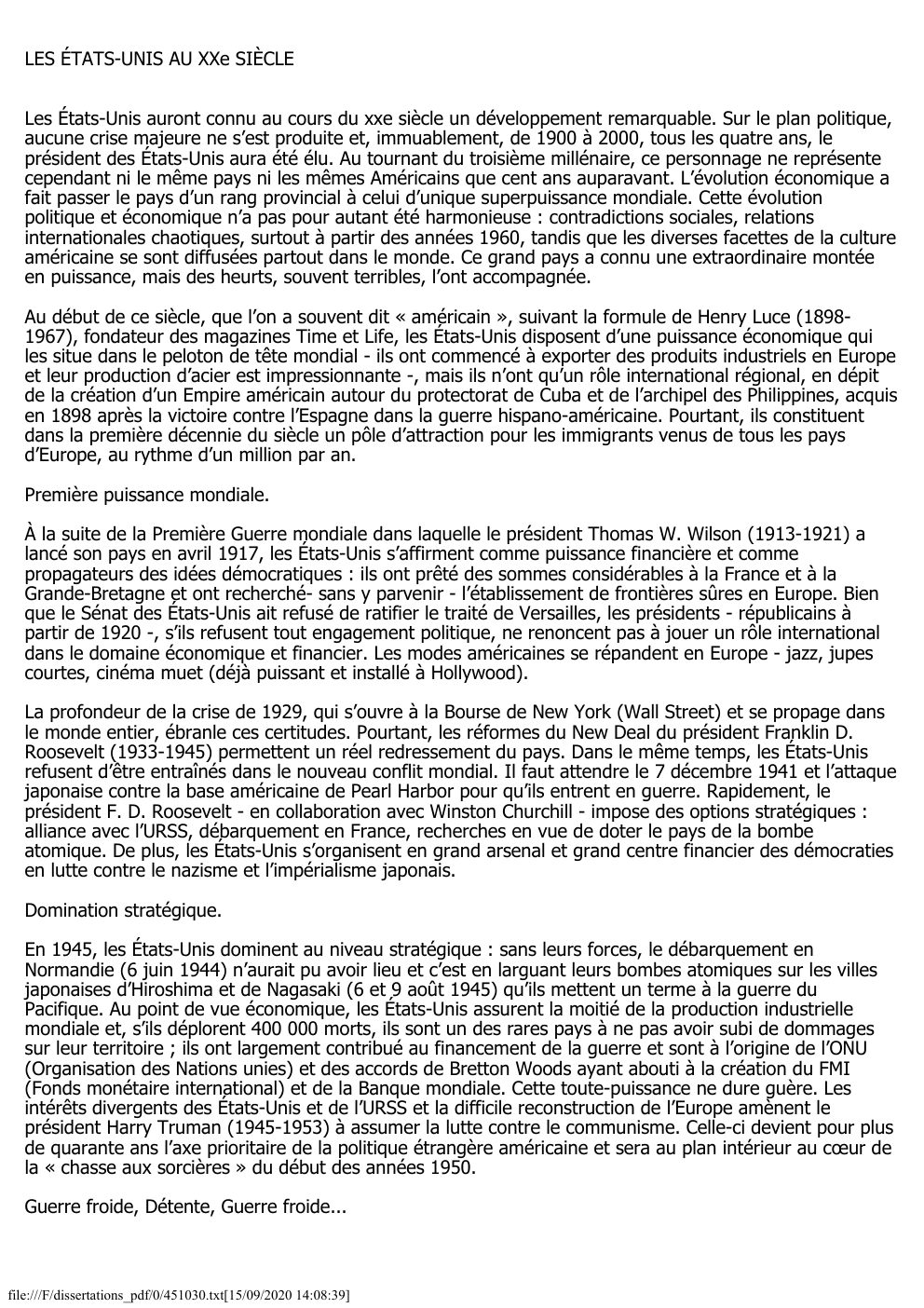LES ÉTATS-UNIS AU XXe SIÈCLE Les États-Unis auront connu au cours du xxe siècle un développement remarquable. Sur le plan...
Extrait du document
«
LES ÉTATS-UNIS AU XXe SIÈCLE
Les États-Unis auront connu au cours du xxe siècle un développement remarquable.
Sur le plan politique,
aucune crise majeure ne s’est produite et, immuablement, de 1900 à 2000, tous les quatre ans, le
président des États-Unis aura été élu.
Au tournant du troisième millénaire, ce personnage ne représente
cependant ni le même pays ni les mêmes Américains que cent ans auparavant.
L’évolution économique a
fait passer le pays d’un rang provincial à celui d’unique superpuissance mondiale.
Cette évolution
politique et économique n’a pas pour autant été harmonieuse : contradictions sociales, relations
internationales chaotiques, surtout à partir des années 1960, tandis que les diverses facettes de la culture
américaine se sont diffusées partout dans le monde.
Ce grand pays a connu une extraordinaire montée
en puissance, mais des heurts, souvent terribles, l’ont accompagnée.
Au début de ce siècle, que l’on a souvent dit « américain », suivant la formule de Henry Luce (18981967), fondateur des magazines Time et Life, les États-Unis disposent d’une puissance économique qui
les situe dans le peloton de tête mondial - ils ont commencé à exporter des produits industriels en Europe
et leur production d’acier est impressionnante -, mais ils n’ont qu’un rôle international régional, en dépit
de la création d’un Empire américain autour du protectorat de Cuba et de l’archipel des Philippines, acquis
en 1898 après la victoire contre l’Espagne dans la guerre hispano-américaine.
Pourtant, ils constituent
dans la première décennie du siècle un pôle d’attraction pour les immigrants venus de tous les pays
d’Europe, au rythme d’un million par an.
Première puissance mondiale.
À la suite de la Première Guerre mondiale dans laquelle le président Thomas W.
Wilson (1913-1921) a
lancé son pays en avril 1917, les États-Unis s’affirment comme puissance financière et comme
propagateurs des idées démocratiques : ils ont prêté des sommes considérables à la France et à la
Grande-Bretagne et ont recherché- sans y parvenir - l’établissement de frontières sûres en Europe.
Bien
que le Sénat des États-Unis ait refusé de ratifier le traité de Versailles, les présidents - républicains à
partir de 1920 -, s’ils refusent tout engagement politique, ne renoncent pas à jouer un rôle international
dans le domaine économique et financier.
Les modes américaines se répandent en Europe - jazz, jupes
courtes, cinéma muet (déjà puissant et installé à Hollywood).
La profondeur de la crise de 1929, qui s’ouvre à la Bourse de New York (Wall Street) et se propage dans
le monde entier, ébranle ces certitudes.
Pourtant, les réformes du New Deal du président Franklin D.
Roosevelt (1933-1945) permettent un réel redressement du pays.
Dans le même temps, les États-Unis
refusent d’être entraînés dans le nouveau conflit mondial.
Il faut attendre le 7 décembre 1941 et l’attaque
japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor pour qu’ils entrent en guerre.
Rapidement, le
président F.
D.
Roosevelt - en collaboration avec Winston Churchill - impose des options stratégiques :
alliance avec l’URSS, débarquement en France, recherches en vue de doter le pays de la bombe
atomique.
De plus, les États-Unis s’organisent en grand arsenal et grand centre financier des démocraties
en lutte contre le nazisme et l’impérialisme japonais.
Domination stratégique.
En 1945, les États-Unis dominent au niveau stratégique : sans leurs forces, le débarquement en
Normandie (6 juin 1944) n’aurait pu avoir lieu et c’est en larguant leurs bombes atomiques sur les villes
japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki (6 et 9 août 1945) qu’ils mettent un terme à la guerre du
Pacifique.
Au point de vue économique, les États-Unis assurent la moitié de la production industrielle
mondiale et, s’ils déplorent 400 000 morts, ils sont un des rares pays à ne pas avoir subi de dommages
sur leur territoire ; ils ont largement contribué au financement de la guerre et sont à l’origine de l’ONU
(Organisation des Nations unies) et des accords de Bretton Woods ayant abouti à la création du FMI
(Fonds monétaire international) et de la Banque mondiale.
Cette toute-puissance ne dure guère.
Les
intérêts divergents des États-Unis et de l’URSS et la difficile reconstruction de l’Europe amènent le
président Harry Truman (1945-1953) à assumer la lutte contre le communisme.
Celle-ci devient pour plus
de quarante ans l’axe prioritaire de la politique étrangère américaine et sera au plan intérieur au cœur de
la « chasse aux sorcières » du début des années 1950.
Guerre froide, Détente, Guerre froide...
file:///F/dissertations_pdf/0/451030.txt[15/09/2020 14:08:39]
La Guerre froide implique le pays dans nombre d’alliances internationales et le conduit à maintenir une
présence militaire en Europe et en Asie.
Alors que les Étas-Unis assurent la stabilité de l’Europe
occidentale grâce à l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord, 1949), ils s’engagent dans la
guerre de Corée (1950-1953) qui montre les difficultés d’une politique mondiale.
Vingt ans plus tard, leur
défaite dans la guerre du Vietnam (1973) prouve que les États-Unis n’ont pas résolu la contradiction entre
la lutte qu’ils estiment nécessaire contre le communisme et les légitimes aspirations sociales et nationales
des peuples.
L’échec américain au Vietnam n’empêche pas la Détente avec l’URSS de s’installer tant bien
que mal.
Les années 1980 sont marquées par une seconde guerre froide, assumée par le président Ronald Reagan
(1981-1989).
La fin de l’URSS et du bloc soviétique n’est pas uniquement due à la pression américaine,
mais les États-Unis vont désormais devoir imaginer un rôle nouveau : défendre leur conception de l’ordre
mondial sans chercher à intervenir militairement ou ne s’y résoudre qu’en étant assuré d’une victoire à
moindre coût humain.
C’est le cas lors de la guerre du Golfe (1991), cependant les hésitations à propos
d’une intervention en Bosnie-Herzégovine (1992-1995) ou au Kosovo (1999) ont montré qu’il est difficile
d’assumer un rôle dominant accepté par les autres puissances.
Au plan intérieur, l’évolution a été rythmée par des fluctuations économiques majeures et par des
bouleversements sociaux considérables.
La question noire.
Pour les Américains, la crise économique qui débute en 1929 a laissé plus de mauvais souvenirs que la
guerre qui a suivi.
Elle a constitué un choc qui a provoqué la réévaluation du rôle de l’État : celle-ci
débute avec les réformes du New Deal de F.
D.
Roosevelt et se poursuit jusqu’à la fin des années 1960,
quand la pression sociale augmente.
En revanche, la prospérité économique des années 1950 et 1960
permet l’essor de la consommation des ménages et le développement des banlieues résidentielles.
Pourtant, cette prospérité est très inégalement répartie : des poches de pauvreté subsistent dans
certaines zones rurales et dans des quartiers urbains.
Les Africains-Américains - les Noirs américains
revendiquent désormais cette dénomination - ont connu jusqu’aux années 1960 une situation particulière.
Tous ceux qui vivaient dans le Sud - neuf sur dix en 1920, six sur dix en 1960 ; environ quatre sur dix en
1990 - ont connu la forme la plus sévère de la ségrégation raciale officielle : interdiction de tout mélange
racial, séparation dans toutes les activités, ainsi que dans les lieux publics.
De plus, dans le Sud, les Noirs
sont par des moyens divers exclus du vote.
Ceux qui vivent dans le Nord ou l’Ouest, où les a attirés
l’emploi industriel, connaissent une existence moins réglementée, mais ils doivent se contenter d’un
habitat dégradé et supporter des formes subtiles d’exclusion.
À partir des années 1960, la contradiction existant entre la prospérité du pays et le sort des AfricainsAméricains qui constituent plus de 10 % de la population éclate.
Le mouvement en faveur des droits
civiques se développe et la question noire s’impose.
Des manifestations se multiplient pour réclamer
l’égalité, de nouveaux leaders émergent tels que Malcolm X et Martin Luther King ; le premier prône la
violence, le second des pressions pacifiques.
À la suite des manifestations se déroulant dans le Sud, qui
s’accompagnent souvent de violences, le gouvernement fédéral est amené à intervenir.
De 1963 à 1965,
sous cette pression, une série de lois sont votées qui détruisent l’édifice de la ségrégation dans le Sud et
favorisent l’insertion des plus démunis dans la société.
Ces mesures capitales ne suffisent pas, et, dans
les villes du Nord et de l’Ouest, des émeutes raciales éclatent après 1965, car les effets du racisme
survivent à l’interdiction de la ségrégation.
À partir de cette période, la société américaine ne connaît plus de certitudes : les autres minorités
raciales - comme les Indiens ou les Mexicains - et les femmes à leur tour revendiquent leurs droits.
Une
politique de discrimination positive (affirmative action) est mise en place par le gouvernement fédéral,
suivant la volonté du président Lyndon B.
Johnson (1963-1969), pour donner leur chance aux victimes de
la discrimination raciale ou sexuelle.
L’immigration qui avait été limitée par des quotas depuis 1924 est
largement relancée par une loi de 1965 : des millions de personnes d’Amérique latine et d’Asie vont
entrer dans le pays, modifiant les équilibres internes de la société.
Le président John F.
Kennedy (1961-1963) est assassiné dans des conditions obscures le 22 novembre
1963 ; Malcolm X le 21 février 1965 ; M.
L.
King, sans doute par une conspiration raciste, le 4 avril 1968
et Robert F.
Kennedy (frère de J.
F.
Kennedy) le 6 juin, par un déséquilibré.
La convention démocrate de
Chicago en août 1968 se déroule dans une atmosphère de violences policières et de happening :
manifestations où se mêlent modes et musiques de la contre-culture,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓