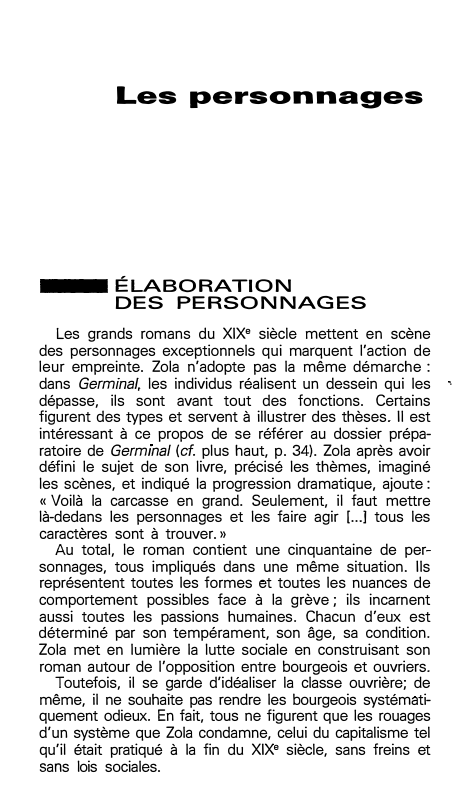Les personnages ÉLABORATION DES PERSONNAGES Les grands romans du XIXe siècle mettent en scène des personnages exceptionnels qui marquent l'action...
Extrait du document
«
Les personnages
ÉLABORATION
DES PERSONNAGES
Les grands romans du XIXe siècle mettent en scène
des personnages exceptionnels qui marquent l'action de
leur empreinte.
Zola n'adopte pas la même démarche :
dans Germinal, les individus réalisent un dessein qui les
dépasse, ils sont avant tout des fonctions.
Certains
figurent des types et servent à illustrer des thèses.
Il est
intéressant à ce propos de se référer au dossier prépa
ratoire de Germinal (cf.
plus haut, p.
34).
Zola après avoir
défini le sujet de son livre, précisé les thèmes, imaginé
les scènes, et indiqué la progression dramatique, ajoute :
« Voilà la carcasse en grand.
Seulement, il faut mettre
là-dedans les personnages et les faire agir [...
] tous les
caractères sont à trouver.
»
Au total, le roman contient une cinquantaine de per
sonnages, tous impliqués dans une même situation.
Ils
représentent toutes les formes et toutes les nuances de
comportement possibles face à la grève ; ils incarnent
aussi toutes les passions humaines.
Chacun d'eux est
déterminé par son tempérament, son âge, sa condition.
Zola met en lumière la lutte sociale en construisant son
roman autour de l'opposition entre bourgeois et ouvriers.
Toutefois, il se garde d'idéaliser la classe ouvrière; de
même, il ne souhaite pas rendre les bourgeois systémati
quement odieux.
En fait, tous ne figurent que les rouages
d'un système que Zola condamne, celui du capitalisme tel
qu'il était pratiqué à la fin du XIXe siècle, sans freins et
sans lois sociales.
LES MINEURS
Étienne Lantier
• Origines et portrait physique
C'est avec lui que s'ouvre et se ferme le livre.
La première partie de son existence est évoquée dans deux
autres romans de Zola, La Fortune des Rougon (1871) et
L 'Assommoir (1877).
Né en 1846, il est le fils de GeNaise Macquart et de
son amant, Auguste Lantier, ouvrier tanneur à Plassans
(dans le Midi).
Mais GeNaise, abandonnée par Lantier,
épouse Coupeau, un ouvrier zingueur, qui maltraite
souvent l'enfant.
Étienne, dès l'âge de douze ans, travaille comme apprenti dans une fabrique de boulons.
Par
la suite, il est envoyé à Lille et devient mécanicien.
Au début de Germinal, Étienne a vingt et un ans.
Il
erre depuis huit jours sur les routes du Nord, à la
recherche d'un travail.
Il vient de Lille, où il était employé
comme mécanicien aux ateliers du chemin de fer, mais
il a été renvoyé pour avoir giflé son chef.
Physiquement, Étienne est un garçon « très brun, joli
homme, l'air fort malgré ses membres menus» (p.
57).
Par son type méridional, il diffère de ses camarades.
Catherine le trouve « joli, avec son visage fin et ses moustaches noires» (p.
92).
• Une hérédité chargée
Mais Étienne est possédé d'un mal héréditaire: dernier
enfant d'une race d'alcooliques, il souffre « dans sa chair
de toute cette ascendance trempée et détraquée
d'alcool » (p.
93).
Il peut devenir méchant et même avoir
envie de tuer quand il boit.
« Quand je bois, cela me
rend fou» dit-il à Catherine (p.
93).
C'est ainsi qu'il a
giflé son chef, après avoir bu.
Zola s'est en effet proposé
d'illustrer dans la série des Rougon-Macquart la théorie
des lois de l'hérédité : il avait .prévu de mettre chez
Étienne cette névrose familiale qui peut dégénérer en
folie homicide.
Mais finalement, dans Germinal, ce trait
sera peu marqué.
Il n'apparaît guère que dans l'altercation
d'Etienne avec son chef ou dans ses affrontements avec
Chaval.
Le besoin de tuer surgit périodiquement en lui,
mais il réussit à chaque fois à se vaincre; ainsi lors d'une
rixe violente avec Chaval à !'Avantage, Étienne ressent
« une brusque folie du meurtre, un besoin de goûter au
sang [...
].
Et il lutte contre le mal héréditaire (p.
465).
Lorsqu'il tue son rival, c'est dans un contexte de légitime
défense.
• Un amoureux timide
Étienne est un jeune homme timide, renfermé, qui n'a
guère l'expérience des femmes.
Aussi se montre-t-il très
réservé face à Catherine, par qui il se sent profondément
attiré mais il se laisse devancer par Chaval.
Lorsqu'il loge
chez les Maheu, il lui faut vivre avec Catherine une intimité
de chaque minute.
Le trouble des jeunes gens se fait
pressant.
Pourtant, Étienne qui sait que Catherine l'attend
dans son lit, ne la rejoint pas : « Plus ils vivaient côte à
côte, et plus une barrière s'élevait, des hontes, des répugnances, des délicatesses d'amitié, qu'ils n'auraient pu
expliquer eux-mêmes» (p.
224).
Et c'est au fond de la
mine inondée qu'il la possédera avant qu'elle n'expire
(p.
573).
• Un ouvrier consciencieux
Étienne est d'abord employé comme herscheur* (cf.
plus haut, p.
16).
Le travail est dur, mais il s'accommode
au rythme de la mine.
« Au bout de trois semaines, on
le citait parmi les bons herscheurs de la fosse» {p.
186).
Finalement, on lui propose un emploi de haveur*, c'est
ainsi qu'il entre dans l'équipe de Ma heu.
• Un militant révolutionnaire
Il se lance à corps perdu dans l'action révolutionnaire,
révolté par la misère et la résignation de ses camarades.
L'emportant sur les autres mineurs par son intelligence,
son courage et sa personnalité, il devient leur chef.
Il
correspond avec son ancien contremaître Pluchart, secrétaire de la Fédération du Nord, qui le pousse à créer une
section de l'Internationale à Montsou.
La Première Internationale des travailleurs venait de se créer à Londres en
1864.
Les travailleurs du monde entier pourraient
désormais s'unir.
Au niveau national, on distinguait « la
section, qui représente la commune ; puis, la fédération,
qui groupe les sections d'une même province ; puis la
nation [ ...
] » (p.
192).
Étienne se met à lire, sans méthode, des journaux
engagés, diverses brochures ou traités d'économie poli-
tique, un livre de médecine (p.
215).
Il endoctrine les
Maheu et révolutionne peu à peu le coron : tous
l'écoutent, espérant dans leur vie « une trouée de
lumière » (p.
219).
Il prophétise une société future idéale,
de nature communiste, reposant sur l'abolition de la propriété privée des moyens de production : « Étienne chevauchait sa question favorite, l'attribution des instruments
de travail à la collectivité » (p.
338).
Le peuple prendrait
le pouvoir, quitte à payer sa liberté par le sang et la violence : « et ni le feu, et ni le sang ne lui coûtaient »
(p, 339).
Étienne deviel'}t donc le meneur, le chef incontesté ; mais il se laisse déborder par la fureur des grévistes.
Finalement, la grève a échoué.
Étienne repart
comme il était venu, un matin d'avril.
Lui qui a longtemps cru que la violence révolutionnaire
était un moyen de changer le monde, envisage à la fin du
roman des solutions plus pacifiques : l'action syndicale,
organisée et bien maîtrisée pourrait permettre aux
ouvriers de connaître le triomphe légalisé.
Le cœur léger
malgré l'échec, il sait que rien ne sera plus jamais comme
avant : les germes de la révolte seront récoltés dans les
siècles futurs.
.
L'aventure d'Étienne est une formation personnelle: il
apprend un métier, il découvre la passion, il se forme
comme militant ouvrier et symbolise la prise de
conscience de toute une classe, la classe ouvrière.
Il
donne à Germinal la structure d'un roman d'apprentissage.
Les Maheu
Ils travaillent dans la mine depuis cinq générations et
représentent la famille type des mineurs.
• Guillaume Maheu, l'aïeul.li a découvert la veine qu'i porte
son nom.
Il est mort de vieillesse à soixante ans (p.
57).
• Nicolas Maheu, son fils, mort à quarante ans dans un
éboulement (p.
57).
• Vincent Maheu, dit Bonnemort.
Son surnom lui vient
de ce qu'il a réchappé à trois accidents de la mine (p.
55).
Il travaille au Voreux depuis l'âge de hüit ans: « Hein ?
c'e§t joli, cinquante ans de mine, dont quarante-cinq au
fond ! » (p.
56).
Il y a fait toutes les tâches.
Depuis cinq
ans, on l'a retiré du fond car ses jambes ont du mal à le
soutenir.
Il est devenu charretier et travaille de nuit.
Son
aspect physique est inquiétant : il a une « grosse tête, aux
cheveux blancs et rares, à la face plate, d'une pâleur livide,
maculée de taches bleuâtres» (p.
55).
Mais surtout, il est
atteint d'une maladie grave, la silicose, qui touche les
ouvriers des mines.
Bonnemort ne cesse de tousser et de
cracher: « Un violent accès de toux l'étranglait.
Enfin, il
cracha, et son crachat, sur le sol empourpré, laissa une
tache noire» (p, 51).
Bonnemort figure l'image des ravages
que la mine peut exercer sur un homme.
L'échec de la grève, la mort des siens, précipitent sa
fin.
Il passe ses journées, hébété, paralysé, et, poussé
par on ne sait quel instinct, il étrangle, de ses mains
noires, Cécile Grégoire venue lui apporter des chaussures.
• Toussaint Maheu, âgé de quarante-deux ans, il est
haveur*.
Il est l'époux de Constance Maheu, dit la
Maheude.
C'est un bon ouvrier, consciencieux, qui travaille
dans des conditions très difficiles : sous une température
de 35°, couché sur le flanc, dans un espace réduit et sans
air, il doit détacher les blocs de houille ...
« La roche, audessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau » (p.
86).
Brisé de fatigue, il se laisse progressivement gagner par la colère.
• La Maheude1, épouse de Toussaint Maheu, « d'une
beauté lourde, déjà déformée à trente-neuf ans par sa vie
de misère et les sept enfants qu'elle avait eus» (p.
65).
Foncièrement bonne, raisonnable et prudente, elle incarne
la prise de conscience progressive des mineurs.
D'abord
hostile à la grève, elle se laisse aller à espérer èn un monde
meilleur.
Elle prend la tête du cortège des grévistes, « avec
des yeux ensauvagés» (p.
383) et pousse son mari à jeter
des briques aux soldats qui gardent la fosse.
Elle se résigne
à nouveau, alors que tout est détruit autour d'elle, à
reprendre un travail harassant, « l'échine cassée» (p.
587).
1.
Les épouses des mineurs reçoivent le nom de famille de leur
mari féminisé par la dérivation suffixale (Maheu, Maheude ;
Pierran, Pierronne), et précédé de l'article féminin.
Cette appellation peut être considérée comme une marque de subordination
de la femme à l'homme et reflète un contexte social, celui du
monde ouvrier.
Les sept enfants Maheu
• Zacharie, vingt et un ans, « maigre, dégingandé, la figure
longue, salie de quelques rares poils de barbe, avec les
cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille»
(p.
62).
il est haveur*.
Il épousera Philomène Levaque, dont
il a deux enfants, Achille et Désirée.
Il n'aime guère le
travail et se montre peu motivé par la grève, mais quand
Catherine est ensevelie dans le Voreux, il n'a de cesse de
la retrouver : « Zacharie ne vivait plus, aurait mangé la terre
pour retrouver sa sœur » (p.
541 ).
Il périt brûlé à la suite
d'un coup de grisou.
• Catherine, quinze ans, est une jeune fille fluette aux
cheveux roux et au teint pâle.
Le teint blême de son visage
était « déjà gâté par les continuels lavages au savon noir»
(p.
61 ).
Elle a de grands yeux « d'une limpidité verdâtre
d'eau de source, et dont le visage noir creusait encore le
cristal» (p.
114).
Courageuse, elle se lève à quatre heures
du matin pour préparer le maigre déjeuner de la famille.
Arrivée à la mine, elle pousse sa berline dont le poids
atteint sept cents kilogrammes : « Elle suait, haletait, craquait des jointures, mais sans une plainte [...
] (p.
90).
Elle
est la maîtresse de Chaval qui la brutalise, mais à qui elle
reste fidèle: « c'était son homme, celui qui l'avait eue le
premier» (p.
387).
Attirée par Étienne elle refoule son
amour pour lui.
• Jeanlin, onze ans.
Petit, aux membres grêles, il a une
face de « singe blafard et crépu» (p.
63), des « yeux verts»,
de« larges oreilles» (p.
472).
Il exerce le métier de galibot*.
Malicieux, rusé et brutal, c'est un « brigand d'enfant» à
!'«échine de fouine, longue et désossée» (p.
471), toujours à la recherche de ce qu'il « pourrait faire de mal»
(p.
379).
Il exerce sa domination sur Lydie et Bébert qu'il
menace et brutalise, volant Lydie résignée à Bébert.
Victime d'un éboulement dans la mine, il conserve ses
jambes, mais reste boiteux et « il fallait le voir filer d'un
train de canard, [..
.] avec son adresse de bête malfaisante
et voleuse» (p.
319).
Il martyrise Pologne, la lapine des
Rasseneur et tue d'un coup de couteau le petit soldat
breton, chargé de gar_der la f9sse.
Souvent désigné par
des métaphores animales (singe, fouine, canard, chat
sauvage), Jeanlin représente l'enfance dégénérée, produit
de la misère (p.
239).
• Alzire, la petite infirme bossue, « si chétive pour ses
neuf ans» (p.
61).
D'une intelligence précoce, elle aide sa
mère et s'occupe de ses petits frères et sœurs.
Elle meurt
de faim dans une tragique agonie (p.
455).
• Lénore, six ans, Henri.quatre ans, Estelle, trois mois.
Les Levaque
• Jérôme Levaque est haveur* avec Maheu.
Coureur,
buveur, il bat sa femme.
• La Levaque, sa femme a quarante et un ans.
Elle est
sale, « affreuse, usée, la gorge sur le ventre et le ventre
sur les cuisses» (p.
152).
Elle est la maîtresse de leur
logeur Bouteloup.
• Philomène, leur fille aînée, « mince et pâle, d'une figure
moutonnière de fille crachant le sang» (p.
112).
Elle est la.
maîtresse de Zacharie dont elle a deux enfants.
• Bébert, leur fils, « gros garçon naïf» (p.
76) âgé de douze
ans, est galibot*.
Il s'est pris d'affection pour Lydie Pierron,
mais celle-ci est convoitée par Jeanlin qui joue au chef de
bande.
Soumis à Jeanlin, Bébert n'ose lui résister.
• Bouteloup, « gros garçon brun de trente-cinq ans »
(p.
114), loge chez les Levaque et est l'amant de la Levaque.
Les Pierron
• François Pierron, chargeur* à l'accrochage*, est veuf
et père de Lydie.
Il est marié à la Pierronne et ferme les
yeux, par intérêt, sur les infidélités de sa femme avec le
maître-porion* Dansaert.
Lors de la grève, alors que tout
le coron est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓