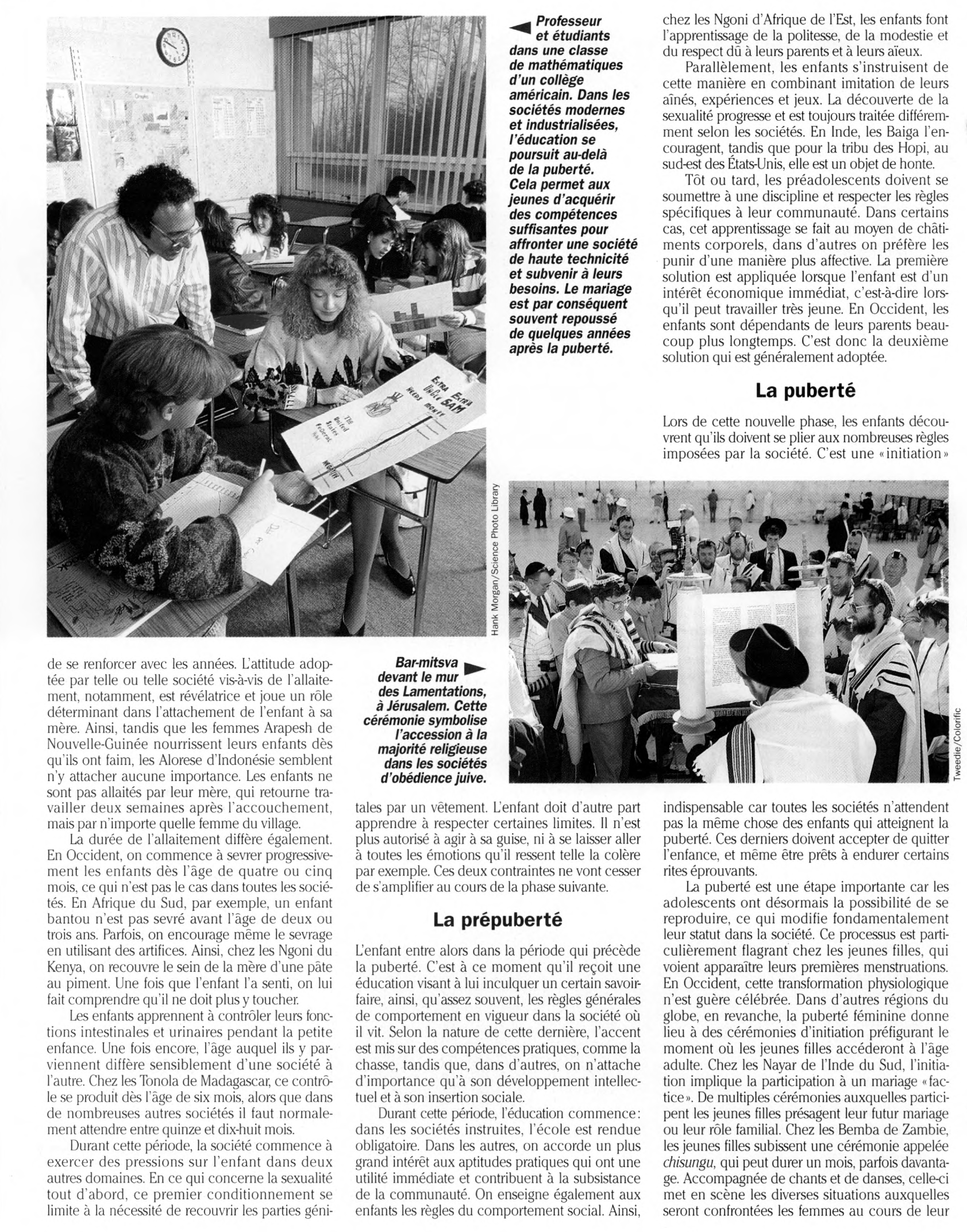Les Phases de la vie
Publié le 17/09/2013

Extrait du document
Les phases biologiques de la vie
sont communes à toute l'humanité.
En revanche, diffère largement
la manière dont les sociétés
les conçoivent, y réagissent
et dont elles déterminent
le passage de l'une à l'autre.
E
n évoluant de l'enfance à la puberté, puis à l'âge adulte, les êtres humains se dévelop¬pent en conformité avec les règles de la société dans laquelle ils vivent.
Dans certaines communautés, on attend des enfants qu'ils prennent des responsabilités pré cises. Dans d'autres, on leur accorde uniquement la liberté de jouer et de découvrir l'univers qui les entoure. Dans certaines sociétés en revanche, une cérémonie d'initiation - qui s'accompagne par¬fois d'une épreuve ou d'un rite douloureux, mais est le plus souvent l'occasion d'une fête - marque le passage de l'enfance à la puberté.
Le mariage constitue communément l'étape suivante, même si les formes prises par la céré¬monie peuvent varier à l'infini. Les partenaires se choisissent librement, ou bien leur union est arrangée voire imposée par d'autres personnes, notamment par leurs parents.
De même, l'attitude adoptée envers les per¬sonnes âgées diffère selon les sociétés: dans cer¬taines, elles sont respectées pour leur sagesse alors que dans d'autres, elles sont considérées plutôt comme une charge parce qu'elles sont improduc¬tives. Même à sa mort, un individu est traité selon les règles propres à la communauté à laquelle il appartient. Les modalités d'enterrement ou d'inci¬nération dépendent essentiellement des pratiques religieuses de la société en question ainsi que des croyances personnelles du défunt.
«
142 Les Phases de la vie
e
Professeur
-00
et étudiants
dans une classe
de mathématiques
d'un collège
américain.
Dans les
sociétés modernes
et industrialisées,
l'éducation se
poursuit au-delà
de la puberté.
Cela permet aux
jeunes d'acquérir
des compétences
suffisantes pour
affronter une société
de haute technicité
et subvenir à leurs
besoins.
Le mariage
est par conséquent
souvent repoussé
de quelques années
après la puberté.
chez les Ngoni d'Afrique de l'Est, les enfants font
l'apprentissage de la politesse, de la modestie et
du respect dû à leurs parents et à leurs aïeux.
Parallèlement, les enfants s'instruisent de
cette manière en combinant imitation de leurs
aînés, expériences et jeux.
La découverte de la
sexualité progresse et est toujours traitée différem-
ment selon les sociétés.
En Inde, les Baiga l'en-
couragent, tandis que pour la tribu des Hopi, au
sud-est des Etats-Unis, elle est un objet de honte.
Tôt ou tard, les préadolescents doivent se
soumettre à une discipline et respecter les règles
spécifiques à leur communauté.
Dans certains
cas, cet apprentissage se fait au moyen de châti-
ments corporels, dans d'autres on préfère les
punir d'une manière plus affective.
La première
solution est appliquée lorsque l'enfant est d'un
intérêt économique immédiat, c'est-à-dire lors-
qu'il
ors
qu'il peut travailler très jeune.
En Occident, les
enfants sont dépendants de leurs parents beau-
coup plus longtemps.
C'est donc la deuxième
solution qui est généralement adoptée.
La puberté
Lors de cette nouvelle phase, les enfants décou-
vrent qu'ils doivent se plier aux nombreuses règles
imposées par la société.
C'est une ((initiation »
s
)
de se renforcer avec les années.
L'attitude adop-
tée par telle ou telle société vis-à-vis de l'allaite-
ment, notamment, est révélatrice et joue un rôle
déterminant dans l'attachement de l'enfant à sa
mère.
Ainsi, tandis que les femmes Arapesh de
Nouvelle-Guinée nourrissent leurs enfants dès
qu'ils ont faim, les Alorese d'Indonésie semblent
n'y attacher aucune importance.
Les enfants ne
sont pas allaités par leur mère, qui retourne tra-
vailler deux semaines après l'accouchement,
mais par n'importe quelle femme du village.
La durée de l'allaitement diffère également.
En Occident, on commence à sevrer progressive-
ment les enfants dès l'âge de quatre ou cinq
mois, ce qui n'est pas le cas dans toutes les socié-
tés.
En Afrique du Sud, par exemple, un enfant
bantou n'est pas sevré avant l'âge de deux ou
trois ans.
Parfois, on encourage même le sevrage
en utilisant des artifices.
Ainsi, chez les Ngoni du
Kenya, on recouvre le sein de la mère d'une pâte
au piment.
Une fois que l'enfant l'a senti, on lui
fait comprendre qu'il ne doit plus y toucher.
Les enfants apprennent à contrôler leurs fonc-
tions intestinales et urinaires pendant la petite
enfance.
Une fois encore, l'âge auquel ils y par-
viennent diffère sensiblement d'une société à
l'autre.
Chez les Tonola de Madagascar, ce contrô-
le se produit dès l'âge de six mois, alors que dans
de nombreuses autres sociétés il faut normale-
ment attendre entre quinze et dix-huit mois.
Durant cette période, la société commence à
exercer des pressions sur l'enfant dans deux
autres domaines.
En ce qui concerne la sexualité
tout d'abord, ce premier conditionnement se
limite à la nécessité de recouvrir les parties géni-
Bar-mitsva
devant le mur
des Lamentations,
à Jérusalem.
Cette
cér
ém
onie symbolise
l'accession à la
majorité religieuse
dans les sociétés
d'obédience juive.
tales par un vêtement.
L'enfant doit d'autre part
apprendre à respecter certaines limites.
Il n'est
plus autorisé à agir à sa guise, ni à se laisser aller
à toutes les émotions qu'il ressent telle la colère
par exemple.
Ces deux contraintes ne vont cesser
de s'amplifier au cours de la phase suivante.
La prépuberté
L'enfant entre alors dans la période qui précède
la puberté.
C'est à ce moment qu'il reçoit une
éducation visant à lui inculquer un certain savoir-
faire, ainsi, qu'assez souvent, les règles générales
de comportement en vigueur dans la société où
il vit.
Selon la nature de cette dernière, l'accent
est mis sur des compétences pratiques, comme la
chasse, tandis que, dans d'autres, on n'attache
d'importance qu'à son développement intellec-
tuel et à son insertion sociale.
Durant cette période, l'éducation commence:
dans les sociétés instruites, l'école est rendue
obligatoire.
Dans les autres, on accorde un plus
grand intérêt aux aptitudes pratiques qui ont une
utilité immédiate et contribuent à la subsistance
de la communauté.
On enseigne également aux
enfants les règles du comportement social.
Ainsi,
indispensable car toutes les sociétés n'attendent
pas la même chose des enfants qui atteignent la
puberté.
Ces derniers doivent accepter de quitter
l'enfance, et même être prêts à endurer certains
rites éprouvants.
La puberté est une étape importante car les
adolescents ont désormais la possibilité de se
reproduire, ce qui modifie fondamentalement
leur statut dans la société.
Ce processus est parti-
culièrement flagrant chez les jeunes filles, qui
voient apparaître leurs premières menstruations.
En Occident, cette transformation physiologique
n'est guère célébrée.
Dans d'autres régions du
globe, en revanche, la puberté féminine donne
lieu à des cérémonies d'initiation préfigurant le
moment où les jeunes filles accéderont à l'âge
adulte.
Chez les Nayar de l'Inde du Sud, l'initia-
tion implique la participation à un mariage ((fac-
tice ».
De multiples cérémonies auxquelles partici-
pent les jeunes filles présagent leur futur mariage
ou leur rôle familial.
Chez les Bemba de Zambie,
les jeunes filles subissent une cérémonie appelée
chisungu,
qui peut durer un mois, parfois davanta-
ge.
Accompagnée de chants et de danses, celle-ci
met en scène les diverses situations auxquelles
seront confrontées les femmes au cours de leur
458.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIE DE LA RAISON (LA), ou les Phases du progrès humain, George Santayana
- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes
- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)