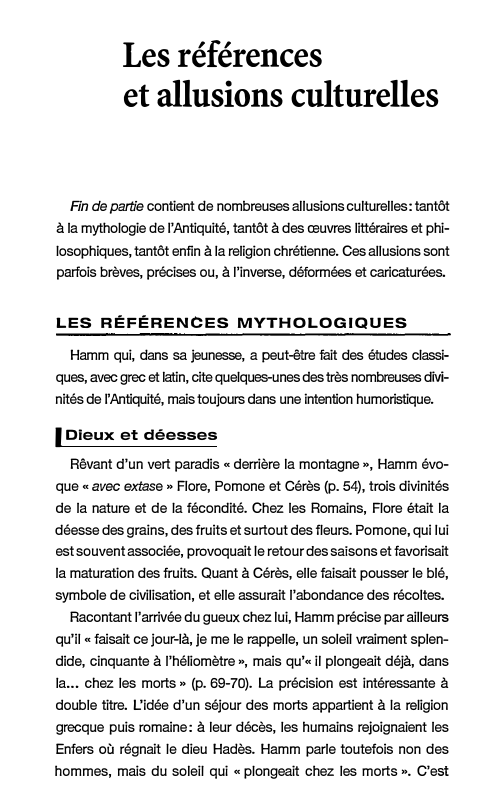Les références et allusions culturelles Rn de partie contient de nombreuses allusions culturelles: tantôt à la mythologie de !'Antiquité, tantôt...
Extrait du document
«
Les références
et allusions culturelles
Rn de partie contient de nombreuses allusions culturelles: tantôt
à la mythologie de !'Antiquité, tantôt à des œuvres littéraires et phi
losophiques, tantôt enfin à la religion chrétienne.
Ces allusions sont
parfois brèves, précises ou, à l'inverse, déformées et caricaturées.
LES RÉFÉRENCES MYTHOLOGIQUES
Hamm qui, dans sa jeunesse, a peut-être fait des études classi
ques, avec grec et latin, cite quelques-unes des très nombreuses dM
nités de !'Antiquité, mais toujours dans une intention humoristique.
1 Dieux et déesses
Rêvant d'un vert paradis « derrière la montagne», Hamm évo
que « avec extase» Flore, Pomone et Cérès (p.
54), trois divinités
de la nature et de la fécondité.
Chez les Romains, Flore était la
déesse des grains, des fruits et surtout des fleurs.
Pomone, qui lui
est souvent associée, provoquait le retour des saisons et favorisait
la maturation des fruits.
Quant à Cérès, elle faisait pousser le blé,
symbole de civilisation, et elle assurait l'abondance des récoltes.
Racontant l'arrivée du gueux chez lui, Hamm précise par ailleurs
qu'il « faisait ce jour-là, je me le rappelle, un soleil vraiment splen
dide, cinquante à l'héliomètre», mais qu'« il plongeait déjà, dans
la••• chez les morts» (p.
69-70).
La précision est intéressante à
double titre.
L'idée d'un séjour des morts appartient à la religion
grecque puis romaine: à leur décès, les humains rejoignaient les
Enfers où régnait le dieu Hadès.
Hamm parle toutefois non des
hommes, mais du soleil qui « plongeait chez les morts».
C'est
également une formule antique.
Convaincus que le Soleil tournait
autour de la Terre, les Anciens pensaient que le Soleil mourait
chaque soir pour renaître chaque matin.
1Des références humoristiques
Inattendues, ces allusions créent un effet de surprise amusée.
Au milieu de la pénurie générale que connaît le refuge, l'évocation
des déesses de l'abondance est une forme d'humour noir.
Pas plus
que Clov, Hamm ne croit en effet à leur existence, et encore moins
à leur domiciliation de l'autre côté de la montagne.
C'est pour lui
une manière de se moquer de la disette dont ils sont victimes.
Quant au séjour des morts, sa mention est tout aussi humoristique.
D'abord parce qu'en voisinant dans la même phrase avec
«
l'héliomètre », elle provoque un anachronisme 1 : l'héliomètre 2
est en effet une lunette qui fut inventée seulement au xv111• siècle.
Ensuite parce que Hamm ne croit sûrement pas que le Soleil descende chez les morts.
Celui-ci joue avec ses souvenirs scolaires
ou de lecture.
Mais comme ces souvenirs sont sans rapport avec
le contexte, ils prennent aussitôt une coloration comique.
LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
Les références et les emprunts aux œuvres littéraires sont à
la fois plus fréquents et plus divers.
L'intention parodique 3 y est
souvent évidente.
1Une parodie de la littérature anglaise
Exaspéré par le bavardage de ses parents, Hamm s'écrie:
«
Mon royaume pour un boueux!
»
(p.
36).
Par son exagération,
1.
Anachronisme : confusion de dates entre ce qui appartient à une époque et ce qui
appartient à une autre.
2.
Hamm semble ici confondre l'héliomè!re avec le them1omètre.
Inventé au XVIII' siècle,
l'héliomètre était une lunette servant à mesurer le diamètre apparent des corps célestes
Qe soleil, la lune, les planètes).
3.
Parodie : imitation volontairement maladroite, caricaturale.
62
PROBLÉMATIQUES
ESSENTIELLES
l'exclamation fait sourire.
Son " royaume » n'est en effet qu'un
refuge étroit, dénué de toutes ressources.
Hamm dit pourtant
qu'il est prêt à le donner contre les services d'un
«
boueux », d'un
éboueur, qui le débarrasserait des poubelles où croupissent Nell
et Nagg.
La réaction est cruelle, mais la forme en est comique par
le contraste existant entre " royaume » et
«
boueux ».
Surtout l'exclamation parodie le cri tragique d'un personnage
de Shakespeare 1, Richard Ill.
Dans la pièce qui porte son nom, ce
tyran sanguinaire affronte une révolte, conduite par Richmond, le
futur roi Henri VII.
Une bataille se livre à Bosworth.
Désarçonné,
Richard Ill en est réduit à combattre à pied et, avant de mourir,
s'écrie:" Un cheval! Mon royaume pour un cheval!».
Le contexte
et les enjeux sont tout autres.
Le cri de Hamm en est l'écho volontairement déformé, dérisoire et burlesque.
1Une parodie de la littérature française
" Pas plus haut que le cul » (p.
108), constate Hamm dans son
dernier monologue.
Familière, l'expression appartient au registre
de la farce, qui ne recule devant aucune grossièreté.
Elle est
aussi une reprise, mais dans un tout autre sens, d'une phrase de
Montaigne 2 , qui écrit à la fin de ses Essais: " Et au plus élevé trône
du monde, si ne sommes assis que sur notre cul», c'est-à-dire:
même si nous étions sur le trône le plus élevé du monde, nous
serions toujours assis sur notre cul.
Montaigne veut par là donner
aux plus puissants ou aux plus ambitieux une leçon d'humilité.
Ce
n'est évidemment pas l'intention de Hamm, qui veut simplement
dire que rien n'est important, comme le prouve le commentaire
qu'il fait ensuite:" Paix à nos ...
fesses.»
1.
Dramaturge anglais, Shakespeare (1564-1616) est l'auteur de nombreuses tragédies
dont Richard Ill (1592).
2.
Écrivain français, Montaigne (1533-1592) est l'auteur des Essais dont la première
édition date de 1580.
PROBLÉMATIQUES
ESSENTIELLES
63
Hamm cite par ailleurs Baudelaire lorsqu'il dit: « Tu RÉCLAMAIS
le soir; il vient - (Un temps.
Il se corrige.) Il DESCEND: le voici.
(//
reprend, très chantant.) Tu réclamais le soir; il descend: le voici»
(p.
109).
Or Baudelaire a écrit dans son sonnet intitulé « Recueillement1 »:
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici
C'est l'expression élégiaque de la fuite du temps.
Hamm se
moque de son emprunt au poète en ajoutant aussitôt après:« Joli
ça».
Ce n'est pour lui qu'une formule creuse.
1Des références philosophiques
«
Instants sur instants, plouff, plouff, comme les grains de mil
de ...
(il cherche) ...
ce vieux Grec, et toute la vie on attend que
ça vous fasse une vie» (p.
91).
Ce « vieux Grec » dont Hamm ne
retrouve pas le nom est vraisemblablement Zénon d'Élée (vers 490
av.
J.-C.), resté célèbre pour ses paradoxes: selon lui un grain de
blé n'étant pas en soi un tas, une accumulation de grains ne peut
donc pas faire un tas (puisqu'on ne peut pas faire un tas avec une
somme de ce qui n'est pas déjà des petits tas).
C'est probablement
aussi à ce paradoxe que se réfère Clov au début de la pièce lorsqu'il déclare:« Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour,
soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas 2
»
(p.
13-14).
Les rapports de maître à esclave que Hamm entretient avec Clov
peuvent par ailleurs faire songer à la dialectique 3 de Hegel (1770-
1831).
Selon ce philosophe allemand, tout individu est animé par le
désir (principe de domination) et par la peur de la mort (principe de
1.
Ce sonnet de Baudelaire (1821-1867) figure dans le recueil Les Reurs du mal (1857).
2.
C'est nous qui soulignons.
3.
La dialectique est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓