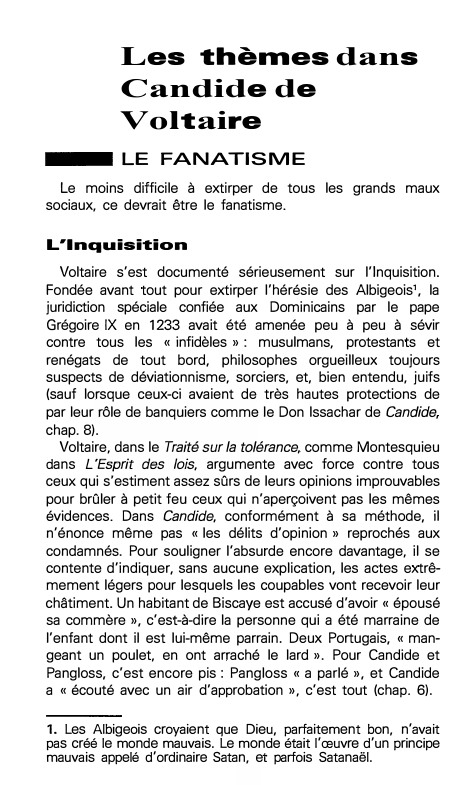Les thèmes dans Candide de Voltaire LE FANATISME Le moins difficile à extirper de tous les grands maux sociaux, ce...
Extrait du document
«
Les thèmes dans
Candide de
Voltaire
LE FANATISME
Le moins difficile à extirper de tous les grands maux
sociaux, ce devrait être le fanatisme.
L'inquisition
Voltaire s'est documenté sérieusement sur l'inquisition.
Fondée avant tout pour extirper l'hérésie des Albigeois', la
juridiction spéciale confiée aux Dominicains par le pape
Grégoire IX en 1233 avait été amenée peu à peu à sévir
contre tous les « infidèles » : musulmans, protestants et
renégats de tout bord, philosophes orgueilleux toujours
suspects de déviationnisme, sorciers, et, bien entendu, juifs
(sauf lorsque ceux-ci avaient de très hautes protections de
par leur rôle de banquiers comme le Don lssachar de Candide,
chap.
8).
Voltaire, dans le Traité sur la tolérance, comme Montesquieu
dans L 'Esprit des lois, argumente avec force contre tous
ceux qui s'estiment assez sûrs de leurs opinions improuvables
pour brûler à petit feu ceux qui n'aperçoivent pas les mêmes
évidences.
Dans Candide, conformément à sa méthode, il
n'énonce même pas « les délits d'opinion» reprochés aux
condamnés.
Pour souligner l'absurde encore davantage, il se
contente d'indiquer, sans aucune explication, les actes extrê
mement légers pour lesquels les coupables vont recevoir leur
châtiment.
Un habitant de Biscaye est accusé d'avoir « épousé
sa commère», c'est-à-dire la personne qui a été marraine de
l'enfant dont il est lui-même parrain.
Deux Portugais, « man
geant un poulet, en ont arraché le lard».
Pour Candide et
Pangloss, c'est encore pis: Pangloss « a parlé», et Candide
a « écouté avec un air d'approbation », c'est tout (chap.
6).
1.
Les Albigeois croyaient que Dieu, parfaitement bon, n'avait
pas créé le monde mauvais.
Le monde était l'œuvre d'un principe
mauvais appelé d'ordinaire Satan, et parfois Satanaël.
La charge paraît grosse, mais Voltaire est sûr que ses
lecteurs le suivront.
Une Relation de /'Inquisition de Goa, de
Dellon, une Histoire de /'Inquisition, de Marsollier, avaient
paru en France et en Allemagne à la fin du xvue siècle et la
première, en tout cas, avait été très souvent réimprimée.
On
savait donc que les règlements de !'Inquisition portaient
effectivement : il faut dénoncer celui « qui retire de la chair
des animaux dont il se nourrit le suif ou la graisse » car c'est
une preuve qu'il observe les commandements de la loi
mosaïque, qu'il «judaïse».
On savait que l'Église interdisait,
sauf dérogation spéciale, le mariage entre le parrain et la
marraine d'un même enfant (l'intrigue de L 'Ingénu reposera
en grande partie sur cette prescription).
On savait enfin que
la procédure judiciaire des inquisiteurs était absolument
secrète, que les dénonciations étaient permises et recommandées, que des « familiers » avaient mission de détecter
les suspects, etc.
: « Pour encourir le soupçon d'hérésie, dit
Marsollier, il ne faut qu'avancer quelque proposition qui
scandalise ceux qui l'entendent, ou même ne pas déclarer
ceux qui en avancent de pareilles.
» Le lecteur de Candide
comprend donc facilement ici les quatre motifs de condamnation, y compris ceux de Pangloss et de Candide.
Pangloss
a avancé une proposition scandaleuse, entraînant objectivement, selon les inquisiteurs, la négation du péché originel ;
Candide ne l'a pas dénoncé ; ils sont coupables (chap.
6)1.
L'auto-da-fé
De même, pour le récit de I' Auto-da-fé (Acte de foi,
cérémonie solennelle de jugement et de réparation destinée
à affermir la foi), Voltaire suit d'extrêmement près le texte
et surtout les planches du livre de Dellon2 : « Ceux qui sont
tenus pour convaincus [c'est-à-dire qui n'acceptent pas de
faire leur confession, leur « autocritique »l portent une (...
)
espèce de scapulaire, appelé samarra, où le portrait du patient
est représenté au naturel, devant et derrière, posé sur des
tisons embrasés avec des flammes qui s'élèvent et des
démons tout à l'entour (.
..
) Mais ceux qui s'accusent et ne
sont pas relaps portent sur leurs samarras des flammes
renversées la pointe en bas.
» Dellon parle aussi des « bonnets
!
1
1.
Cf.
p.
23-24.
2.
Cf.
ci-dessus.
4-'I
de carton » des condamnés, « élevés en pointe à la façon
d'un pain de sucre, tout couverts de diables et de flammes
de feu »...
Même « les rafraîchissements» qui sont servis à
Cunégonde et aux dames « entre la messe et l'exécution»
(chap.
8) trouvent leur origine dans une autre notation du
même témoignage : la cérémonie étant fort longue, « il n'y
eut personne qui ne mangeât ce jour-là dans l'église»,
rapporte Dellon.
Appuyé sur de tels documents, connus, je le répète, d'une
bonne partie de ses lecteurs, Voltaire peut se permettre de
corser la présentation générale, et tout de même d'inventer
quelque peu - toujours en vue de souligner l'absurde :
Après le tremblement de terre qui avait détruit les "trois
quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas
trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine
totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé ; il était
décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de
quelques personnes brûlées à petit feu, en grande
cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la
terre de trembler (...
) Le même jour, la terre trembla de
nouveau avec un fracas épouvantable (chap.
6).
En réalité, la terre trembla bien une seconde fois, en
décembre 1755, mais sans qu'il y ait eu autodafé.
On en
célébra un seulement le 20 juin 1756, puis de nouveau en
1757 et 1758, et certains fidèles superstitieux purent croire
sans doute que de telles cérémonies leur vaudraient la
clémence divine, mais les « sages du pays», en particulier
les théologiens de la très célèbre université de Coïmbre,
n'affirmèrent pas que c'était là un moyen très efficace pour
prévenir les secousses sismiques...
Enfin et surtout, il n'y
eut pas ces années-là au Portugal, semble-t-il, d'exécution de
condamné.
La dernière sentence de mort prononcée par
l'inquisition le fut en 1783, en Espagne1.
De la fiction à la réalité
Voltaire peut encore ici, dans tout le chapitre, conserver
volontairement un ton dénonciateur certes, mais d'une très
franche gaieté.
Il ne se doute pas que sept ans plus tard, le
1.
L'inquisition y fut supprimée en 1808 par Napoléon 1°• installé
en Espagne, rétablie aussitôt après sa chute en 1814, supprimée
définitivement en 1834.
42
l
l ~ .-
4 juin 1766, en France même, à Abbeville, un tribunal qui
n'était pas d'inquisition allait condamner le chevalier de La
Barre1 et son compagnon Gaillard d'Étallonde2 à faire amende
honorable de leurs impiétés devant le porche de la cathédrale
Saint-Wolfram, pour, ensuite, avoir la langue coupée, être
décapités et leurs corps jetés au feu 3 • Voltaire avait cru dans
Candide écrire une somme de tous les maux de son temps.
La réalité dépassa la fiction.
Le chevalier de La Barre ayant
déclaré qu'il se défendrait jusqu'au bout si on essayait de lui
couper la langue, on y renonça en fin de compte - pour ne
pas troubler le spectacle ! Il fut décapité devant une grande
foule par le même bourreau qui venait de décapiter à Paris,
tellement maladroitement qu'il lui fallut s'y reprendre à
plusieurs fois, l'innocent Lally-Tollendal.
LA GUERRE
,
t
Voltaire va parvenir aussi à rire de la guerre.
Mais, cette
fois, ce n'est plus le rire de la gaieté, c'est le rire « grinçant»
évoqué par Flaubert.
Sur les cent années du xvme siècle,
l'Europe en a connu quatre-vingts de conflits - non pas
même pour la plupart de ces conflits idéologiques, sociaux
ou nationaux pour lesquels les hommes peuvent estimer qu'il
vaut la peine de tuer et de mourir, défendant une liberté ou
des bases de justice politique et sociale élémentaire sans
lesquelles la vie leur paraît indigne, mais des conflits d'intérêts
sordides quand ce n'était pas de simple vanité dynastique,
menés par des armées en grande partie mercenaires et
auxquels les peuples n'étaient guère intéressés que pour
souffrir.
Pendant la décade qui précède Candide, les alliances
changent complètement : en 1748, la France combattait avec
la Prusse contre l'Autriche; en 1756, elle combat avec
l'Autriche contre la Prusse.
La Suède, l'Allemagne, la Bohême
sont à feu et à sang ; partout des combats, sur mer, aux
Indes, aux Amériques.
1.
Il avait vingt ans.
2.
Celui-ci par contumace, heureusement; il avait réussi à s'enfuir.
Voltaire obtiendra que Frédéric Il l'accueille en Prusse.
3.
L'arrêt intégral, avec les attendus, a été publié par le Courrier
rationaliste (1963, p.
179).
43
Voltaire, qui a des correspondants presque dans chaque
pays, n'ignore rien de ces horreurs.
La duchesse de SaxeGotha lui écrit le 7 juin 1757: « Les ruisseaux de sang
humain qui inondent les champs de bataille et les gémissements de tant d'expirants me font horreur.
La ville de Prague
(.
..
) se rendra à coup sûr, si elle n'est pas consumée par les
flammes.»
Mais la duchesse de Saxe-Gotha ne demeure pas moins
fervente leibnizienne.
Voltaire en est stupéfait.
Toutes ses
lettres de cette époque retentissent au contraire de sa double
indignation, contre les massacres, et contre la « philosophie »
qui prétend les expliquer, les faire accepter :
On ne peut pas dire encore : tout est bien ; mais cela
ne va pas mal, et avec le temps l'optimisme sera
démontré.
Tout est bien, tout est mieux que jamais, voilà deux ou
trois cent mille animaux à deux pieds qui vont s'égorger
pour cinq sous par jour'.
La rage de Voltaire contre « cette boucherie héroïque »
(chap.
3) est à la source même de Candide.
Les hommes
osent faire de la littérature2 et de la musique avec des
cadavres qu'ils accumulent ; ils chantent avant et après les
combats, à la gloire des tueurs (chap.
3).
Voltaire souligne la complicité de l'Église dans ces
massacres.
« Les deux rois faisaient chanter des Te deum, chacun
dans son camp.
» Voltaire dénoncera à plusieurs reprises
cette absurdité plus scandaleuse encore que toutes les autres,
dont un homme comme Bossuet ne semblait même pas
prendre conscience :
Le merveilleux de cette entreprise infernale, c'est que
chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux et
invoque Dieu solennellement avant d'aller exterminer son
prochain.
Si un chef n'a eu que le bonheur de faire
égorger deux ou trois mille hommes, il n'en remercie
point Dieu ; mais lorsqu'il y en a eu environ dix mille
d'exterminés par le feu et par le fer, et que, pour comble
1.
Lettres de 1756, 1757, 1758, passim.
2.
Voltaire lui-même en a fait, et de la plus mauvaise, avec son
poème de la bataille de Fontenoy.
Ici encore, Candide est écrit
avec ses souvenirs.
44
l
~
j
11
r
t
de grâce, quelque ville a été détruite de fond en comble,
alors on chante à quatre parties une chanson assez
longue, composée dans une langue inconnue à tous ceux
qui ont combattu, et de plus toute farcie de barbarismes'.
Dans Candide, comme toujours, le texte est plus bref, plus
réaliste.
Énoncer le scandale est suffisant.
La mention des
Te deum tient en une ligne.
Voltaire se contente de dépeindre
ce qui est, sans craindre les clichés ni les accusations de
mauvais goût :
Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs
femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs
mamelles sanglantes ; là des filles éventrées après avoir
assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient
les derniers soupirs; d'autres, à demi brûlées, criaient
qu'on achevât de leur donner la mort.
Des cervelles
étaient répandues sur la terre à côté de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓