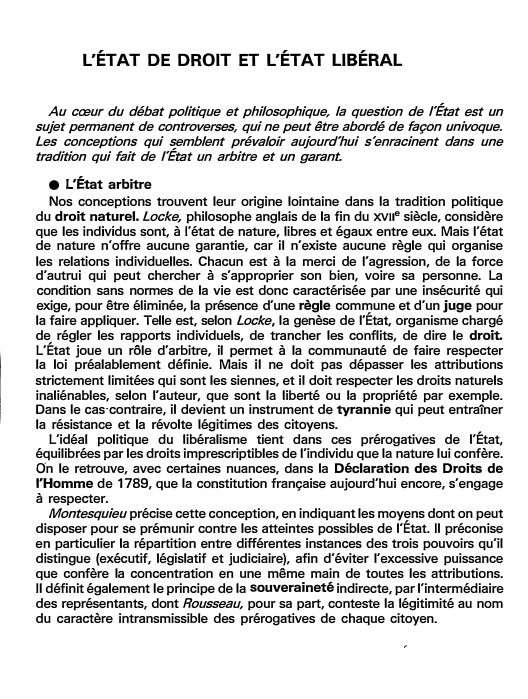L'ÉTAT DE DROIT ET L'ÉTAT LIBÉRAL Au cœur du débat politique et philosophique, la question de l'État est un sujet...
Extrait du document
«
L'ÉTAT DE DROIT ET L'ÉTAT LIBÉRAL
Au cœur du débat politique et philosophique, la question de l'État est un
sujet permanent de controverses, qui ne peut être abordé de façon univoque.
Les conceptions qui semblent prévaloir aujourd'hui s'enracinent dans une
tradition qui fait de l'État un arbitre et un garant.
• L'État arbitre
Nos conceptions trouvent leur origine lointaine dans la tradition politique
du droit naturel.
Locke, philosophe anglais de la fin du xvue siècle, considère
que les indMdus sont, à état de nature, libres et égaux entre eux.
Mais l'état
de nature n'offre aucune garantie, car il n'existe aucune règle qui organise
les relations individuelles.
Chacun est à la merci de l'agression, de la force
d'autrui qui peut chercher à s'approprier son bien, voire sa personne.
La
condition sans normes de la vie est donc caractérisée par une insécurité qui
exige, pour être éliminée, la présence d'une règle commune et d'un juge pour
la faire appliquer.
Telle est, selon Locke, la genèse de l'État, organisme chargé
de régler les rapports individuels, de trancher les conflits, de dire le droit.
L'État joue un rôle d'arbitre, il permet à la communauté de faire respecter
la loi préalablement définie.
Mais il ne doit pas dépasser les attributions
strictement limitées qui sont les siennes, et il doit respecter les droits naturels
inaliénables, selon l'auteur, que sont la liberté ou la propriété par exemple.
Dans le cas-contraire, il devient un instrument de tyrannie qui peut entraîner
la résistance et la révolte légitimes des citoyens.
L'idéal politique du libéralisme tient dans ces prérogatives de l'État,
équilibrées par les droits imprescriptibles de l'individu que la nature lui confère.
On le retrouve, avec certaines nuances, dans la Déclaration des Droits de
l'Homme de 1789, que la constitution française aujourd'hui encore, s'engage
à respecter.
Montesquieu précise cette conception, en indiquant les moyens dont on peut
disposer pour se prémunir contre les atteintes possibles de l'État.
Il préconise
en particulier la répartition entre différentes instances des trois pouvoirs qu'il
distingue (exécutif, législatif et judiciaire), afin d'éviter l'excessive puissance
que confère la concentration en une même main de toutes les attributions.
Il définit également le principe de la souveraineté indirecte, par l'intermédiaire
des représentants, dont Rousseau, pour sa part, conteste la légitimité au nom
du caractère intransmissible des prérogatives de chaque citoyen.
r
Dans les deux cas, cependant, la souveraineté tire son origine, au moins
en théorie, de la volonté librement exprimée par la collectité.
Elle s'oppose
aux conceptions absolutistes qui octroient au souverain une légitimité
transcendante, indépendante des sujets sur lesquels elle s'exerce.
• Critique de l'État libéral
La....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓