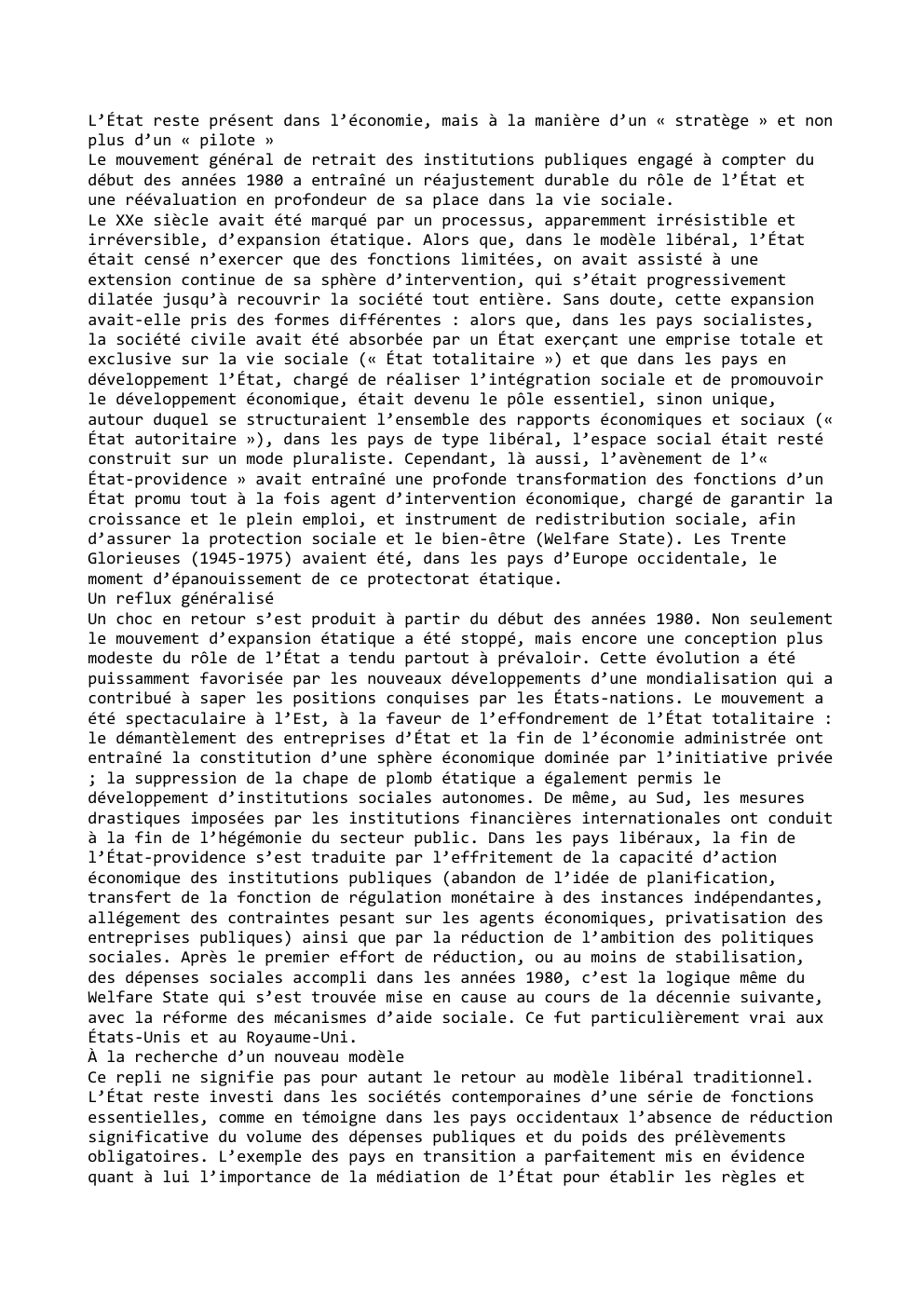L’État reste présent dans l’économie, mais à la manière d’un « stratège » et non plus d’un « pilote »...
Extrait du document
«
L’État reste présent dans l’économie, mais à la manière d’un « stratège » et non
plus d’un « pilote »
Le mouvement général de retrait des institutions publiques engagé à compter du
début des années 1980 a entraîné un réajustement durable du rôle de l’État et
une réévaluation en profondeur de sa place dans la vie sociale.
Le XXe siècle avait été marqué par un processus, apparemment irrésistible et
irréversible, d’expansion étatique.
Alors que, dans le modèle libéral, l’État
était censé n’exercer que des fonctions limitées, on avait assisté à une
extension continue de sa sphère d’intervention, qui s’était progressivement
dilatée jusqu’à recouvrir la société tout entière.
Sans doute, cette expansion
avait-elle pris des formes différentes : alors que, dans les pays socialistes,
la société civile avait été absorbée par un État exerçant une emprise totale et
exclusive sur la vie sociale (« État totalitaire ») et que dans les pays en
développement l’État, chargé de réaliser l’intégration sociale et de promouvoir
le développement économique, était devenu le pôle essentiel, sinon unique,
autour duquel se structuraient l’ensemble des rapports économiques et sociaux («
État autoritaire »), dans les pays de type libéral, l’espace social était resté
construit sur un mode pluraliste.
Cependant, là aussi, l’avènement de l’«
État-providence » avait entraîné une profonde transformation des fonctions d’un
État promu tout à la fois agent d’intervention économique, chargé de garantir la
croissance et le plein emploi, et instrument de redistribution sociale, afin
d’assurer la protection sociale et le bien-être (Welfare State).
Les Trente
Glorieuses (1945-1975) avaient été, dans les pays d’Europe occidentale, le
moment d’épanouissement de ce protectorat étatique.
Un reflux généralisé
Un choc en retour s’est produit à partir du début des années 1980.
Non seulement
le mouvement d’expansion étatique a été stoppé, mais encore une conception plus
modeste du rôle de l’État a tendu partout à prévaloir.
Cette évolution a été
puissamment favorisée par les nouveaux développements d’une mondialisation qui a
contribué à saper les positions conquises par les États-nations.
Le mouvement a
été spectaculaire à l’Est, à la faveur de l’effondrement de l’État totalitaire :
le démantèlement des entreprises d’État et la fin de l’économie administrée ont
entraîné la constitution d’une sphère économique dominée par l’initiative privée
; la suppression de la chape de plomb étatique a également permis le
développement d’institutions sociales autonomes.
De même, au Sud, les mesures
drastiques imposées par les institutions financières internationales ont conduit
à la fin de l’hégémonie du secteur public.
Dans les pays libéraux, la fin de
l’État-providence s’est traduite par l’effritement de la capacité d’action
économique des institutions publiques (abandon de l’idée de planification,
transfert de la fonction de régulation monétaire à des instances indépendantes,
allégement des contraintes pesant sur les agents économiques, privatisation des
entreprises publiques) ainsi que par la réduction de l’ambition des politiques
sociales.
Après le premier effort de réduction, ou au moins de stabilisation,
des dépenses sociales accompli dans les années 1980, c’est la logique même du
Welfare State qui s’est trouvée mise en cause au cours de la décennie suivante,
avec la réforme des mécanismes d’aide sociale.
Ce fut particulièrement vrai aux
États-Unis et au Royaume-Uni.
À la recherche d’un nouveau modèle
Ce repli ne signifie pas pour autant le retour au modèle libéral traditionnel.
L’État reste investi dans les sociétés contemporaines d’une série de fonctions
essentielles, comme en témoigne dans les pays occidentaux l’absence de réduction
significative du volume des dépenses publiques et du poids des prélèvements
obligatoires.
L’exemple des pays en transition a parfaitement mis en évidence
quant à lui l’importance de la médiation de l’État pour établir les règles et
institutions, fournir les biens et services nécessaires au bon fonctionnement de
l’économie de marché.
Tout se passe en fait comme si l’on assistait à la
construction d’un nouveau modèle d’État qui est -à la différence de l’État
libéral du passé - fortement présent dans la vie sociale, mais dont les formes
d’intervention se trouvent profondément modifiées.
Après en avoir critiqué les
excès, la réhabilitation du rôle de l’État par la Banque mondiale dans son
rapport....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓