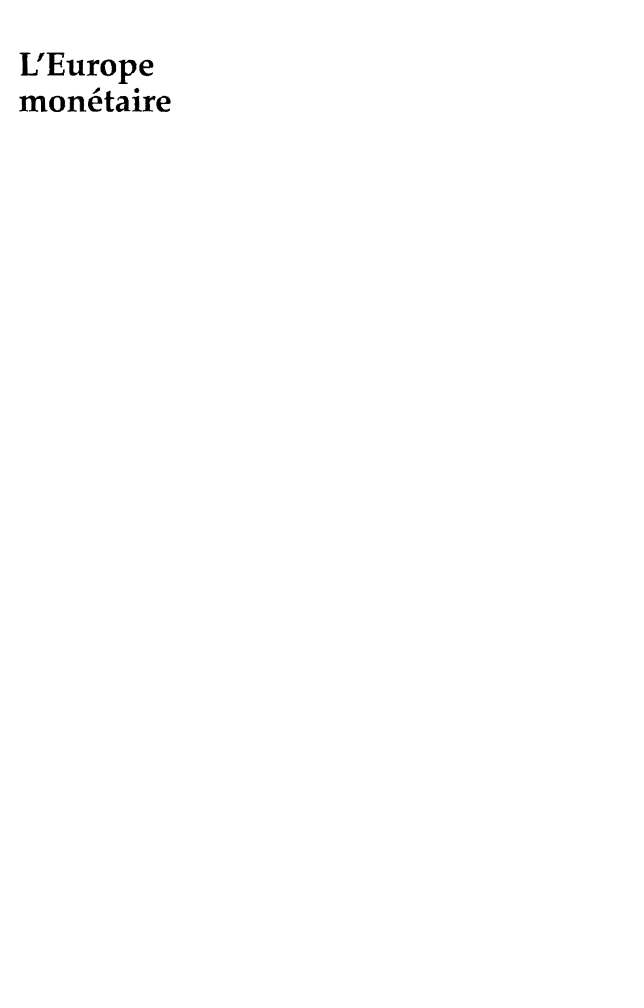L'Europe monétaire 1. Les connaissances indispensables - -:,:,: :-:-:-_.:.: . .: ;: -.,:;:_~~,: ,::,-~,.__ ~~=~ .-1 1.1. Définitions 1.1.1. L'Union...
Extrait du document
«
L'Europe
monétaire
1.
Les connaissances
indispensables
- -:,:,: :-:-:-_.:.: .
.: ;: -.,:;:_~~,: ,::,-~,.__
~~=~
.-1
1.1.
Définitions
1.1.1.
L'Union monétaire européenne
L'Union monétaire correspond à un des stades les plus avancés de l'intégration économique entre plusieurs États-nations ou régions.
Une Union
monétaire comporte trois caractéristiques principales : convertibilité totale
entre les monnaies qui participent à l'Union, liberté des mouvements de
capitaux, taux de change fixes entre les monnaies de l'Union.
1.1.2.
Les critères de convergence
La convergence des économies européennes est jugée à l'aune de plusieurs
«seuils», fixés par le traité de Maastricht pour déterminer le nombre de pays
pouvant participer au processus de monnaie unique européenne.
Les onze
pays, qui, depuis le Sommet de Bruxelles des 2 et 3 mai 1998, participent en
1999 à ce processus, ne satisfont pas à tous les seuils.
Il s'agit d'abord de deux seuils visant la situation des finances publiques :
la dette publique brute ne doit pas excéder 60 % du PIB et le déficit des
administrations publiques pas plus de 3 % du PIB.
Deux autres seuils concernent l'inflation.
Le taux d'inflation des pays
participant à la monnaie unique ne doit pas excéder de plus de 1,5 % les
performances des trois pays qui obtiennent les meilleurs résultats en matière
d'inflation et le niveau des taux d'intérêt à long terme pas plus de 2 %.
Les
taux d'intérêt à long terme sont des indicateurs qui révèlent l'opinion portée
par les marchés financiers sur la situation économique des pays.
Enfin, le critère concernant la fixité des taux de change perd toute actualité puisque le Conseil de l'Union a fixé de manière irrévocable les parités
bilatérales entre les monnaies qui feront partie de l'UEM (Union économique
et monétaire).
1.1.3.
L'Euro et l'«Euroland»
Le lancement de la monnaie unique europénne, l'Euro, intervenu le 1er janvier
1999, constitue l'achèvement d'un processus entamé avec les accords de
change entre les pays de l'Union monétaire pendant les années soixante-dix :
Serpent puis SME qui tendent à rétablir une fixité des changes.
Il constitue
aussi une rupture dans la mesure où la monnaie unique représente, au moins
symboliquement, l'émergence d'une souveraineté nationale européenne.
Cependant, le processus n'est pas irréversible.
La solidité de la monnaie
unique est soumise à l'épreuve des chocs internes et externes à venir.
Le
terme d' « Euroland» - ou Euro lande - renvoie à la zone géographique constituée par les onze pays qui ont adopté l'euro.
Cet anglicisme, popularisé par
les médias, trouve son origine dans les publications d'économistes de
banques privées anglo-saxonnes.
1.1.4.
Le Système Européen de Banques Centrales (SEBC)
La création du SEBC qui émettra l'Euro (nom donné à la monnaie européenne
lors du Conseil de Madrid en décembre 1995), à partir du 1er janvier 1999, est
l'innovation principale du traité de Maastricht.
Le SEBC se compose d'une
Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États-nations.
La BCE est une véritable Banque centrale.
Ses missions sont définies par
l'article 3 de ses statuts annexés au traité de Maastricht.
Elle détermine et met
en œuvre la politique monétaire de l'Union, elle intervient sur les marchés des
changes en accord avec le Conseil européen, elle détient et gère les réserves de
changes de l'Union, elle veille au bon fonctionnement du système de paiement
de l'Union.
Ses missions sont accomplies pour assurer la stabilité des prix en
Europe et son indépendance par rapport aux pouvoirs politiques européen et
nationaux est garantie par un certain nombre de règles portant sur la désignation de ses dirigeants.
Actuellement, le modèle de la BCE demeure celui de la
Banque centrale allemande.
Toutefois, la BCE n'a pas la légitimité constitutionnelle de cette dernière.
On peut imaginer une évolution vers le modèle de
Banque centrale américaine plus souple dont le contrôle appartient au
Congrès américain et, indirectement, à !'Opinion publique américaine par la
contrainte imposée à la Fed d'un dialogue régulier avec les médias.
Tableau 10 - Critères de convergence (1996-25 mars 1998)
Inflation
(% annuel de variation)
Allemagne*
Autriche*
Belgique*
Danemark
Espagne*
Finlande*
France*
Grèce
Irlande*
Italie*
Luxembourg*
Pays-Bas*
Portugal*
Royaume-Uni
Suède
UE
Moyenne
des trois pays
les plus perfonnants
Limite
i
Déficit public
(% duPIB)
Dette publique
(% du PIB)
1996
1998
1996
1998
1996
1,9
2,5
2,3
2,1
3,4
1,6
1,9
8,5
1,1
4,3
1,6
1,3
2,6
2,6
1,2
2,6
1,7
1,5
1,3
3,4
-4,0
=3,2
-0,7
-4,6
-3,3
-4,1
2,5
-2,3
-1,7
2,1
1,6
2,3
2,2
2,3
1,5
1,9
-67
2,5
-2,3
-3,2
-4,8
-2,5
1,0
-1,6
-2,2
-0,6
0,5
1,9
60,4
69,5
126,9
70,6 (!)
70,l
57,6
55,7
111,6
72,7 (])
124,0
6,6
77,2 (1)
65,0
54,7
76,7
73,0
1,2
2,7
1,3
2,8
2,1
2,2
2,0
1,0
1, 1
-2,2
0,3
-2,9
2,2
1,1
*: Participation à la monnaie unique au 01/01/1999.
~·•: Non-respect du critère.
( 1) : Pays écartés de la procédure de déficit public excessif.
Source : Commission, Rapport sur la convergence.
mars l 998.
4,2
-3
-3
60
1998
61,2
64,7
118, 1
59,5
67,4
53,6
58,1
107,7
59,5
ll8,l
7,1
70 (1)
60,0
52,3
74,1
70,5
60
1.2.
Indicateurs
1.2.1.
La puissance économique européenne garantit
sa puissance monétaire
Les onze États qui constituent la zone Euro représentent 290 millions d'habitants.- Ils forment une entité économique comparable, et à certains égards
supérieure, aux États-Unis.
Leur PIB atteint le tiers du PIB de l'Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE).
Ils assurent
plus de 30% de la production mondiale contre 27% pour les États-Unis.
Le taux d'ouverture de cette zone, part des exportations sur le PIB, est
voisin de celui des États-Unis, autour de 12 %.
Si l'on fait abstraction
des échanges intra-européens, la zone euro représente plus de 20 % du
commerce mondial, et les États-Unis, 15 %.
Les taux d'intérêt à long terme
des onze pays sont très proches les uns des autres, reflétant ainsi la croyance
des marchés financiers dans la réalisation de la monnaie unique européenne.
1.2.2.
L'Euro peut devenir une monnaie internationale
Certains indicateurs montrent que l'Euro peut concurrencer le dollar comme
monnaie internationale.
Ainsi, la part du dollar dans les réserves officielles de
devises a baissé depuis les années quatre-vingt (85 %) pour atteindre moins
de 65 % au milieu des années quatre-vingt-dix.
Dans le même temps, la part
du mark a doublé pour dépasser les 15 %.
La loi de Grassman, du nom de
l'économiste qui l'établit en 1973, révèle que les deux tiers environ des exportations d'un grand pays développé, et le tiers de ses importations sont
facturés et réglés dans sa monnaie nationale.
Appliquée à l'échelle de la zone
euro, cette loi fait de l'euro, mécaniquement, la deuxième monnaie mondiale
pour les échanges commerciaux.
L'émergence d'un grand marché financier européen conforte la place de
l'Euro au sein des relations monétaires internationales.
1.2.3.
Les économie européennes tendent vers la convergence
À la fin des années quatre-vingt-dix, les conditions d'ensemble pour une
croissance non inflationniste dans la zone euro sont réunies.
Les indicateurs d'inflation ont baissé dans tous les États.
La France tend
vers l'inflation zéro.
Les taux d'intérêt à long terme ont partout fléchi pour
atteindre des niveaux proches de 5,5 %.
Les finances publiques semblent en
voie d'assainissement.
Le ratio déficit budgétaire sur PIB global de l'Union
est tombé à moins de 2,5 % et le ratio endettement public sur PIB se situe, en
moyenne, à 72 %.
Trois pays dépassent encore les 100%: la Belgique, la Grèce
et l'Italie.
Si les conditions pour une croissance non inflationniste sont
réunies, la croissance n'est pas encore au rendez-vous et le chômage au sein
de l'Union se maintient à de hauts niveaux.
1.3.
Les grandes tendances
1.3.1.
L'intégration économique des pays européens s'est
poursuivie depuis les années cinquante sans que l'espace
économique européen ne cesse d'être une région ouverte
Le chemin vers l'intégration économique et monétaire, depuis la Seconde
Guerre mondiale, a été tracé spontanément par les firmes européennes mais
s'explique aussi par un projet politique volontariste, en particulier de la part
del' Allemagne et de la France.
Cette intégrations' est d'abord faite, jusqu'aux
années soixante-dix, par la libéralisation des échanges de biens dans un
environnement monétaire international dont la stabilité était assurée par les
règles du système de Bretton-Woods.
Cette libéralisation, conçue comme une
voie détournée pour parvenir à une Europe politique, a freiné les tentations
protectionnistes : l'espace économique européen est un espace qui demeure,
jusqu'à présent, ouvert.
L'intégration européenne renvoie aussi aux stratégies des firmes.
Les flux
d'IDE en provenance des États-Unis, pendant les années soixante, ont participé au processus d'intégration.
D'une part, ils ont entraîné des transferts
d'innovations en matière de technologie et de gestion, surtout dans des
branches comme la chimie, la mécanique et l'automobile.
D'autre part, ils ont
stimulé la concurrence des firmes européennes, contraintes d'augmenter la
productivité des facteurs de production.
À partir des années soixante-dix, des
flux d'IDE européens entrent aux États-Unis tandis que se développent
d'importants flux d'IDE intra-européens.
Les inconvénients, sur le commerce....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓