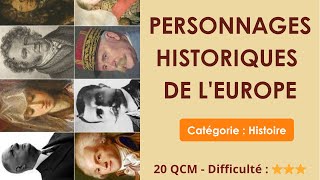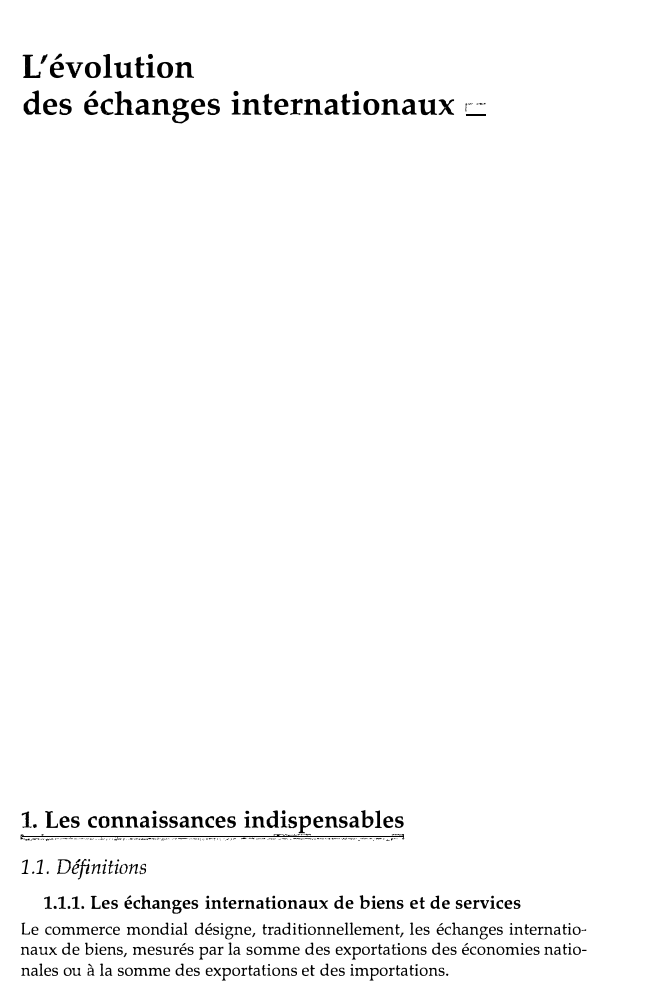L'évolution des échanges internationaux r·- 1. _Les connaissances ---~ indjspensables �- -- -�-�------·�-""'-�- t; _,"_ •'"·�-�----··-� �----�- --·�-,-,- ----�----❖--··�·-··. --�...
Extrait du document
«
L'évolution
des échanges internationaux r·-
1.
_Les connaissances ---~
indjspensables
�- -- -�-�------·�-""'-�-
t;
_,"_ •'"·�-�----··-�
�----�- --·�-,-,- ----�----❖--··�·-··.
--�
--�----·=,
1.1.
Définitions
1.1.1.
Les échanges internationaux de biens et de services
Le commerce mondial désigne, traditionnellement, les échanges internatio
naux de biens, mesurés par la somme des exportations des économies natio
nales ou à la somme des exportations et des importations.
Le commerce extérieur d'un pays ne se limite pas aux seuls échanges de
marchandises mais inclut aussi les échanges de services.
Les marchandises
désignent les biens importés ou exportés et sont comptabilisées dans la
balance commerciale.
Les services peuvent concerner les transports et
assurances, les voyages c'est-à-dire le tourisme, l'audiovisuel et la culture, les
redevances, la communication, la construction, les activités financières, les
autres services aux entreprises comme le négoce international.
Ces importations et exportations de services sont comptabilisées dans le poste «Services»
des transactions courantes.
En comptabilité nationale française, les exportations et les importations de
biens et de services sont enregistrées dans le secteur institutionnel «reste du
monde».
1.1.2.
Échanges inter-branches, intra-branches, intra-firmes
La branche est définie par la comptabilité nationale comme le regroupement
par produits des unités de production.
Les nomenclatures internationales
utilisées permettent de différencier le commerce inter-branche - quand les
exportations n'appartiennent pas aux mêmes branches que les importations et le commerce intra-branche, pour la situation inverse.
Les échanges intra-firmes correspondent aux échanges de produits intermédiaires entre des unités de production appartenant à la même firme.
Ils
peuvent être inter-branches ou intra-branches.
1.1.3.
Les taux d'ouverture et de pénétration permettent
d'apprécier le degré d'ouverture d'une économie
Les notions de taux d'ouverture et de taux de pénétration renvoient aux
rapports entre le commerce extérieur - exportations ou [(exportations plus
importations)/2] - et la valeur ajoutée d'une branche, du PIB ou du PNB
d'une économie nationale ou de l'économie mondiale.
L'évolution du taux d'ouverture de l'économie mondiale révèle un
processus d'ouverture, 15% en 1913, puis de fermeture, moins de 10% en
1945, puis d'ouverture, plus de 15% à la fin des années quatre-vingt-dix.
Les
États-Unis, le Japon et l'Union européenne possèdent un taux d'ouverture
comparable: environ 10%.
Les diverses branches de l'économie mondiale ont
des taux d'ouverture différents : 50 % pour la branche électronique et un peu
plus de 25 % pour la branche automobile.
Le taux de pénétration mesure la part du marché intérieur couverte par
des importations.
On utilise souvent le rapport : Importations/(PIB +
Importations - Exportations).
1.1.4.
Compétitivité et part de marché
La compétitivité d'une firme désigne sa capacité à maintenir ou à augmenter
ses parts de marché soit en vendant à des prix inférieurs à ceux des concurrents (compétitivité prix) soit en disposant d'avantages hors coûts tels que le
service après-vente, la marque, la qualité, l'adaptation à la demande (campé-
titivité structurelle).
La compétitivité prix dépend des coûts salariaux, du
taux de change, du comportement de marge de la firme.
La compétitivité
structurelle permet à la firme d'être «price-maker» (et non «price-taker»),
d'être moins contrainte à la concurrence par les prix.
L'extension de la notion
de compétitivité à l'échelle d'une économie nationale est contestée, notamment par P.
Krugman.
Une nation ne serait pas assimilable à une firme.
Une
firme produit des biens et des services marchands et doit faire des profits.
Peut-on appliquer la même grille à une économie nationale? P.
Krugman
propose de mettre l'accent dans l'étude d'une économie nationale non sur sa
«compétitivité» mais sur la productivité globale de ses facteurs de production.
Néanmoins, la «compétitivité» d'une économie nationale renvoie à ses
capacités à conquérir ou à maintenir des parts de marché et, donc, à ses
spécialisations.
La notion de part de marché permet d'apprécier la compétitivité d'une
firme ou, sous les réserves exprimées plus haut, d'un pays.
La part de marché
mondial d'un pays se mesure par le rapport entre les exportations totales ou
les exportations d'un bien particulier sur les exportations mondiales totales
ou celles d'un bien particulier.
En France, la part de marché mondial se
maintient à 5 ou 6 % depuis les années quatre-vingt.
1.1.5.
Spécialisation et avantages comparatifs
Dans le système d'échanges internationaux développés qui est le nôtre, les
économies nationales ne produisent pas tous les biens et services qui les
rendraient autosuffisantes.
Elles sont spécialisées dans la production de biens
et de services où elles possèdent un avantage comparatif.
Cette spécialisation
demeure partielle et la notion d'avantage comparatif a pris un sens très large.
Elle désigne les biens et services pour lesquels une économie possède des
coûts absolus ou relatifs plus faibles que ceux des autres économies.
L'avantage comparatif peut être «naturel» (ressources du sous-sol, climat
particulier) ou acquis (capital abondant, travail qualifié entre autres).
Les travaux de G.
Lafay au CEPII ont permis d'approfondir la notion de
spécialisation.
Une économie nationale bien spécialisée est une économie qui
dispose d'une bonne spécialisation géographique (exportations orientées vers
les pays qui connaissent une croissance rapide) et d'une spécialisation par
produits correspondant à ses avantages comparatifs.
Il est préférable de se
spécialiser dans les produits à forte valeur ajoutée dont la demande internationale croît rapidement (produits progressifs).
La bonne spécialisation doit
aussi être dynamique : un pays doit être capable de modifier rapidement ses
avantages comparatifs, donc ses structures productives, pour suivre l'évolution de la demande mondiale.
Pour G.
Lafay, il est préférable de dégager de
forts excédents commerciaux dans les produits progressifs et de forts déficits
dans les produits récessifs (produits pour lesquels la demande augmente
moins vite que la demande mondiale).
L'économie française a longtemps été
mal spécialisée tant au niveau sectoriel qu'au niveau géographique et insuffisamment spécialisée (trop de secteurs dégageant de faibles excédents ou de
faibles déficits).
1.1.6.
Globalisation ou mondialisation
Appliqués aux échanges internationaux de biens et de services, les concepts
de globalisation ou de mondialisation désignent un vaste mouvement de
croissance des échanges et d'ouverture des économies dans un contexte de
déréglementation, d'essor des FMN et de concurrence plus vive.
Il peut aussi
désigner la tendance à l'émergence d'un marché mondial.
L'existence d'un tel
marché demeure encore bien contestable.
Sont incontestables par contre les
interdépendances entre économies nationales liées à la mondialisation.
1
Indicateurs
1.2.1.
Les échanges internationaux : montant et croissance
Les exportations mondiales de marchandises représentent, en 1997, près de
5 300 milliards de dollars et les échanges internationaux de services commerciaux près de 1 300 milliards de dollars.
Les exportations mondiales de marchandises ont crû de 9,5% en 1997, ce
qui représente le taux le plus élevé enregistré depuis 1975, sauf en 1994 où il
avait été de 10%.
Le taux de croissance moyen sur la période 1990-1997 est
supérieur à 6 %.
1.2.2.
Les échanges internationaux : structure par produits
On distingue, généralement, les produits primaires des produits manufacturés.
Sur le long terme, l'évolution est impressionnante puisque les produits
primaires représentaient en 1880 près de 64 % des exportations mondiales en
valeur et, encore la moitié en 1960, mais les produits manufacturés occupent
près de 75 % du commerce mondial à la fin des années quatre-vingt-dix.
1.2.3.
Les échanges internationaux : structure géographique
Pour mesurer les flux d'échanges entre pays et la structure de ces flux, on
utilise une matrice des échanges internationaux qui permet d'apprécier tout
à la fois le poids de chaque grande zone géographique dans le commerce
mondial, la destination des exportations, l'importance du commerce intrazone.
Ainsi, pour les échanges de produits manufacturés en 1995:
47,7% des exportations mondiales proviennent de l'Europe de l'Ouest,
- 32,5% des exportations mondiales ont lieu à l'intérieur de l'Europe de
l'Ouest,
3,4 % des exportations mondiales sont des exportations européennes destinées à l'Asie en développement.
1.3.
Les grandes tendances
1.3.1.
En moyenne, depuis le x1xe siècle, les échanges
internationaux augmentent deux fois plus vite que la production
Si l'on excepte la période comprise entre 1914 et 1945, le commerce mondial
croît à un rythme deux fois plus rapide que celui de la production nationale.
Depuis 1973, malgré la crise, le commerce international est resté dynamique
Tableau 8 - Matrice des échanges de produits manufacturés en 1995.
(en millièmes du total des échanges)
Destination
►
AmériquelEurope
du Nord .
e l'Ouest
Origine f
Japon
1
Amérique
du Nord
82
32
12
Europe
de l'Ouest
41
325
Japon
36
19
Asie en
développement
46
31
19
0
0
Asie
1
en
Amérique Monde
déveloplatine
arabe
pement
Afrique
noire
Europe
de l'Est
Monde
1
25
23
3
1
1
173
JI
34
13
16
5
22
477
0
50
5
3
1
l
117
21
51
5
6
1
3
168
4
1
2
7
0
0
0
34
3
0
2
0
l
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
2
Amérique
/latine
Monde arabe
Afrique noire
1Europe
de l'Est
2
16
l
3
l
l
0
4
28
'Monde
213
435
47
171
53
29
9
32
l 000
1
i
Source: CHELEM.
CEPII, L 'É'conomîe mondiale en...
, Repères, La Découverte.
et a autant progressé de 1974 à 1996 que de 1880 à 1980.
Facteurs de croissance, les échanges internationaux ont, sans doute, contribué à atténuer les
effets de la crise depuis les années quatre-vingt.
Cette croissance est surtout
le fait du commerce de marchandises.
Le commerce de services augmente de
manière significative depuis seulement une vingtaine d'années.
Il faut aussi
souligner que la comptabilisation des échanges de services est récente et que
certains services sont,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓