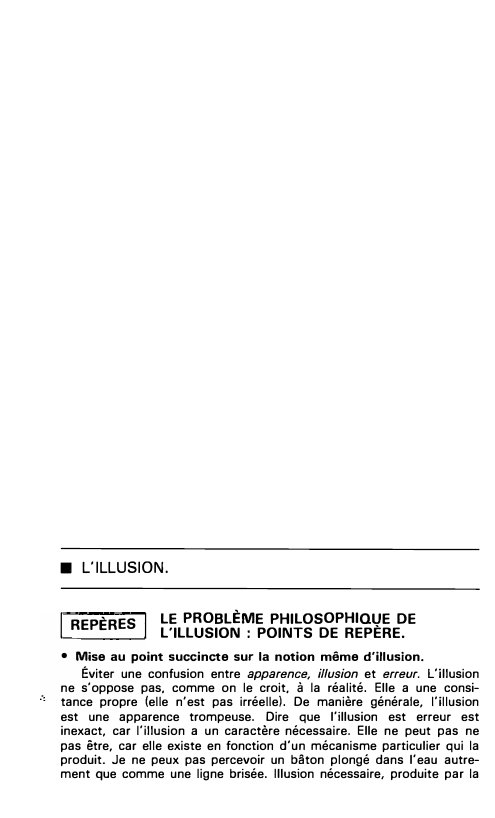■ L'ILLUSION. LE PROBLÈME PHILOSOPHIQl}E DE 1 REPÈRES I L'ILLUSION : POINTS DE REPERE. • Mise au point succincte sur...
Extrait du document
«
■ L'ILLUSION.
LE PROBLÈME PHILOSOPHIQl}E DE
1 REPÈRES I L'ILLUSION
: POINTS DE REPERE.
• Mise au point succincte sur la notion même d'illusion.
Éviter une confusion entre apparence, illusion et erreur.
L'illusion
ne s'oppose pas, comme on le croit, à la réalité.
Elle a une consi
tance propre (elle n'est pas irréelle).
De manière générale, l'illusion
est une apparence trompeuse.
Dire que l'illusion est erreur est
inexact, car l'illusion a un caractère nécessaire.
Elle ne peut pas ne
pas être, car elle existe en fonction d'un mécanisme particulier qui la
produit.
Je ne peux pas percevoir un bâton plongé dans l'eau autre
ment que comme une ligne brisée.
Illusion nécessaire, produite par la
différence des indices de réfraction de l'air et de l'eau.
Mais, muni
d'une telle connaissance, je me garde d'affirmer que le bâton est
brisé.
L'illusion perceptive ou optique n'engendre pas d'emblée I' er
reur.
Elle la suggère, parfois avec une force irrépressible.
L'apparence
se joue de moi (ludere : jouer) mais je reste, théoriquement, libre des
jugements que je porte sur elle.
L'identification et la reconnaissance
de l'illusion ne la modifient pas.
Elles la déjouent, la réduisent à un
leurre inefficace.
Mais tout serait trop simple si le problème de l'illu
sion s'épuisait dans la maîtrise du rapport perceptif.
Si celui-ci est
déterminé par la position du sujet percevant, il est aussi investi par
les données de toute une affectivité, qui engendre un autre type
d'illusion.
L'homme, par exemple, projette dans la nature ce qui lui
est familier, ce qui lui rappelle inconsciemment sa propre vie.
Il
pense ainsi la nature par analogie ou par valorisations.
L'illusion géo
centrique, finaliste, anthropomorphique que caractérise Spinoza
combine ainsi l'illusion perceptive et les effets inaperçus d'une sub
jectivité qui «fait délirer» la nature avec elle.
Les pièges du langage,
les symbolismes de l'imagination matérielle déterminent un monde
d'illusions avec lequel l'homme doit rompre s'il veut connaître le réel
et s'affranchir de l'apparence (cf.
Bachelard, explication génétique
des obstacles épistémologiques).
Enfin, dans l'activité réflexive
même, la raison ou ce qui en tient lieu se nourrit d'illusions dès
qu'elle croit pouvoir s'affranchir des limites que lui impartit l'expé
rience, saisir comme objets existant réellement de simples contenus
de pensée (cf.
la distinction kantienne du penser et du connaître).
Attribuer la puissance et la fréquence des illusions à la faiblesse
intrinsèque des «facultés» de l'homme et/ ou à la relativité de sa
condition (Pascal) ne semble pas suffisant.
Bien des illusions collecti
ves changent de nature, de contenu, avec l'évolution historique.
Il en
est ainsi des diverses illusions idéologiques que les différentes épo
ques nourrissent sur elles-mêmes.
Ainsi de l'illusion, toujours renais
sante, qu'une forme de société serait «naturelle», c'est-à-dire
conforme à une logique absolue et intemporelle.
L'élucidation généti
que des illusions collectives et des mythologies dans lesquelles elles
s'expriment relève d'une problématique de type sociologique et his
torique (Durkheim, Marx) mais aussi de l'entreprise que définit la
psychologie collective (cf.
Freud et, dans une certaine mesure, les
analyses de J.-P.
Vernant dans Mythe et pensée chez les Grecs).
• Quelques références utiles.
- Représentation philosophique d'ensemble du problème de /'illu
sion et de son statut général.
► Les puissances d'illusion dans le récit symbolique de Platon,
«Allégorie de la caverne», La République, livre VII.
► Une condition déchue, génératrice d'illusions.
Cf.
Pascal, Pen
sées (édition Brunschvicg, p.
83 : « L'homme n'est qu'un sujet plein
d'erreur, naturelle et ineffaçable sans la grâce.
Rien ne lui montre la
vérité.
Tout l'abuse; ces deux principes de vérité, la raison et les
sens, outre qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent récipro
quement l'un l'autre»).
► Le recensement des différentes illusions qui conduisent
l'homme à l'erreur, d'après Bacon (Novum organum, 1) : illusions
liées à-la succession des théories qui se contredisent, au langage
quotidien dépourvu de rigueur, aux préjugés issus d'une éducation et
d'un milieu, à l'empirisme ou, au contraire, au goût de la spéculation
abstraite, etc.
- L'approche génétique des différents types d'illusion.
► L'illusion géocentrique comme illusion de perspective.
Cf.
Copernic, Lettre-préface au De revolutionibus orbium cœlestium :
« ...
Le cours apparent des étoiles n'est qu'une illusion d'opti
que, produite par le mouvement réel de la Terre et par les
oscillations de son axe.
»
► L'illusion finaliste comme produit de l'imagination humaine.
Spinoza, Éthique, 1 (Appendice).
► L'illusion du libre arbitre comme ignorance des causes vérita
bles de l'action.
Spinoza.
Lettre à Schuler (Éditions Garnier-Flamma
rion, tome IV, Lettres, lettre 58).
► L'illusion du dogmatisme métaphysique.
Kant, Critique de la
raison pure (Dialectique transcendantale).
► L'illusion idéologique selon Marx.
A une explication de I' ori
gine de l'inversion idéaliste (al.
Marx associe une étude du méca
nisme par lequel se constitue l'illusion d'autonomie de l'idéologie (b).
a) Cf.
Introduction à la Critique de /'économie politique (Éditions
Sociales, page 165).
« Pour la conscience - et la conscience philosophique est ainsi
faite que pour elle la pensée qui conçoit constitue l'homme
réel et, par suite, le monde n'apparaît comme réel qu'une fois
conçu -, pour la conscience, donc, le mouvement des catégo
ries apparaît comme l'acte de production réel (...
r dont le ré
sultat est le monde.
»
b) Cf.
L'Idéologie allemande, première partie (Éditions Sociales),
et L.
Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, de F.
Engels (in Études philosophiques, Éditions Sociales, page 56)
« Chaque idéologie, une fois constituée, se développe sur la
base des éléments de représentation donnés et continue à les
élaborer ; sinon elle ne serait pas une idéologie, c'est-à-dire le
fait de s'occuper d'idées comme d'entités autonomes, se dé
veloppant de façon indépendante et uniquement soumises à
leurs propres lois ( ...) Que les conditions matérielles d'exis
tence des�hommes, dans le cerveau desquels se poursuit ce
processus mental, en déterminent en fin de compte le cours,
cela reste chez eux nécessairement inconscient, sinon c'en se
rait fini de l'idéologie.
»
► L'étude des illusions liées aux valorisations affectives in
conscientes.
Bachelard, Psychanalyse du feu (Éditions Gallimard,
collection « Idées »).
• Corrélations.
La réflexion sur les illusions occupe une place décisive dans la
philosophie.
On peut la référer, entre autres, aux questions suivan
tes :
- le langage (cf.
la rhétorique comme puissance d'illusion et la
théorie de /'obstacle verbafl ;
l'imagination (cf.
le fantasme comme scénario imaginaire, et
les illusions de la vie affective) ;
- le jugement (cf.
le pouvoir de distanciation de la volonté par
rapport à la « force » des représentations) ;
- la religion ;
l'idéologie (question optionnelle
problème des illusions....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓