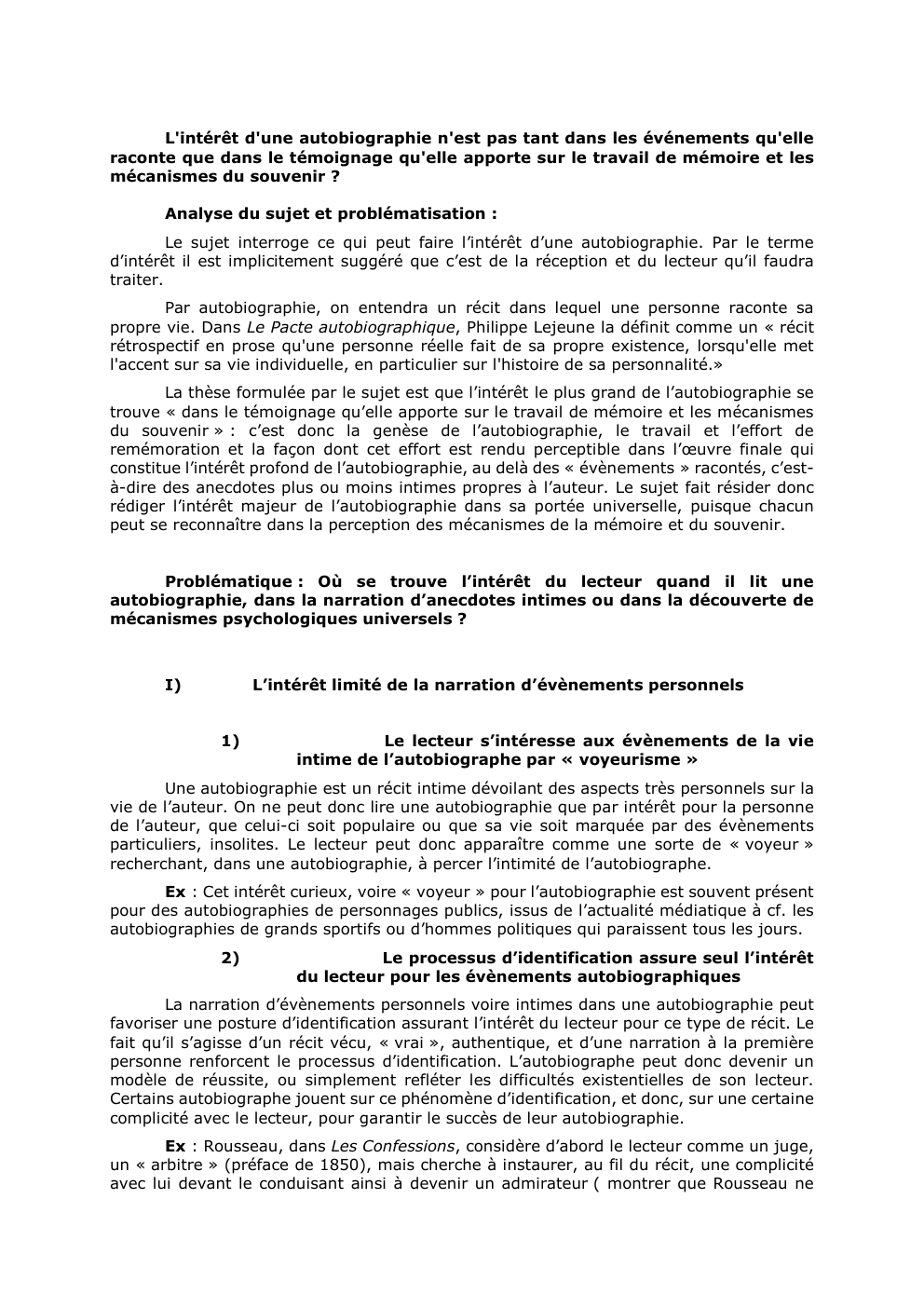L'intérêt d'une autobiographie n'est pas tant dans les événements qu'elle raconte que dans le témoignage qu'elle apporte sur le travail...
Extrait du document
«
L'intérêt d'une autobiographie n'est pas tant dans les événements qu'elle
raconte que dans le témoignage qu'elle apporte sur le travail de mémoire et les
mécanismes du souvenir ?
Analyse du sujet et problématisation :
Le sujet interroge ce qui peut faire l’intérêt d’une autobiographie.
Par le terme
d’intérêt il est implicitement suggéré que c’est de la réception et du lecteur qu’il faudra
traiter.
Par autobiographie, on entendra un récit dans lequel une personne raconte sa
propre vie.
Dans Le Pacte autobiographique, Philippe Lejeune la définit comme un « récit
rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met
l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité.»
La thèse formulée par le sujet est que l’intérêt le plus grand de l’autobiographie se
trouve « dans le témoignage qu’elle apporte sur le travail de mémoire et les mécanismes
du souvenir » : c’est donc la genèse de l’autobiographie, le travail et l’effort de
remémoration et la façon dont cet effort est rendu perceptible dans l’œuvre finale qui
constitue l’intérêt profond de l’autobiographie, au delà des « évènements » racontés, c’està-dire des anecdotes plus ou moins intimes propres à l’auteur.
Le sujet fait résider donc
rédiger l’intérêt majeur de l’autobiographie dans sa portée universelle, puisque chacun
peut se reconnaître dans la perception des mécanismes de la mémoire et du souvenir.
Problématique : Où se trouve l’intérêt du lecteur quand il lit une
autobiographie, dans la narration d’anecdotes intimes ou dans la découverte de
mécanismes psychologiques universels ?
I)
L’intérêt limité de la narration d’évènements personnels
1)
Le lecteur s’intéresse aux évènements de la vie
intime de l’autobiographe par « voyeurisme »
Une autobiographie est un récit intime dévoilant des aspects très personnels sur la
vie de l’auteur.
On ne peut donc lire une autobiographie que par intérêt pour la personne
de l’auteur, que celui-ci soit populaire ou que sa vie soit marquée par des évènements
particuliers, insolites.
Le lecteur peut donc apparaître comme une sorte de « voyeur »
recherchant, dans une autobiographie, à percer l’intimité de l’autobiographe.
Ex : Cet intérêt curieux, voire « voyeur » pour l’autobiographie est souvent présent
pour des autobiographies de personnages publics, issus de l’actualité médiatique à cf.
les
autobiographies de grands sportifs ou d’hommes politiques qui paraissent tous les jours.
2)
Le processus d’identification assure seul l’intérêt
du lecteur pour les évènements autobiographiques
La narration d’évènements personnels voire intimes dans une autobiographie peut
favoriser une posture d’identification assurant l’intérêt du lecteur pour ce type de récit.
Le
fait qu’il s’agisse d’un récit vécu, « vrai », authentique, et d’une narration à la première
personne renforcent le processus d’identification.
L’autobiographe peut donc devenir un
modèle de réussite, ou simplement refléter les difficultés existentielles de son lecteur.
Certains autobiographe jouent sur ce phénomène d’identification, et donc, sur une certaine
complicité avec le lecteur, pour garantir le succès de leur autobiographie.
Ex : Rousseau, dans Les Confessions, considère d’abord le lecteur comme un juge,
un « arbitre » (préface de 1850), mais cherche à instaurer, au fil du récit, une complicité
avec lui devant le conduisant ainsi à devenir un admirateur ( montrer que Rousseau ne
cesse de se mettre en valeur et d’affirmer sa supériorité et qu’il évoque explicitement sa
valeur de modèle, notamment dans le préambule de 1850 : son ouvrage « peut servir de
première pièce de comparaison pour l’étude des hommes »)
II)
L’intérêt du lecteur se trouve dans le travail psychologique de la
mémoire
L’intérêt du lecteur pour le genre autobiographique ne vient pas seulement des
évènements racontés : dans presque tous les genres littéraires, on observe une narration
d’évènements.
Quel est- donc l’intérêt spécifique du genre autobiographique ? Il semble
se trouver dans le travail psychologique de la mémoire et dans le mécanisme du souvenir
que met en place l’autobiographie.
1)
La
involontaire
mémoire
est
souvent
fragmentée
et
Nombre d’autobiographies mettent en avant le mécanisme d’une mémoire
fragmentée et de souvenirs fragmentaires.
Certaines autobiographies présentent donc les
évènements de manière non chronologique, selon les irruptions de souvenirs, dûs à une
mémoire souvent involontaire.
Ex :
·
Le mécanisme de la mémoire affective, sensorielle, défini par
Proust à propos de la madeleine et de la réminiscence qu’elle implique dans
Du coté de chez Swann :
Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la
destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus
persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes,
à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur
leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
àLa mémoire sensorielle, affective et involontaire est un bon allié dans la quête
autobiographique du souvenir authentique.
·
La mémoire fragmentée et le souvenir fragmentaire dans Le
scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby ou dans Roland
Barthes par Roland Barthes
·
L’entreprise Gidienne dans Si Le grain de meurt :
J’écrirai mes souvenirs comme ils viennent, sans chercher à
les ordonner.
Tout....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓