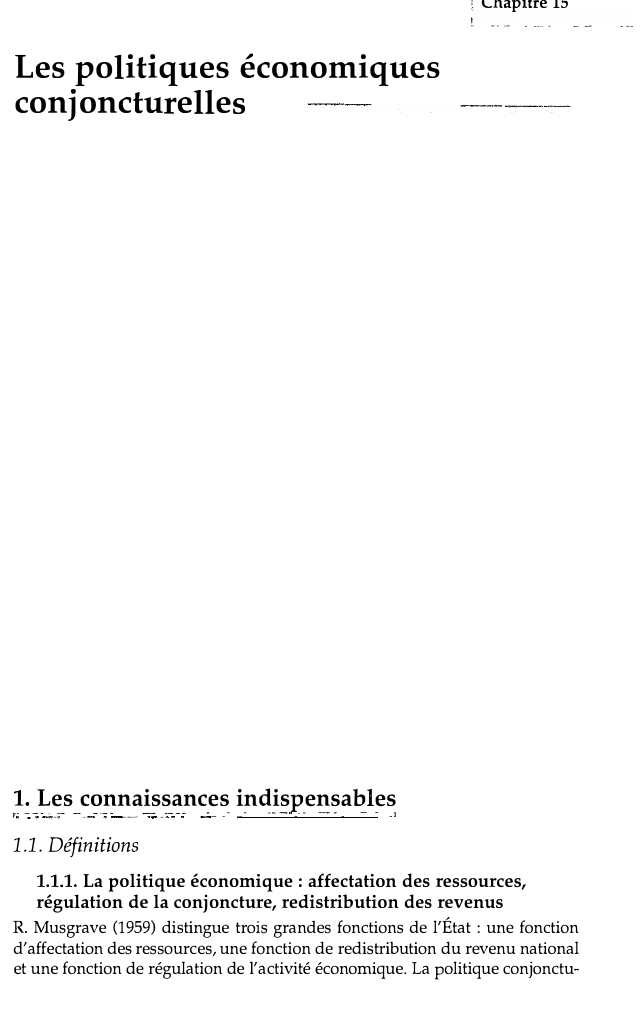, Lnapure 1:, Les politiques économiques conjoncturelles 1. Les--_connaissances r-----_----- __ p ______ -_ _- indispensables _- --- _- -...
Extrait du document
«
, Lnapure 1:,
Les politiques économiques
conjoncturelles
1.
Les--_connaissances
r-----_----- __
p
______
-_
_-
indispensables
_-
---
_- -
-- -
_
-
-
_1
1.1.
Définitions
1.1.1.
La politique économique: affectation des ressources,
régulation de la conjoncture, redistribution des revenus
R.
Musgrave (1959) distingue trois grandes fonctions de l'État : une fonction
d'affectation des ressources, une fonction de redistribution du revenu national
et une fonction de régulation de l'activité économique.
La politique conjonctu-
relle renvoie à la fonction de régulation et désigne l'ensemble des mesures
prises par les Pouvoirs publics pour assurer une croissance économique
compatible avec le plein-emploi, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur
(objectifs du «carré magique» de N.
Kaldor).
Mais la poursuite simultanée de
ces quatre objectifs peut être contradictoire.
Il peut donc être nécessaire d' effectuer des choix, par exemple entre le plein-emploi et la stabilité des prix.
Les Pouvoirs publics peuvent réguler la conjoncture en agissant sur la
masse monétaire, sur les dépenses et les recettes publiques et (ou) sur le taux
de change.
Cependant, les politiques monétaire, budgétaire et de change ont
aussi des conséquences structurelles.
Deux exemples peuvent illustrer cette
proposition : une politique de taux de change fort restructure l'appareil
productif en éliminant des entreprises peu compétitives, une politique de
relance budgétaire par augmentation des revenus de transferts modifie la
répartition du revenu national.
1.1.2.
La politique monétaire: objectifs «intermédiaires»,
·
instruments
La politique monétaire se fixe des objectifs dits «intermédiaires» comme la
croissance de la masse monétaire, le niveau du taux d'intérêt ou la stabilité du
taux de change.
La croissance de la masse monétaire est l'objectif privilégié
par les monétaristes alors que les keynésiens préfèrent agir par le biais du
taux d'intérêt.
Le choix d'un taux de change stable (le refus de dévaluer) est
associé à une politique monétaire recherchant la stabilité des prix.
Les autorités monétaires disposent de plusieurs instruments pour
contrôler la masse monétaire et modifier les taux d'intérêt à court terme :
encadrement du crédit (plafonnement des crédits bancaires), réserves obligatoires (versement par les banques commerciales d'une partie de leurs dépôts
à la Banque centrale), taux de réescompte fixé par la Banque centrale (taux
d'intérêt auquel les banques commerciales peuvent se refinancer), intervention de la Banque centrale sur le marché monétaire (par des achats ou des
ventes de titres publics).
L'utilisation de ces instruments peut varier au cours
du temps.
1.1.3.
La politique budgétaire:
des moyens d'actions diversifiés
La politique budgétaire utilise le budget de l'État et dispose, en principe,
d'une large palette de moyens d'action : montant et structure des recettes
(principalement fiscales) et des dépenses, mode de financement des dépenses
(par l'impôt, par l'emprunt ou par la création monétaire).
Le budget peut être
présenté en équilibre ou en déficit.
Le déficit budgétaire ne doit pas être
confondu avec le déficit public ou le déficit des APU (administrations
publiques comprenant l'État, les collectivités territoriales, la Sécurité sociale)
qui se calcule par différence entre les dépenses publiques y compris les
prestations sociales, et les recettes publiques1 y compris les cotisations
sociales.
C'est cette notion élargie qui est retenue au niveau européen.
1
Pour mieux cerner les orientations de la politique économique, on peut
décomposer le déficit budgétaire, soit en isolant le déficit conjoncturel du
déficit structurel (déficit délibéré, voulu par les Pouvoirs publics), soit en
isolant le déficit primaire du déficit lié aux charges financières de la dette.
La dette publique représente la totalité des engagements de l'État, des
administrations locales et de la Sécurité sociale.
Elle est alimentée par le
déficit de ces agents économiques.
1.1.4.
La politique de change : régime de change, mouvements
de capitaux et taux de change d'équilibre
La politique de change désigne l'ensemble des actions des autorités
monétaires visant à maintenir ou à modifier le taux de change de la monnaie,
à déterminer les conditions d'intervention de la Banque centrale sur le
marché des changes et à contrôler ou non les mouvements de capitaux.
Les pouvoirs publics peuvent opter pour un régime de taux de changes fixes,
ce qui signifie que la Banque centrale s'engage à intervenir sur le marché des
changes pour maintenir le taux de change à l'intérieur des marges de fluctuations fixées par les autorités, ou pour un régime de taux de changes flottants,
auquel cas la Banque centrale n'est pas tenue d'intervenir sur le marché des
changes.
Les régimes de taux de changes flottants purs sont cependant rares.
Le choix du taux de change d'équilibre est délicat.
Un taux de change faible
favorise les exportations mais alourdit le coût des importations et risque de
provoquer des tensions inflationnistes.
Un taux de change fort allège le coût
des importations mais rend les exportations plus difficiles, ce qui incite les
entreprises à améliorer leur compétitivité-prix ou à s'orienter vers des productions pour lesquelles la compétitivité structurelle est déterminante.
1.2.
Indicateurs
1.2.1.
La prévision conjoncturelle: un exercice difficile
La politique macroéconomique doit s'appuyer sur des prévisions.
Contrairement aux comptables nationaux qui construisent une représentation des phénomènes économiques observés dans le passé, les conjoncturistes
s'appuient sur l'ensemble des informations disponibles (indicateurs,
enquêtes de conjoncture auprès des entreprises et des ménages) et utilisent
des modèles macroéconomiques pour prévoir l'évolution de l'économie.
La
fréquence des erreurs s'explique par les difficultés à anticiper l'évolution des
variables exogènes liées à l'environnement international (taux de change du
dollar par exemple) et à estimer correctement les comportements de consommation ou d'investissement des agents économiques.
1.2.2.
Les indicateurs de conjoncture permettent d'apprécier les
résultats des politiques économiques
Il s'agit, tout d'abord, des traditionnels indicateurs de conjoncture: taux de
croissance du PIB, taux d'inflation, taux de chômage, soldes de la balance
commerciale et de la balance des transactions courantes.
Ces indicateurs peuvent être complétés par toutes les informations
fournies par la comptabilité nationale, par la mesure de l'évolution des écarts
de revenus, par le pourcentage de ménages situés en dessous du seuil de
pauvreté.
Dans un régime de taux de changes flottants, il est utile de suivre
l'évolution du cours des monnaies sur le marché des changes.
Depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix, la nécessité de distinguer
les évolutions cycliques des tendances à long terme a conduit les économistes
à utiliser de nouveaux indicateurs dont le calcul n'est pas toujours aisé.
Il
s'agit par exemple de l'estimation du taux de chômage «naturel» ou du «taux
de chômage compatible avec la stabilité des prix», de la décomposition du
déficit budgétaire entre ce qui est imputable à la conjoncture et ce qui relève
de la politique économique, du PIB potentiel et de l' « output gap», défini
comme l'écart entre le PIB effectif et sa tendance à long terme.
1.3.
Grandes tendances
1.3.1.
Les objectifs et instruments des politiques conjoncturelles
ont évolué depuis le xrxe siècle
Au xrxe siècle, le rôle de l'État dans la vie économique est limité : offre de
biens collectifs, politique commerciale, établissement et respect des droits de
propriété.
Néanmoins, les pouvoirs publics utilisent la politique monétaire
par exemple en augmentant le taux de réescompte pour éviter les sorties d'or
et l'inflation.
Les dépenses publiques dont le poids dans le revenu national
est faible (10% du PIB en France en 1914) concernent les traditionnelles
fonctions régaliennes.
L'équilibre budgétaire est la règle.
Au xxe siècle, les fonctions étatiques s'élargissent et les instruments de
politique économique se multiplient.
Après la Seconde Guerre mondiale,
sous l'impulsion des idées keynésiennes et du modèle IS-LM, les politiques
conjoncturelles sont légitimées.
Pendant les «Trente Glorieuses», l'État joue un rôle actif dans la régulation conjoncturelle.
En stimulant ou en restreignant les composantes de la
demande (consommation, investissement, exportation), les politiques budgétaire, monétaire et de change permettent un «réglage fin» de la conjoncture.
La relance par la demande réduit le chômage au prix d'une inflation et d'un
déficit extérieur.
Les pouvoirs publics peuvent alors freiner la demande et, au
besoin, dévaluer la monnaie.
La politique budgétaire contra-cyclique accélère
ou ralentit l'activité économique en modulant les dépenses publiques, les
recettes fiscales et le déficit budgétaire.
La politique monétaire est «accommodante» ce qui évite les effets d'éviction par les taux d'intérêt.
Dans un
contexte favorable à la croissance, dans des économies encore peu ouvertes
sur l'extérieur, ces politiques sont efficaces.
L'échec des politiques «keynésiennes» au moment des chocs pétroliers
provoque un revirement des politiques macroéconomiques : l'objectif est
désormais la lutte prioritaire contre l'inflation par des politiques monétaires
«monétaristes» de restriction de l'offre de monnaie.
Depuis les a!lnées quatre-vingt, les politiques économiques menées en
Europe et aux Etats-Unis permettent de dégager trois grandes tendances.
Tout d'abord, les contraintes qui pèsent sur les politiques macroéconomiques
se sont accrues : économies plus ouvertes sur l'extérieur, plus complexes,
marchés financiers très présents, agents mieux informés, comportements des
ménages et des entreprises plus sophistiqués et plus aléatoires.
Ensuite, les
pouvoirs publics se sont dotés de «règles» dans la conduite des politiques
économiques (interdiction du financement monétaire du déficit budgétaire,
critères de Maastricht par exemple) et recherchent la «crédibilité» vis-à-vis de
l'opinion publique et des marchés financiers.
Enfin, la « policy mix » n'a pas
disparu.
Les bonnes performances des États-Unis s'expliquent, en partie, par
une gestion pragmatique des instruments monétaire et budgétaire; depuis
1995, les pays européens s'orientent vers une politique de détente monétaire
et de restriction budgétaire.
1.3.2.
L'efficacité des politiques conjoncturelles est soumise à
plusieurs conditions
Les effets des politiques budgétaire, monétaire et de change sur l'activité
économique dépendent de plusieurs paramètres.
L'efficacité de la politique budgétaire est tout d'abord fonction de la
valeur du multiplicateur, plus ou moins forte selon le degré d'ouverture sur
l'extérieur, la nature des dépenses publiques activées et leur mode de financement.
Tableau 11 - Valeur des multiplicateurs
Hausse des
Hausse des
Hausse des
Hausse des
dépenses publiques dépenses publiques
revenus de
dépenses publiques
sans augmentation sans augmentation transfert ou baisse avec un financement
des impôts
des impôts
des impôts
intégral par
en économie fermée en économie ouverte
forfaitaires
des impôts
en économie fermée
supplémentaires
Multiplicateur
A vcc c
1/(1 - c)
I/(1-c+m)
c/(1 -c)
1
= propension marginale à consommer et m = propension marginale à importer.
Si le déficit est financé par emprunt, l'effet d'éviction provoqué par la
hausse du taux d'intérêt peut entraîner une baisse plus ou moins prononcée
de l'investissement privé.
De plus, un endettement public excessif limite les
marges de manœuvre de la politique budgétaire en obligeant l'État à consacrer une partie de ses recettes au versement des intérêts.
Enfin, en taux de
changes fixes, la politique budgétaire n'est efficace que si les capitaux sont
mobiles.
Pour que la politique monétaire soit efficace, il faut en premier lieu que les
autorités monétaires aient la possibilité de moduler l'offre de monnaie : la
masse monétaire doit être fonction de la « base monétaire».
Cette condition
renvoie au débat sur le caractère endogène ou exogène de la monnaie.
L'offre
de monnaie supplémentaire doit se traduire par une baisse des taux d'intérêt:
l'économie ne doit pas être en situation de «trappe à liquidités», les banques
doivent répercuter la réduction des taux directeurs dans les taux qu'elles
accordent à leurs clients.
Mais, il ne suffit pas que les taux baissent, encore
faut-il que l'investissement soit sensible aux variations du taux d'intérêt.
Enfin, d'après le modèle de Mundell-Flemning, seul un régime de taux de
changes flottants permet à la politique monétaire de ne pas être contrecarrée
par les interventions de la Banque centrale sur le marché des changes.
Plusieurs conditions sont aussi requises pour que la dévaluation permette
le rétablissement de l'équilibre extérieur : élasticités-prix des importations et
des exportations suffisamment fortes pour compenser la hausse du coût des
importations (selon le théorème de Marshall-Lerner, la somme des élasticités
doit être supérieure à 1 si la balance courante est, avant la dévaluation, à
l'équilibre), absence de comportement de marge des exportateurs nationaux
et étrangers, politique d'austérité pour éviter une inflation importée, comportement non spéculatif des opérateurs sur le marché financier et sur le marché
des changes.
1.4.
Théories mobilisables
1.4.1.
Des «néo-classiques» à la «révolution keynésienne»
Dans le modèle néo-classique, la flexibilité des prix permet l'ajustement
automatique entre l'offre et la demande sur les différents marchés, y compris
le marché du travail.
Dans ces conditions, la politique économique est inutile.
L'inflation est la seule conséquence d'une politique monétaire expansionniste.
La politique budgétaire est inefficace quel que soit le mode de financement choisi.
Le recours à l'emprunt élève le taux d'intérêt sur le marché des
capitaux ce qui crée un effet....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓