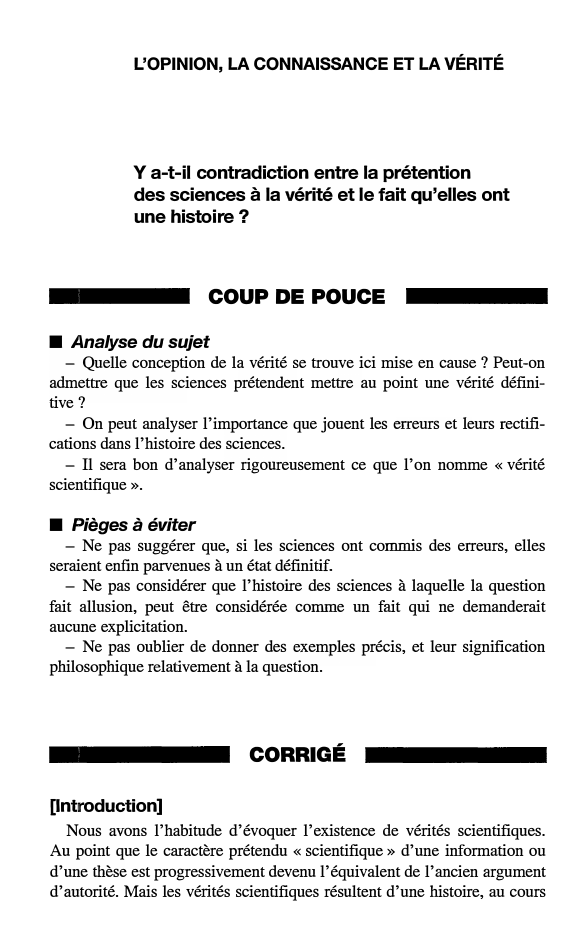L'OPINION, LA CONNAISSANCE ET LA VÉRITÉ Y a-t-il contradiction entre la prétention des sciences à la vérité et le fait...
Extrait du document
«
L'OPINION, LA CONNAISSANCE ET LA VÉRITÉ
Y a-t-il contradiction entre la prétention
des sciences à la vérité et le fait qu'elles ont
une histoire ?
COUP DE POUCE
■
Analyse du sujet
- Quelle conception de la vérité se trouve ici mise en cause? Peut-on
admettre que les sciences prétendent mettre au point une vérité défini
tive?
- On peut analyser l'importance que jouent les erreurs et leurs rectifi
cations dans l'histoire des sciences.
- Il sera bon d'analyser rigoureusement ce que l'on nomme « vérité
scientifique».
■
Pièges à éviter
- Ne pas suggérer que, si les sciences ont commis des erreurs, elles
seraient enfin parvenues à un état définitif.
- Ne pas considérer que l'histoire des sciences à laquelle la question
fait allusion, peut être considérée comme un fait qui ne demanderait
aucune explicitation.
- Ne pas oublier de donner des exemples précis, et leur signification
philosophique relativement à la question.
CORRIGÉ
[Introduction]
Nous avons l'habitude d'évoquer l'existence de vérités scientifiques.
Au point que le caractère prétendu« scientifique» d'une information ou
d'une thèse est progressivement devenu l'équivalent de l'ancien argument
d'autorité.
Mais les vérités scientifiques résultent d'une histoire, au cours
de laquelle elles n'en finissent pas de se modifier.
Il n'en reste pas moins
que la science, dans son ensemble, maintient sa prétention à énoncer la
vérité.
Y a-t-il entre cette prétention et l'existence de l'histoire des
sciences une contradiction? Ou doit-on penser, au contraire, que l'histoire
même des sciences prouve qu'elles cherchent bien la vérité?
[I.
Les deux aspects de la vérité scientifique]
Les épistémologues et logiciens distinguent volontiers dans les produits
des sciences deux vérités.
D'une part, la vérité dite formelle se soucie uni
quement de la rigueur des enchaînements logiques et des raisonnements,
indépendamment de leur «contenu» empirique (de ce dont les proposi
tions semblent parler).
Déjà Aristote avait montré, dans sa théorie du syl
logisme, que ce dernier, qui constitue le modèle du raisonnement déductif,
ne vaut que par sa forme, ce qui autorise à considérer comme «vrais» des
syllogismes au contenu empirique totalement absurde.
Il est vrai qu'Aris
tote privilégiait les syllogismes dont le contenu pouvait s'accorder avec
les données de l'expérience, mais les logiciens ultérieurs ont radicalisé
leur position en séparant la forme logique de tout contenu éventuel - ce
qui s'obtient aisément en écrivant les propositions de manière purement
symbolique et vide.
La vérité formelle ne concerne en conséquence que
les disciplines qui ne prétendent pas traiter du monde : les mathématiques
et la logique elle-même.
D'autre part, la vérité dite matérielle ou empirique est celle que l'on
rencontre dans les sciences qui s'occupent des phénomènes naturels.
C'est dire que les énoncés, outre qu'ils doivent être logiquement accep
tables, ont aussi pour tâche de rendre compte des phénomènes, par un lan
gage qui, au lieu d'être purement symbolique ou vide, est pourvu de réfé
rents les plus précis possibles.
Mais ces référents ne visent pas ce que l'on pourrait nommer la réalité
en elle-même; ils ont pour fonction de transposer dans le langage scienti
fique les phénomènes observés ou expérimentés.
On peut admettre, depuis
Kant, que ces phénomènes sont la version que le monde présente pour
nous, en fonction de nos capacités d'observation (si techniques soient
elles), mais qu'ils ne correspondent pas à la réalité (à ce que Kant nommait
les «noumènes»).
Si la science prétendait établir une vérité absolue ou
définitive, elle prétendrait du même coup atteindre la réalité nouménale.
Ce qui lui est impossible, et ce qui signifierait son achèvement, sa mort.
[Il.
Une histoire des erreurs]
S'il y a bien une histoire des sciences, cela signifie évidemment que la
vérité n'est jamais atteinte ou découverte du premier coup.
Mais cela
signifie aussi que les vérités élaborées par la science se modifient et se
corrigent historiquement en fonction de nouvelles données expérimentales
(ou de la construction de nouveaux systèmes formels).
La géométrie euclidienne, par exemple, a pendant des siècles été
admise comme la seule possible.
Jusqu'à l'apparition des géométries non
euclidiennes, qui provoqua bien des interrogations chez les mathémati
ciens et les logiciens : fallait-il....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓