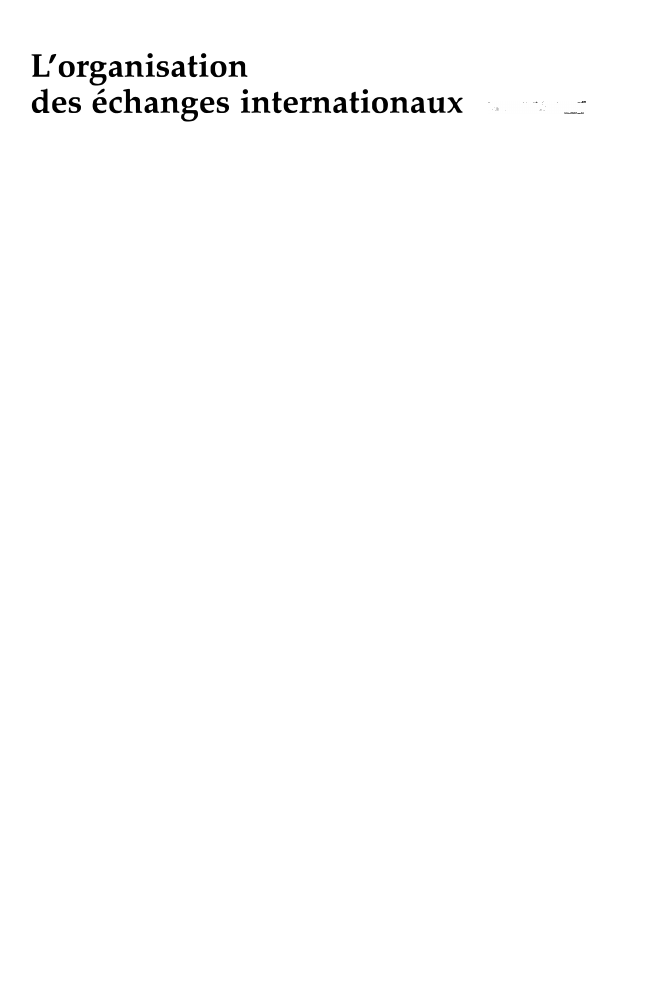L'organisation des échanges internationaux 1. Les connaissances indispensables 1.1. Définitions 1.1.1. L'organisation multilatérale des échanges de biens et de services...
Extrait du document
«
L'organisation
des échanges internationaux
1.
Les connaissances indispensables
1.1.
Définitions
1.1.1.
L'organisation multilatérale des échanges de biens
et de services prédomine depuis 1947
Depuis 1947, avec la signature des accords du GATT, les échanges interna
tionaux de biens et de services se développent dans un cadre multilatéral.
Le
multilatéralisme renvoie au principe de «non discrimination» : les mêmes
règles et les mêmes droits s'appliquent à tous les signataires des accords
commerciaux.
Le multilatéralisme se distingue du bilatéralisme qui limite les
engagements commerciaux aux seuls signataires des accords.
Quant aux
décisions unilatérales, elles sont le fait d'un État-nation qui impose les règles
du jeu sans négociation.
1.1.2.
Les échanges de biens et de services interviennent aussi
dans le cadre d'Unions douanières
La paternité d'une première typologie des Unions douanières est attribuée à
J.
Viner.
J.
Viner respecte l'axiomatique néoclassique: le libre-échange intégral
est la solution optimale.
Il distingue cinq formes d'intégration économique
entre territoires différents, selon leur degré d'intégration économique: l'asso
ciation, la Zone de libre-échange, l'Union douanière, le Marché commun et
l'Union économique.
La Zone de libre-échange vise à supprimer les obstacles
à la libre circulation des biens et des services entre les pays membres.
C'est la
forme dominante des accords commerciaux régionaux depuis 1947.
L'Union
douanière représente un nouveau territoire économique obtenu par l'élimina
tion des barrières douanières entre les pays membres, l'établissement d'un
tarif uniforme sur les importations vis-à-vis du reste du monde, et des règles
de redistribution des revenus douaniers ainsi obtenus entre les pays membres.
Les étapes ultérieures aboutissent à une intégration complète qui devrait
déboucher sur la constitution d'un nouvel État-nation.
1.1.3.
Depuis 1947, l'organisation des échanges internationaux
s'est institutionnalisée
Il faut savoir définir les principales institutions et les accords régionaux, mis
en place depuis 1947.
- Le GATT (1947-1994) ne fut jamais, juridiquement, une véritable organi
sation internationale.
Néanmoins, une «partie contractante» pouvait faire
appel au GATT quand elle estimait qu'une autre partie contractante
prenait des mesures contraires aux principes de l'accord général.
Cet
accord général imposait deux obligations majeures : la clause de la nation
la plus favorisée et un code de bonne conduite sur les moyens de protec
tion que les parties contractantes pouvaient adopter.
L'OMC, qui succède au GATT, à partir de 1995, est une véritable organi
sation internationale.
Elle englobe la quasi-totalité des États-nations,
dispose d'une organisation renforcée, en particulier d'un organe de
résolution des conflits, et voit son champ d'intervention étendu.
Les nations européennes ont adopté successivement différentes formes
d'organisation des échanges intra-européens.
- Le traité de Paris (1951) instituant la CECA organise les échanges de
charbon et d'acier.
- Le traité de Rome, signé le 25 mars 1958, crée un Marché commun entre
les six pays de la Communauté.
Les articles 110 à 116 organisent une
Politique Commerciale Commune.
En vertu de l'article 113, seule la
Commission peut prendre des initiatives dans ce domaine.
La mise en
œuvre du marché unique en 1986 conduit au traité de Maastricht (1992)
qui organise une Union monétâire en Europe.
Fondée en 1967, en pleine intervention américaine au Vietnam, par
l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande,
l'Association des nations del' Asie du Sud-Est (ASEAN) avait l'allure d'un
club diplomatique anticommuniste rejoint en 1984 par Brunei.
Devenue, à la
même époque, l'une des régions les plus dynamiques sur le plan économique, l' ASEAN envisage, dès 1992, la création de sa propre zone de libreéchange.
Simultanément, elle met fin à la dernière frontière de la guerre
froide en participant à l'accord de paix de Paris sur le Cambodge (1991) et en
intégrant le Vietnam en 1995.
La Birmanie et le Laos sont à leur tour admis en
1997.
La crise asiatique, en révélant l'importance des effets de diffusion,
accélérera sans doute l'organisation régionale des échanges.
En août 1992 naît l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui
associe le Canada, les États-Unis et le Mexique dans une vaste zone de libre
échange des biens, des services et des capitaux.
Signé en 1991, le MERCOSUR
est une union douanière avec un libre-échange interne, sauf pour l'automobile, et un tarif extérieur commun, entre le Brésil,· l'Argentine, le Paraguay et
l'Uruguay, et, bientôt, le Chili et la Bolivie.
1.2.
Indicateurs
1.2.1.
La libéralisation douanière des échanges internationaux
demeure une tendance «lourde» malgré des restrictions
néo-protectionnistes aux échanges dont l'identification
et la mesure sont complexes
Sous l'impulsion du GATT, les droits de douane ont été considérablement
abaissés et les restrictions quantitatives fortement réduites.
Ainsi les droits de
douane, qui s'élevaient en moyenne à 40% en 1947, atteindront les 4% en l'an
2000.
Cependant, des formes néoprotectionnistes apparaissent: manipulations des
taux de change ou des taux d'intérêt à des fins commerciales.
La «zone grise»
du commerce international tend à s'étendre depuis les années soixante-dix.
1.2.2.
Le commerce intra-régional est une réalité incontournable
Le commerce intra-zone s'élève à 25 % du commerce extérieur des pays de
l'Union européenne, en 1948, pour atteindre plus de 60% en 1999.
Le
commerce intra-Asie de l'Est dépasse, en 1994, la moitié du commerce
extérieur de cette zone.
Entre 1990 et 1994, le commerce intra-MERCOSUR en
Amérique latine a triplé.
Depuis 1990, 34 accords commerciaux régionaux ont
été notifiés au GATT.
1.3.
Les grandes tendances
1.3;1.
La libéralisation des échanges internationaux a été
un facteur de croissance économique tandis que les politiques
nationales de fermeture des frontières commerciales peuvent
dégénérer en « guerres commerciales»
Au cours de ces deux derniers siècles, les économies capitalistes ont connu une
croissance économique forte.
Les périodes de plus forte croissance ont coïncidé
avec des périodes de plus grande ouverture commerciale : 1850 à 1870, les
années vingt, les «Trente Glorieuses».
Les périodes de crises et/ou de ralentissement de la croissance se sont accompagnées d'un regain de protectionnisme :
la «Grande dépression» de 1873 à 1896, la crise des années trente et celle des
années quatre-vingt.
Les situations sont beaucoup moins claires au niveau des
États-nations.
Certes, et comme l'a écrit P.
Bairoch, sur le long terme, le libreéchange demeure donc l' «exception» tandis que le protectionnisme est « la
règle».
On peut même aller plus loin: le libre-échange comme mode d'organisation des échanges internationaux n'a jamais existé.
Cependant, la crise des
années trente, avec l'escalade des mesures de protection qu'elle engendra, est
devenue la situation «idéale typique» dont le retour doit être évité: les transactions c01mnerciales internationales sont divisées par deux entre 1929 et 1939.
On peut aussi souligner les conséquences économiques, en particulier la
recherche de gains de productivité, de l'intégration d'un non:i.bre croissant
d'États-nations au sein des échanges internationaux.
La fermeture des
frontières commerciales s'est trop souvent traduite par des gaspillages de
ressources et le maintien de rentes de situation permises par des systèmes de
prix administrés, préjudiciables au plus grand nombre.
1.3.2.
L'organisation des échanges internation~ux dépend
de I1 évolution des rapports de force entre les Etats-nations
Seule la Grande-Bretagne, avec les Pays-Bas, pratique un libre-échange unilatéral à partir de 1846, date d'abolition des «Corn-laws».
Mais elle ne parvient
cependant pas à organiser les échanges internationaux en vue du libre-échange.
L'échec du traité de libre-échange signé entre la Grande-Bretagne et la France,
en 1860, manifeste cette incapacité.
Les conférences internationales qui interviennent entre les deux guerres mondiales, en particulier à l'initiative de la SDN,
échouent à définir un code de bonne conduite.
Cette période se caractérise donc
par une concurrence commerciale entre des capitalismes nationaux de forces
économiques comparables.
Cependant, l'équilibre entre ces capitalismes se
révèle précaire.
L'organisation des échanges internationaux intervient essentiellement dans le cadre des rapports de domination entre métropoles et colonies
ou entre pays dominants et économies dominées, justifiant ainsi les critiques
marxistes.
Toutefois, et seulement jusqu'en 1914, la Grande-Bretagne parvient à
maintenir une «Pax britannica» et une stabilité monétaire internationale.
À partir de 1947, l'établissement d'un cadre de coopération commerciale au
niveau international est compréhensible dans un contexte international de
guerre froide entre deux «blocs».
Outre les arguments de la théorie économique en faveur de la libéralisation et de la nécessité de rétablir des échanges
pour favoriser les reconstructions, le changement intervenu dans la façon plus
coopérative dont les États-Unis vont exercer leur fonction de leadership
s'explique par les rapports de forces politiques et idéologiques qui l'opposent
à l'URSS.
N'oublions pas qu'en 1930, les États-Unis mettent en vigueur, avec la
loi Smoot-Hawley, les tarifs les plus protectionnistes de toute l'histoire américaine.
La reconduction du GATT jusqu'aux années soixante-dix, sous la forme
de «Rounds», renvoie à une conjoncture politique internationale qui change à
partir de la fin des années soixante et des années soixante-dix.
La rivalité entre
les États-Unis et l'URSS se double alors d'une autre rivalité, qui intervient plus
particulièrement sur le terrain économique, entre les États-Unis, les nations
européennes, et le Japon.
À partir des années quatre-vingt, l'effondrement du
«bloc», notamment commercial, des pays de l'Est avive ces rivalités et rend les
rapports de forces plus complexes.
La révolution technologique en cours
exacerbe la concurrence entre les firmes.
Le nombre sans cesse croissant
d'acteurs publics et privés qui apparaissent sur la scène des échanges internationaux coïncide avec une montée du ou des désordres.
Cependant, les Étatsnations ont évité, jusqu'à présent, la course aux armements commerciaux.
1.3.3.
Les échanges internationaux de biens et de services
n'obéissent pas uniquement à une logique d'échanges
entre nations
Avant l'émergence du capitalisme industriel, la polarisation des échanges se
fait autour de villes marchandes et selon une logique de «réseaux», comme
en témoigne la chaîne géographique des grandes foires.
Par ailleurs, au fur et
à mesure de la constitution des territoires économiques nationaux par l' éradication des barrières protectionnistes intra-nationales, des processus de
spécialisation et de concurrence entre régions se mettent en œuvre.
Les
économies nationales ne sont pas des espaces économiques indifférenciés.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓