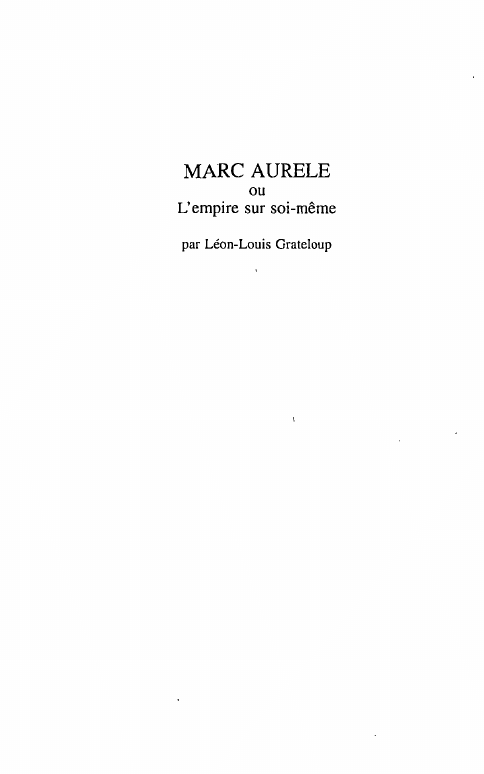MARC AURELE ou L'empire sur soi-même par Léon-Louis Grateloup Ni tragédien, ni courtisane ! Marc Aurèle, Pensées, V, 28. Un...
Extrait du document
«
MARC AURELE
ou
L'empire sur soi-même
par Léon-Louis Grateloup
Ni tragédien, ni courtisane !
Marc Aurèle, Pensées, V, 28.
Un Romain qui écrit en grec
Que la philosophie soit grecque de naissance, - sinon
d'essence - on en trouverait une illustration dans le fait
suivant : quand l'empereur romain Marcus Aurelius Antoninus (Marc Aurèle), au cours de ses campagnes sur les
rives du Danube où il a conduit ses légions, trouve quelques
instants pour noter ses «Pensées», ce n'est pas en latin
qu'il écrit, mais en grec.
Le grec est la langue des philosophes et en particulier celle d'Epictète, dont l'empereur a pu
lire les Entretiens, grâce à son conseiller stoïcien Rusticus
·
qui lui a ouvert jadis sa bibliothèque (Pensées, I, 7).
Un empereur disciple d'un esclave
Que la philosophie ignore les cloisonnements socio-économiques, quelle meilleure preuve pourrait-on eri donner
que cette rencontre magistrale d'un esclave affranchi dénué
de ressources, et d'un empereur élevé dans les avenues du
pouvoir?
Marc Aurèle marqua d'un caillou blanc, selon la coutume romaine, le jour où il connut les leçons d'Epictète,
dont il devint le disciple.
Considéré par certains comme un
148
Marc Aurèle
simple imitateur de son maître en stoïcisme, dont il reprend
en effet l'essentiel de la doctrine et des thèmes, l'empereur
nous présente en réalité, à travers ses Pensées, une autre
figure du Portique.
Un livre unique .
L'ouvrage que Marc Aurèle écrit, à la fin de sa vie, dans
la boue des armées, est à bien des égards un livre unique,
dont le titre grec : ta eis éauton, généralement traduit par
Pensées, désigne plus exactement des « Notes personnelles » (« A moi-même » ou « Pour moi-même ») par opposiiion aux pièces officielles, qui faisaient également partie de
la cassette impériale.
Ce sont des notes prises au petit jour,
ou à la fin d'une rude journée, pour son usage personnel, par
un empereur que son pouvoir isole et_qui ne trouve finalement à s'entretenir qu'avec lui-même, dans son « arrièreboutique», comme dira plus tard Montaigne (Essais, I, 39).
Ainsi, avec les Pensées de Marc Aurèle, nous ne sommes
pas dans le monde lointain d'un mythe : celui du philosophe qui serait roi, - mais bien dans la confidence d'un
empereur qui est réellement philosophe et que son humanité
nous rend proche.
Les insomnies durant les longues campagnes auxquelles se voit obligé cet empereur qui n'aimait
pas la guerre, son mépris de la gloire si souvent affirmé,
l'exercice d'un pouvoir au sujet duquel il n'entretient
aucune illusion, expliquent la tonalité particulière des Pensées et l'audience qu'elles ont trouvée chez tant de lecteurs
qui, sans être empereurs ni sages, étaient simplement des
prokoptontés, c'est-à-dire des hommes « s'avançant vers»
la vérité et la sagesse.
Royauté du présent
L'homme que nous découvrent les Pensées est un ascète
qui joue son rôle d'empereur avec une extrême distance et
une constante application.
Concevant sa tâche comme un
devoir quotidien, Marc Aurèle refuse de céder à l'illusion
1
1
j
Marc Aurèle
149
d'un temps qui ne serait pas celui de l'action présente.
Entre
ces deux infinis que sont le passé et 1' avenir, sur lesquels
nous n'avons aucune prise, seul le présent offre à l'action
vertueuse un moment qui ne doit pas être différé : « Si tu
ôtes du temps tout ce qui est à venir et tout ce qui est déjà
écoulé, tu feras de toi, comme dit Empédocle, "une sphère
parfaite, fière de sa rondeur bien équilibrée" » (XII, 3).
Rien
n'est plus éloigné de Marc Aurèle que l'idée d'investir dans
cette vie pour récolter au centuple dans une autre.
Le temps
est vidé de toute capacité de rapport pour le sage qui trouve
dans l'exercice même de la vertu sa récompense toujours
actuelle : on ne s'étonnera donc pas que, sous le règne de
Marc Aurèle, aient eu lieu les persécutions de Lyon, où
sainte Blandine et l'évêque saint Pothin « eurent la gloire de
cueillir la palme du martyre», comme l'écrit le R.P.
Gazeau
(Histoire de France, Paris, 1870, t.
I, p.
30).
En effet, aux
yeux de l'empereur, les chrétiens ne sont pas seulement des
agitateurs en expansion contre la« paix romaine », mais des
« acteurs tragiques » dont la sincérité est suspecte (XI, 3),
des insensés qui ne s'appartiennent plus et qui voudraient
changer l'ordre du monde, ignorant qu'une seule tâche
appelle le philosophe : se changer soi-même et devenir tranquillement maître de soi.
Tous les fanatismes naissent ainsi
d'une ignorance fondamentale, relative à la nature du temps.
·
Une méprise significative
Dans ces conditions, on pourrait s'étonner, en revanche,
que l'admirable statue équestre de Marc Aurèle, en bronze
doré, qui se dresse sur la place du Capitole, au cœur de
la chrétienté, soit si exceptionnellement parvenue intacte
jusqu'à nous, depuis le second siècle: ~
A vrai dire, les chrétiens du Moyen Age avaient pris ce
chef-d'œuvre, - que Michel-Ange, plein d'admiration,
restaura lui-même en 1538, - pour l'effigie de Constantin,
premier empereur chrétien.
Au-delà de l'anecdote, cette·
méprise est significative des rapports ambigus que n'ont
cessé d'entretenir la philosophie stoïcienne et la religion
chrétienne, deux conceptions de l'existence à certains
150
Marc Aurèle
égards très proches - au point que les Pensées de Marc
Aurèle ont été le livre de chevet de bien des auteurs chrétiens et pourtant, quant au fond, diamétralement
opposées.
Ce qui sépare en effet un Marc Aurèle d'un Pascal, par
exemple c'est que, pour Pascal, l'homme est une créature
déchue, qui ne peut rien sans le secours de la grâce et qui
doit mettre tout son espoir dans une autre vie, tandis que,
pour Marc Aurèle, il n'y a pas d'autre vie, pas d'autre
monde, pas d'autre dieu, - pas d'autre empire que celui
que chacun peut acquérir sur lui-même.
Se confier à Dieu,
c'est se confier à soi, au lieu de « se fuir» ou de se haïr.
Dans ses Pensées, c'est avec soi-même que Marc Aurèle
fait société, sans complaisance ni suffisance.
C'est en soi
qu'il trouve cette force d'affirmation, qui exclut tout sentiment négatif à 1'égard de 1' ordre du monde, et qu'on a souvent confondue à tort avec une acceptation peureuse et
résignée.
Tout au contraire, Marc Aurèle est profondément
animé de la conviction positive que le monde où chacun
est appelé à tenir sa place est le meilleur possible : dès lors,
il s'agit de vivre, sans illusion, « dans la beauté des choses » : « Tout est fruit pour moi de ce que produisent tes
saisons, ô Nature ! » (IV, 23)
Beauté des craquelures
Dans un texte que l'on situerait volontiers au cœur des
plus audacieuses interrogations de l'art contemporain
- Marc Aurèle écrit : « Il n'est pas jusqu'aux modifications accidentelles des productions naturelles, qui n'aient
quelque chose de gracieux et d'engageant.
Par exemple, le pain que l'on cuit se craquelle par
endroits.
Or les fentes ainsi formées, qui démentent, pour
ainsi dire, ce que promettait l'art du boulanger, offrent un
certain agrément et excitent tout spécialement l'appétit.
De
même les figues bien mûres s'entr'ouvrent et, dans les olives mûres qu'on laisse sur l'arbre, ce sont justement les
approches de la pourriture qui donnent au fruit une beauté
toute spéciale.
Ainsi un homme d'une sensibilité et d'une
Marc Aurèle
151
intelligence capables de pénétrer ce qui se passe dans le
tout, ne trouvera pour ainsi dire rien qui ne possède une
certaine grâce spéciale » (III, 2).
L'être et les néants
Quant au problème de la mort et de l'au-delà, Marc
Aurèle évoque trois possibilités : la première, faisant référence à la physique d'Epicure et à son «atomisme», conclut que si le monde est simplement un assemblage
d'atomes, la mort signifie, pour tout être vivant, la dispersion des éléments qui le constituaient provisoirement.
Les deux autres possibilités, - extinction ou émigration-, sont relatives à l'idée proprement stoïcienne que le
monde est un (VII, 9) et que la nature, qui gouverne le tout,
transforme constamment la substance universelle « pour
modeler d'abord un cheval, qu'elle refond ensuite, comme
une cire, pour former un arbre, puis un homme, puis quelque autre objet» (VII, 23).
Résumant pour lui-même les
différentes éventualités, Marc Aurèle écrit : « Souviens-toi
donc qu'il faudra ou que ton agrégat se disperse, ou que
ton souffle s'éteigne, ou qu'il émigre pour trouver place
·
ailleurs » (VIII, 25).
Mais, dans tous les cas, « ne plus être » ou « devenir
autre » cela revient au même.
Le fait de subsister éternellement dans la Nature, sous d'autres formes, exclut, - au
même titre que l'anéantissement-, l'immortalité de l'âme
et le jugement dernier.
Tout homme est un être unique entre
deux néants anonymes.
Craintes vaines et vains reproches
La crainte de la mort est donc sans objet, - puisque quel
que soit le sort de chacun, « sentir tout autrement » équivaut à « ne plus rien sentir » : en fait, tous les hommes sans
exception, - même les plus sages et les plus ve1tueux - ,
s'éteignent et, une fois morts, ne reviennent plus à la vie.
Ainsi en ont décidé les dieux, qui ont tout réglé dans .la
152
Marc Aurèle
nature avec sagesse et bonté (XII, 5).
Il était sans nul doute
au pouvoir de la Nature de pratiquer des résurrections, mais
sa merveilleuse industrie lui permet bien davantage : avec
les matériaux ·qu'elle travaille elle-même, dans les limites
qu'elle s'est elle-même fixées, elle crée indéfiniment de
nouveaux êtres.
La Nature ne se répète pas ; elle se renouvelle sans cesse.
C'est pourquoi il n'y a pas à lui reprocher
l'amertume d'un concombre ou un buisson de ronces sur le
chemin : « Jette le concombre, dit Marc Aurèle, et évite les
ronces.
Cela suffit.
» Inutile et ridicule de porter plainte
contre la Nature : « tout ce qui en elle semble se gâter,
vieillir, devenir caduc, elle le fait rentrer en elle-même en
le transformant et, de ces résidus mêmes elle crée d'autres
êtres tout neufs » (VIII, 50).
Ainsi la fermeté devant la mort
doit témoigner d'un jugement personnel, raisonné, - et
non du désir effréné de se donner en spectacle, qui porte
les chrétiens vers les amphithéâtres (XI, 3).
De la gelée....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓