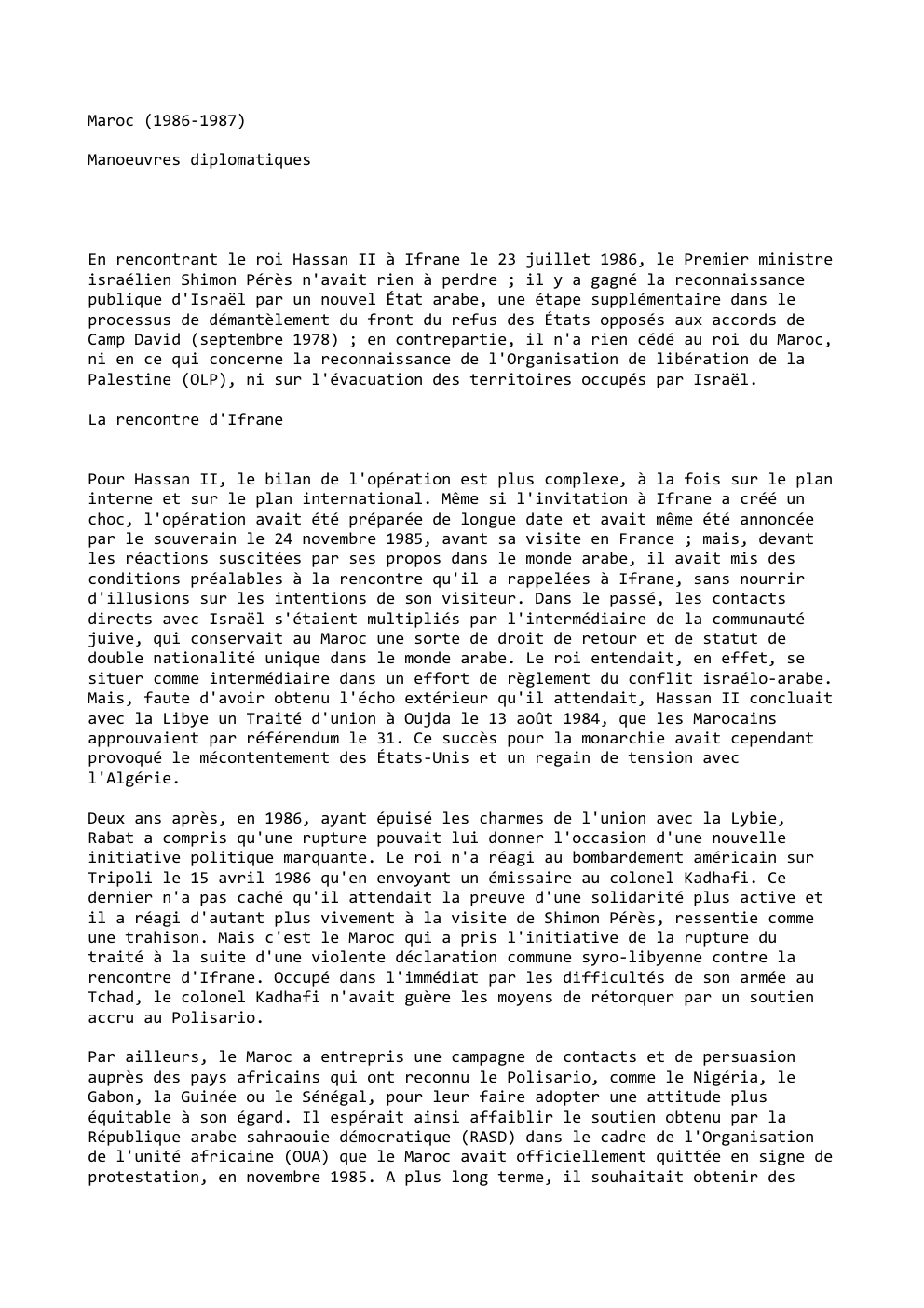Maroc (1986-1987) Manoeuvres diplomatiques En rencontrant le roi Hassan II à Ifrane le 23 juillet 1986, le Premier ministre israélien...
Extrait du document
«
Maroc (1986-1987)
Manoeuvres diplomatiques
En rencontrant le roi Hassan II à Ifrane le 23 juillet 1986, le Premier ministre
israélien Shimon Pérès n'avait rien à perdre ; il y a gagné la reconnaissance
publique d'Israël par un nouvel État arabe, une étape supplémentaire dans le
processus de démantèlement du front du refus des États opposés aux accords de
Camp David (septembre 1978) ; en contrepartie, il n'a rien cédé au roi du Maroc,
ni en ce qui concerne la reconnaissance de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), ni sur l'évacuation des territoires occupés par Israël.
La rencontre d'Ifrane
Pour Hassan II, le bilan de l'opération est plus complexe, à la fois sur le plan
interne et sur le plan international.
Même si l'invitation à Ifrane a créé un
choc, l'opération avait été préparée de longue date et avait même été annoncée
par le souverain le 24 novembre 1985, avant sa visite en France ; mais, devant
les réactions suscitées par ses propos dans le monde arabe, il avait mis des
conditions préalables à la rencontre qu'il a rappelées à Ifrane, sans nourrir
d'illusions sur les intentions de son visiteur.
Dans le passé, les contacts
directs avec Israël s'étaient multipliés par l'intermédiaire de la communauté
juive, qui conservait au Maroc une sorte de droit de retour et de statut de
double nationalité unique dans le monde arabe.
Le roi entendait, en effet, se
situer comme intermédiaire dans un effort de règlement du conflit israélo-arabe.
Mais, faute d'avoir obtenu l'écho extérieur qu'il attendait, Hassan II concluait
avec la Libye un Traité d'union à Oujda le 13 août 1984, que les Marocains
approuvaient par référendum le 31.
Ce succès pour la monarchie avait cependant
provoqué le mécontentement des États-Unis et un regain de tension avec
l'Algérie.
Deux ans après, en 1986, ayant épuisé les charmes de l'union avec la Lybie,
Rabat a compris qu'une rupture pouvait lui donner l'occasion d'une nouvelle
initiative politique marquante.
Le roi n'a réagi au bombardement américain sur
Tripoli le 15 avril 1986 qu'en envoyant un émissaire au colonel Kadhafi.
Ce
dernier n'a pas caché qu'il attendait la preuve d'une solidarité plus active et
il a réagi d'autant plus vivement à la visite de Shimon Pérès, ressentie comme
une trahison.
Mais c'est le Maroc qui a pris l'initiative de la rupture du
traité à la suite d'une violente déclaration commune syro-libyenne contre la
rencontre d'Ifrane.
Occupé dans l'immédiat par les difficultés de son armée au
Tchad, le colonel Kadhafi n'avait guère les moyens de rétorquer par un soutien
accru au Polisario.
Par ailleurs, le Maroc a entrepris une campagne de contacts et de persuasion
auprès des pays africains qui ont reconnu le Polisario, comme le Nigéria, le
Gabon, la Guinée ou le Sénégal, pour leur faire adopter une attitude plus
équitable à son égard.
Il espérait ainsi affaiblir le soutien obtenu par la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) dans le cadre de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) que le Maroc avait officiellement quittée en signe de
protestation, en novembre 1985.
A plus long terme, il souhaitait obtenir des
pays africains une position plus équilibrée dans les instances internationales,
si la question d'un référendum au Sahara occidental, accepté en principe par
toutes les parties, venait à être reposée.
A l'abri de ses murs de protection le sixième mur a été achevé en avril 1987 -, il a pu organiser des mouvements de
population en provenance du Nord qui devraient lui assurer un vote largement
favorable.
Par ailleurs, on estime que les fortifications ont réduit le coût de
la guerre de moitié depuis deux ans.
Certes, les harcèlements du Polisario ont
continué, mais les projets de bouclage des murs jusqu'à la frontière
mauritanienne devraient lui interdire l'accès aux rivages de l'Atlantique et
réduire ainsi la visibilité que les opérations de commando contre les bateaux de
pêche ou les attaques contre les avions de tourisme longeant le littoral peuvent
assurer au mouvement saharien.
Sur le plan intérieur, la tension au Sahara occidental a permis de maintenir une
unité nationale favorable à la monarchie depuis la "Marche verte" en 1975, alors
que l'armée, tout en restant confinée dans le Sud, a trouvé naturellement sa
place dans l'ensemble national grâce au conflit et a vu ses effectifs et ses
moyens maintenus.
Mais à long terme, avec un PIB qui atteint à peu près le tiers
de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓