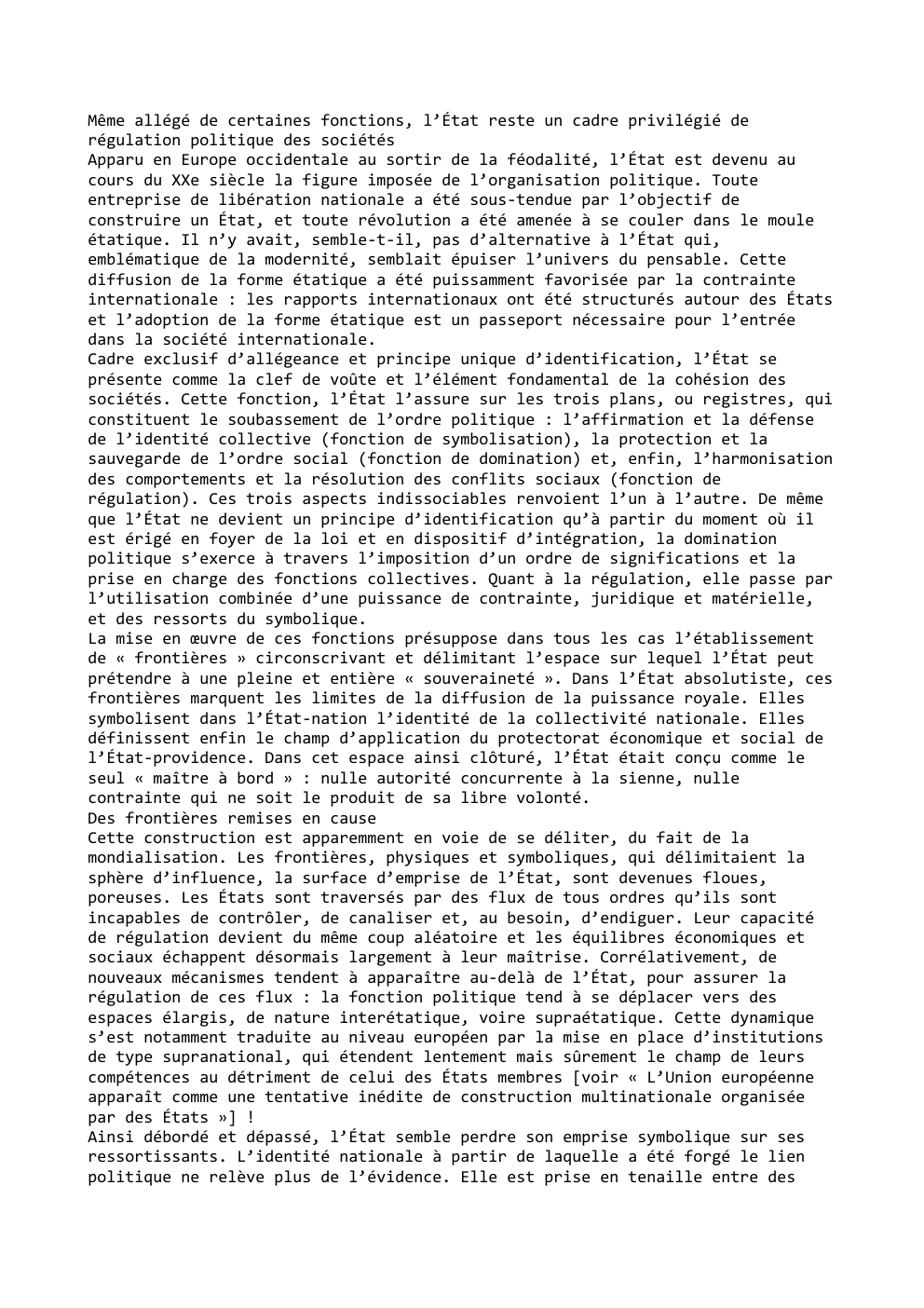Même allégé de certaines fonctions, l’État reste un cadre privilégié de régulation politique des sociétés Apparu en Europe occidentale au...
Extrait du document
«
Même allégé de certaines fonctions, l’État reste un cadre privilégié de
régulation politique des sociétés
Apparu en Europe occidentale au sortir de la féodalité, l’État est devenu au
cours du XXe siècle la figure imposée de l’organisation politique.
Toute
entreprise de libération nationale a été sous-tendue par l’objectif de
construire un État, et toute révolution a été amenée à se couler dans le moule
étatique.
Il n’y avait, semble-t-il, pas d’alternative à l’État qui,
emblématique de la modernité, semblait épuiser l’univers du pensable.
Cette
diffusion de la forme étatique a été puissamment favorisée par la contrainte
internationale : les rapports internationaux ont été structurés autour des États
et l’adoption de la forme étatique est un passeport nécessaire pour l’entrée
dans la société internationale.
Cadre exclusif d’allégeance et principe unique d’identification, l’État se
présente comme la clef de voûte et l’élément fondamental de la cohésion des
sociétés.
Cette fonction, l’État l’assure sur les trois plans, ou registres, qui
constituent le soubassement de l’ordre politique : l’affirmation et la défense
de l’identité collective (fonction de symbolisation), la protection et la
sauvegarde de l’ordre social (fonction de domination) et, enfin, l’harmonisation
des comportements et la résolution des conflits sociaux (fonction de
régulation).
Ces trois aspects indissociables renvoient l’un à l’autre.
De même
que l’État ne devient un principe d’identification qu’à partir du moment où il
est érigé en foyer de la loi et en dispositif d’intégration, la domination
politique s’exerce à travers l’imposition d’un ordre de significations et la
prise en charge des fonctions collectives.
Quant à la régulation, elle passe par
l’utilisation combinée d’une puissance de contrainte, juridique et matérielle,
et des ressorts du symbolique.
La mise en œuvre de ces fonctions présuppose dans tous les cas l’établissement
de « frontières » circonscrivant et délimitant l’espace sur lequel l’État peut
prétendre à une pleine et entière « souveraineté ».
Dans l’État absolutiste, ces
frontières marquent les limites de la diffusion de la puissance royale.
Elles
symbolisent dans l’État-nation l’identité de la collectivité nationale.
Elles
définissent enfin le champ d’application du protectorat économique et social de
l’État-providence.
Dans cet espace ainsi clôturé, l’État était conçu comme le
seul « maître à bord » : nulle autorité concurrente à la sienne, nulle
contrainte qui ne soit le produit de sa libre volonté.
Des frontières remises en cause
Cette construction est apparemment en voie de se déliter, du fait de la
mondialisation.
Les frontières, physiques et symboliques, qui délimitaient la
sphère d’influence, la surface d’emprise de l’État, sont devenues floues,
poreuses.
Les États sont traversés par des flux de tous ordres qu’ils sont
incapables de contrôler, de canaliser et, au besoin, d’endiguer.
Leur capacité
de régulation devient du même coup aléatoire et les équilibres économiques et
sociaux échappent désormais largement à leur maîtrise.
Corrélativement, de
nouveaux mécanismes tendent à apparaître au-delà de l’État, pour assurer la
régulation de ces flux : la fonction politique tend à se déplacer vers des
espaces élargis, de nature interétatique, voire supraétatique.
Cette dynamique
s’est notamment traduite au niveau européen par la mise en place d’institutions
de type supranational, qui étendent lentement mais sûrement le champ de leurs
compétences au détriment de celui des États membres [voir « L’Union européenne
apparaît comme une tentative inédite de construction multinationale organisée
par des États »] !
Ainsi débordé et dépassé, l’État semble perdre son emprise symbolique sur ses
ressortissants.
L’identité nationale à partir de laquelle a été forgé le lien
politique ne relève plus de l’évidence.
Elle est prise en tenaille entre des
identités de proximité et les liens de solidarité qui se développent au-delà de
l’État-nation.
De nouveaux espaces de citoyenneté tendent à se constituer,
mettant en cause la prétention de l’État à l’exclusivité.
Un risque de balkanisation
Cette balkanisation « identitaire » rend plus difficile le contrôle des
allégeances par l’État et comporte des dangers pour la cohésion politique.
L’accent mis sur les collectivités les plus proches d’appartenance - dotées de
compétences étendues, à la faveur des politiques de décentralisation -, plutôt
que sur la nation, risque de distendre le lien civique.
De même, la construction
d’espaces plus larges de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓