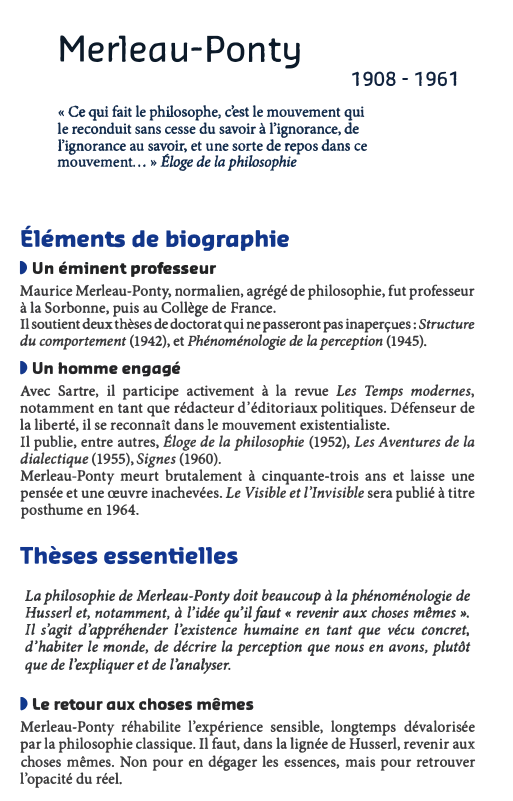Merleau-Ponty 1908 -1961 « Ce qui fait le philosophe, c6t le mouvement qui le reconduit sans cesse du savoir à...
Extrait du document
«
Merleau-Ponty
1908 -1961
« Ce qui fait le philosophe, c6t le mouvement qui
le reconduit sans cesse du savoir à l'ignorance, de
l'ignorance au savoir.
et une sorte de repos dans ce
mouvement...
» liage de la philosophie
Éléments de biographie
t Un éminent professeur
Maurice Merleau-Ponty, normalien, agrégé de philosophie, fut professeur
à la Sorbonne, puis au Collège de France.
Il soutient deux thèses de doctorat qui ne passeront pas inaperçues: Structure
du comportement (1942), et Phénoménologie de la perception (1945).
t Un homme engagé
Avec Sartre, il participe activement à la revue Les Temps modernes,
notamment en tant que rédacteur d'éditoriaux politiques.
Défenseur de
la liberté, il se reconnaît dans le mouvement existentialiste.
Il publie, entre autres, Éloge de la philosophie (1952), Les Aventures de la
dialectique (1955), Signes (1960).
Merleau-Ponty meurt brutalement à cinquante-trois ans et laisse une
pensée et une œuvre inachevées.
Le Visible et l'Invisible sera publié à titre
posthume en 1964.
Thèses essentielles
La philosophie de Merleau-Ponty doit beaucoup à la phénoménologie de
Husserl et, notamment, à l'idée qu'il faut« revenir aux choses mêmes».
Il s'agit d'appréhender l'existence humaine en tant que vécu concret,
d'habiter le monde, de décrire la perception que nous en avons, plutôt
que de l'expliquer et de l'analyser.
t le retour aux choses mêmes
Merleau-Ponty réhabilite l'expérience sensible, longtemps dévalorisée
par la philosophie classique.
Il faut, dans la lignée de Husserl, revenir aux
choses mêmes.
Non pour en dégager les essences, mais pour retrouver
l'opacité du réel.
« La science manipule les choses et renonce à les habiter » (L'Œil et
['Esprit) : elle invente une représentation du monde en le pensant de
manière systématisée et, ce faisant, occulte ce qui est del 'ordre du vécu.
En
cherchant la vérité derrière les apparences qu'elle considère trompeuses,
elle s'interdit de la trouver.
Nous sommes dans la vérité, elle n'est ni à
construire, ni à découvrir dans un au-delà.
La visée de Merleau Ponty est phénoménologique: il s'agit de substituer à
la question de l'efficacité, induite par un univers toujours plus technique,
celle du sens, et pour cela de revenir à l'opacité du monde dont la science
voudrait se défaire en l'éclairant par ce qu'il n'est pas.
Retrouver le sens
de l' être exige de revenir aux phénomènes, au monde sensible tel qu'il est
perçu dans son immédiateté.
t l'existence comme engagement
L'homme n'est pas un simple spectateur impartial et passif du théâtre du
monde.
En tant qu'existant, il est engagé dans le monde, surgit en lui:
« L'existence au sens moderne, c'est le mouvement par lequel l' homme est
au monde, s'engage dans une situation physique et sociale qui devient son
point de vue sur le monde.
,.
(Sens et non-sens).
L'homme n'est donc pas devant ni dans le monde, mais au monde : il
l'habite et le perçoit de manière active.
t La perception donatrice de sens
La perception n'est pas le fait de notre raison, comme le veut la théorie
intellectualiste.
Percevoir, ce n'est pas juger, interpréter des sensations
qui seraient la matière de la perception.
Ce n'est pas non plus enregistrer
passivement des impressions sensibles, contrairement à ce qu'affirme
l'empirisme : l'idée même de sensation pure est une abstraction qui
ne correspond aucunement à notre expérience.
« La sensation n'est
pas sentie », et les défenseurs de la théorie de la forme ont raison de
considérer que ce qui se donne à nous dans la perception est une totalité,
un ensemble constitué.
Mais cette forme n'est pas non plus une forme objective indépendante
de l'activité de l'être percevant: dans la perception, nous donnons une
signification subjective aux événements perçus.
Percevoir une chose, c'est
lui donner un sens pour soi.
Le sujet vivant, que Merleau-Ponty nomme le « corps propre », constitue
le centre actif de la perception : le monde est empli de nous-mêmes, il
reflète nos sentiments, points de vue et est alors à cent lieues du monde
objectif que présente la science.
t le refus du dualisme
En voulant rendre compte de l'expérience vécue, Merleau-Ponty en vient
à refuser tout dualisme : le sensible et le spirituel sont indiscernables, il
n'y a pas d'un côté la matière et de l'autre l'esprit, mais une unité.
En effet, c'est en tant que corps propre que je perçois.
Le corps propre,
centre de la perception, conscience incarnée, ne se réduit pas à un morceau
de matière, il désigne le corps que je suis, non celui que j'ai.
Ainsi, au lieu
d'opposer corps et esprit, il faut les comprendre dans leur union.
t La chair
Par son corps, l'homme est pris dans le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓