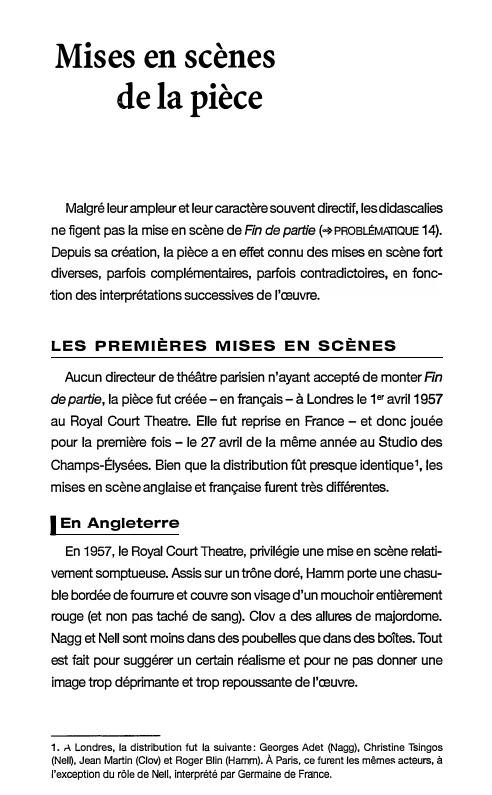Mises en scènes de la pièce Malgré leur ampleur et leur caractère souvent directif, les didascalies ne figent pas la...
Extrait du document
«
Mises en scènes
de la pièce
Malgré leur ampleur et leur caractère souvent directif, les didascalies
ne figent pas la mise en scène de Fin de partie (➔ PROBLÉMATIQUE 14).
Depuis sa création, la pièce a en effet connu des mises en scène fort
diverses, parfois complémentaires, parfois contradictoires, en fonc
tion des interprétations successives de l'œuvre.
LES PREMIÈRES MISES EN SCÈNES
Aucun directeur de théâtre parisien n'ayant accepté de monter Fin
de partie, la pièce fut créée - en français - à Londres le 1 er avril 1957
au Royal Court Theatre.
Elle M reprise en France - et donc jouée
pour la première fois - le 27 avril de la même année au Studio des
Champs-Élysées.
Bien que la distribution fût presque identique\ les
mises en scène anglaise et française furent très différentes.
1 En Angleterre
En 1957, le Royal Court Theatre, privilégie une mise en scène relati
vement somptueuse.
Assis sur un trône doré, Hamm porte une chasu
ble bordée de fourrure et couvre son visage d'un mouchoir entièrement
rouge (et non pas taché de sang).
Clov a des allures de majordome.
Nagg et Nell sont moins dans des poubelles que dans des boîtes.
Tout
est fait pour suggérer un certain réalisme et pour ne pas donner une
image trop déprimante et trop repoussante de l'œuvre.
1.
A Londres, la distribution fut la suivante: Georges Adet (Nagg), Christine Tsingos
(Nell), Jean Martin (Clov) et Roger Blin (Hamm).
A Paris, ce furent les mêmes acteurs, à
l'exception du rôle de Nell, interprété par Germaine de France.
Parce qu'il le juge contraire à son texte et à l'idée qu'il s'en fait,
Beckett désapprouve ce choix, auquel il ne peut toutefois s'opposer.
Le jeu des acteurs ne l'enthousiasme pas davantage.
li leur reproche de trop ouvertement montrer qu'ils jouent, qu'ils incarnent
des personnages, au lieu d'être ces personnages.
Presque tout en
somme le déçoit: « La création en français au Royal Court a été
assez sinistre, comme de jouer devant l'acajou, ou plutôt du teck»,
écrit-il d'ailleurs à l'un de ses amis 1.
L'allusion à l'acajou suggère
que Beckett regrette un parti pris trop ostentatoire ou commercial.
IEn France
La reprise de la pièce au Studio des Champs-Élysées opte pour
le parti inverse.
Roger Blin propose une mise en scène minimaliste.
Le décor est le plus dépouillé qui soit, conformément aux didascalies
initiales.
Tout réalisme disparaît au profit d'une plus grande intemporalité.
Hamm ne porte plus qu'un manteau en loques et son trône
anglais devient un simple fauteuil en bois à roulettes.
L'interprétation
se veut alors plus proche de la tragédie que de la comédie.
Elle a la
simplicité du désespoir, d'une« fin de partie».
L'accueil que reçoit la
pièce est nettement plus chaleureux qu'à Londres.
BECKETT METTEUR EN SCÈNE
DE BECKETT
Beckett a lui-même réalisé deux mises en scène de sa pièce:
l'une pour une représentation donnée en Allemagne au Schiller
Theater de Berlin en 1967; et l'autre, aux États-Unis, pour une
représentation donnée en 1980 au pénitencier de San Quentin.
Les notes que Beckett a rédigées pour sa mise en scène berlinoise montrent l'importance qu'il accordait d'une part à la gestuelle des acteurs, d'autre part à leur diction.
1.
Lettre à Alan Schneider, publiée dans le journal The Village Voice Reader sous le titre
• Beckett's Letters on Endgame • (Garden City, New-York, Doubleday, 1962), p.
184.
124
PROBLÉMATIQUES ESSENTIELLES
1
l
1Une gestuelle minutieuse
Pour Beckett, un personnage c'est d'abord une attitude, un
comportement.
Aussi les définit-il avec une précision et une minutie extrêmes.
Voici ce qu'il écrit à propos de la prière que Hamm
souhaite réciter et faire réciter (p.
73-74):
Hamm serre les mains pour le premier« Prions Dieu" [p.
73].
Desserre [les mains] sur « Ily a un rat».
Resserre surtout à l'heure [en même temps] pour le second« Prions
Dieu».
Clov serre les mains sur« Allons-y».
Nagg serre les mains sur « Vous y êtes?».
Hamm desserre les mains sur «Alors?"·
Clov desserre les mains sur « Je t'enfous».
Nagg desserre les mains sur «Macache» 1•
Comme on peut s'en rendre compte par cet exemple, chaque
réplique possède sa traduction physique, et toutes donnent l'impression d'un ensemble chorégraphique.
1Un débit et une diction très calculés
De la même façon, Beckett privilégie les variations sonores:
Les répliques de Nagg et de Nell doivent être dites três rapidement et« sans timbre»[ .•.] Les constatations qui se répètent le
sont avec une violence indignée, les ricanements et les reproches
accentuent le jeu dans le jeu.
Nell et Nagg sont réduits au seul jeu
de leurs voix et de leurs regards qui prennent ici tout leur relief2.
Les contrastes, ainsi vocalement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓