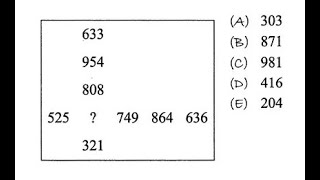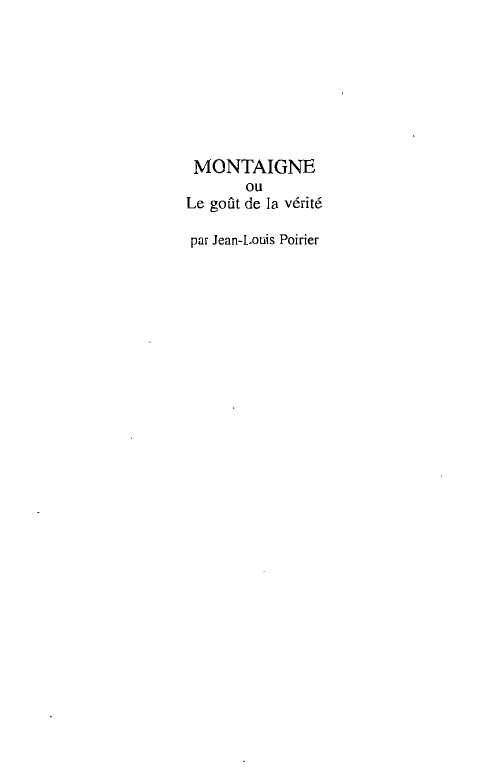MONTAIGNE ou Le goût de la vérité par Jean-Louis Poirier ' Je festoie et caresse la vérité en quelque main...
Extrait du document
«
MONTAIGNE
ou
Le goût de la vérité
par Jean-Louis Poirier
'
Je festoie et caresse la vérité en quelque main que je la trouve.
Montaigne, Essais, III, 8.
J'aime ces mots, qui amollissent et
modèrent la témérité de nos propositions : A l'aventure, Aucunement, Quelque, On dit, Je pense, et semblables.
Montaigne, Essais, III, 11.
Un philosophe à part entière
S'il est vrai, comme dit Husserl, que la philosophie est
une tâche commune», Montaigne est sans doute le plus
exemplaire des philosophes : les Essais organisent un vertigineux travail de la citation, où, sans rhétorique aucune,
Montaigne intériorise une exceptionnelle activité de lecture
qui, lumineusement restituée dans l'écriture d'un texte,
donne naissance à l'œuvre philosophique la plus singulière
et la plus attachante, la plus rigoureusement pensée, et la
plus profondément enracinée dans la communauté vivante
des philosophes.
On ne comprendra rien à Montaigne sf on ne comprend
pas d'abord en quel sens essentiel ce philosophe fut un écrivain, indissociablement écrivain et philosophe.
A une tradition littéraire qui n'a troyvé dans Montaigne qu'une autorité
pour recouvrir un culte frivole de l'impressionnisme et de
la subjectivité, il faut résolument opposer une pensée inséparable de son style : point d'ornements, mais l'identité,
dans la patience de l'écriture, de l'idée et de son expression.
C'est pourquoi Je texte des Essais, qui se présente selon les
trois couches des éditions successives (1580, 1588, 1595),
est, en vérité, d'un seul tenant: le travail de reprise, d'addition ou de correction, traduit, mot à mot, le travail de sédi«
-214
Montaigne
mentation de la pensée, il réfléchit dans le style ce fait que
penser n'est jamais simple, que penser c'est d'abord se
demander ce qu'on pense, et qu'aucune pensée ne saurait
jamais être une dernière pensée.
Ironie et scepticisme
Lire Montaigne d'après l'idée qu'il est philosophe, c'est
donc recueillir soigneusement, d'un bout à l'autre, l'ironie
de sa démarche, ne jamais la fixer, mais toujours, en revenant à Socrate, son maître, apprécier cette pente qui, si l'on
n'y prend garde, discrédite toute idée, à l'affirmer trop vite,
trop uniment ou trop lourdement.
La difficulté de lire Montaigne, qui fait oublier parfois qu'il est philosophe, c'est
qu'il n'a pas de doctrine : non seulement ses idées ne font
pas système, mais aucune n'est jamais strictement affirmée.
Bien plus, les citations débordent toujours sur le texte, s'y
fondent, et l'on ne sait ce qui doit être imputé à l'auteur.
On
se méprendrait pourtant à trouver là une simple compilation
érudite : l'esprit même de Montaigne est dans cette façon,
active et nuancée, d'habiter les livres et les pensées.
Tel est ce qu'on appellera correctement le scepticisme de
Montaigne, qui explique et transfigure une érudition heureuse.
Le scepticisme de I' Antiquité, illustré par Pyrrhon
(Ive siècle av.
J.-C.), tel que nous le connaissons par Sextus
Empiricus (me siècle apr.
J.-C.), est cette méthode philosophique qui cherche à obtenir la tranquillité par la « suspension du jugement».
C'est en opposant les unes aux autres
des représentations de même force qu'on apprend à ne plus
donner son assentiment à aucune et qu'on parvient à la suspension du jugement.
On peut bien dire que Montaigne est
pyrrhonien, car il a lu Sextus Empiricus et en a intériorisé
la leçon.
L'érudition est la conséquence naturelle du scepticisme : il faut avoir lu tous les livres pour en arriver à
- suspendre son jugement, après avoir fait le tour de toutes
les opinions.
Mais le scepticisme de Montaigne n'est pas
une allégeance doctrinale au pyrrhonisme antique : il le
renouvelle et l'accomplit, il le déploie d'une façon incomparablement plus souple, où il devient, presque exclusive-
Montaigne
215
ment, une activité du jugement.
La tranquillité est acquise,
mais ce n'est pas le calme : c'est le bonheur de découvrir,
comme vérité de la suspension du jugement, l'exercice
incessant du jugement.
Rien n'est définitif, le jugement
peut se reprendre à tout instant, et ce qui demeure, à travers
l'étendue du savoir, c'est une perpétuelle capacité de réserver son assentiment, de retarder son approbation, qui est la
vie de l'intelligence.
Art de juger
Par quoi ce scepticisme est moderne.
Il n'a rien d'une
indifférence.
L'art de réserver son jugement, plus qu'un
moyen d'apaiser l'inquiétude du vrai, devient, constamment, dans chaque phrase, dans chaque lecture, un art de
juger en intériorisant, en refusant toute démission : ainsi
apparaît clairement, au cœur du jugement, une puissance de
nier, une puissance de douter, identique à ! 'intelligence, qui
sera le ressort de la pensée moderne.
Avant Descartes,
Montaigne a mis en œuvre le doute systématique, compris
l'identité de l'acte de penser et de l'acte de douter : il a,
dans l'entreprise des Essais, donné toute son envergure au
pyrrhonisme antique.
Mais il y a plus : cette méthode est
aussi recherche de la vérité et elle désigne une certitude qui
lui est propre.
Car ce scepticisme renoue, profondément,
avec le socratisme : on ne se débarrasse d'une vérité toute
faite que pour faire valoir la vérité de l'esprit dans le travail
de l'interrogation.
Peu de philosophes font voir un pareil
attachement à la vérité, manifestent pareille obstination à la
chercher : mais elle est redéfinie, et ce qui compte, plutôt
que sa possession, c'est la manière de la tenir ou de la
quérir.
Elle est façon de penser plutôt qu'objet de pensée.
Aussi cette recherche de la vérité, qui tend tous les
Essais, n'est-elle parfaitement visible que dans le style;
elle ne saurait être pesante, fixe et délibérée ; elle exprime
un goût pour la vérité, qui recherche en elle, avant tout une
saveur et un plaisir : la vérité se caresse.
Ce qu'on peut
appeler l'empirisme de Montaigne n'est pas une position
doctrinale concernant le sensible, mais un art de vivre et de
216
Montaigne
penser qui ne sépare pas l'âme et le corps, qui perçoit, avec
une acuité sans égale, le caractère vivant de l'intelligence
et de la vérité, c'est-à-dire leur présence.
Saisir les idées
les plus abstraites dans leur rugueux, dans leur coloration la
plus concrète, n'est pas talent littéraire, c'est ici puissance
philosophique.
Comment, donc, lire Montaigne ?
Il n'y a pas d'autre moyen qu'une fréquentation assidue,
soutenue par la confiance qu'on ne s'y perdra pas.
On
devra, à chaque instant, unir la vigilance à l'égard du concept, la précision à déterminer les idées, et le plaisir de
réserver son propre jugement.
Le lecteur n'a besoin que
d'attention, mais sans raideur.
Il faut cependant savoir que les Essais, qui sont un bré·viaire du jugement, ne sont pas des Confessions.
Certes
Montaigne précise dans l'avertissement Au Lecteur :
« C'est moi que je peins», et : « Je suis moi-même la
matière de mon livre.» Or, si l'on excepte un petit nombre
de passages au contenu autobiographique, l'ensemble du
livre est manifestement consacré à de tout autres questions,
qui n'ont rien à voir avec la personnalité de Montaigne ou
sa psychologie individuelle.
Et pourtant, il est bien vrai, et
il est fondamental de comprendre, que les Essais décrivent,
de part en part, une subjectivité.
Le refus poursuivi d'affirmer une doctrine s'explique dans le refus d'admettre une
objectivité.
Si, comme l'enseigne la tradition pyrrhonienne,
il n'y a que des phénomènes, il n'est rien, ni objet sensible,
ni représentation intellectuelle, qui ne soit pour une subjectivité singulière.
Nul ne peut sortir de la représentation et
la représentation est un rapport.
La fonction du moi de
Montaigne, dans les Essais, est de supporter, selon un subjectivisme cohérent, l'ensemble de nos représentations.
Il
n'y a pas d'extériorité et, en croyant parler des choses ou
les connaître, c'est, sans le savoir, de nous que nous parlons.
Ce subjectivisme, avant d'être un relativisme, est donc
tout socratique: se connaître soi-même, ce n'est pas, vainement, entreprendre une indiscrète introspection, c'est criti-
Montaigne
217
quer l'illusion d'objectivité, c'est lucidement rapporter nos
représentations à nous-mêmes.
Mettre en lumière, partout,
un point de vue subjectif qui s'ignore, c'est introduire dans
la connaissance et dans la vie l'exigence de la conscience
de soi et son effet destructeur.
La subjectivité se découvre
dans les choses et mesure qu'il n'y a rien de stable.
Lorsqu'il recense à peu près toutes les idées et tout le savoir de
son ·temps, c'est bien lui que peint Montaigne; car il ne
prétend pas examiner ces représentations hors de sa subjectivité, et c'est dans sa subjectivité ainsi consciente d'ellemême que ces représentations cessent de faire illusion.
Les Essais sont le contraire de Coiifessions
La subjectivité est donc ici une fonction philosophique
autour de laquelle tournent toutes les représentations, si bien
que·tout ce savoir, toute cette érudition, accumulés dans les
Essais sont, en fait, de l'ordre du savoir de soi.
Montaigne
peut se lire selon cette idée directrice qu'intérioriser notre
savoir, nos idées, notre culture revient à les critiquer.
et à les
juger.
L'exercice de la subjectivité est l'exercice même du
jugement : les Essais sont le contraire de Confessions, car
il s'agit d'intérioriser le monde en lui rendant sa dimension
subjective, et non d'extérioriser ou d'objectiver le moi.
La
défiance pyrrhonienne à l'égard du monde, de nos croyances, de nos impressions se nourrit à l'énergie du précepte
socratique de la connaissance de soi.
Le doute de Montaigne
se construit sur l'ironie, pointe de la subjectivité.
LA SUBJECTIVITE
Le moi
Tout le drame de Montaigne s'ordonne à l'impératif du
dieu de Delphes : « Regardez dans vous, reconnaissez-vous,
tenez-vous à vous.
» (III.
9).
Drame, parce que ce moi qui
218
Montaigne
est l'unique référence est un moi qui échappe.
L'impératif
de la conversion à soi n'est donc nullement une règle d'introspection ou de complaisance, et les Essais, dans leur
principe, sont le contraire d'un étalage de soi : « Je peins
principalement mes cogitations, sujet informe, qui ne peut
tomber en production ouvragère » (Il.
7).
Rigoureusement
insaisissable, parce qu'il n'est pas chose, le moi ne peut
s'apparaître à lui-même, comme dira Kant, que dans l'acte
qui le représente et qui, comme représentation, le constitue.
Indissociable de sa propre représentation, le moi n'a pas
d'unité objective, car celle-ci est l'effet de sa propre description : « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre
m'a fait, livre consubstantiel à son auteur» (Il.
18).
La quête du moi, solidaire d'une critique du moi, n'est
donc pas de nature psychologique.
C'est pourquoi elle fait
mouvement dans deux directions opposées, qui partagent le
moi : d'un côté un moi phénoménal insaisissable et évanescent, reflet des circonstances et du monde, de l'autre un
moi essentiel qui demande appui et protection, mais qui
n'apparaît pas : « Ce ne sont mes gestes que j'écris, c'est
moi, c'est mon essence» (Il.
7).
On ne peut être plus net :
le moi véritable est tout sauf son histoire ou ses œuvres.
A chercher le moi du côté de l'extériorité, on le perd.
On
ne trouvera là que la subjectivité dont parle Protagoras dans
le Théétète de Platon, une rhapsodie de sensations jamais
objectivables : « Vraiment Protagoras nous en contait de
belles, faisant l'homme la mesure de toutes choses, qui ne
sut jamais seulement la sienne » (Il.
12).
L'extériorité livre
un moi inessentiel, fausse image qui ne vaut que parce
qu'elle circule, qui ne tient que dans la pseudo-cohérence
des représentations d'autrui : « Notre vérité de maintenant,
ce n'est pas ce qui est, mais ce qui se persuade à autrui :
comme nous appelons monnaie non celle qui est loyale seulement, mais la fausse aussi qui a mise » (Il.
18).
Le moi
s'échappe à lui-même parce qu'il est condamné à se saisir
dans le temps, seule forme selon laquelle il se présente à
lui-même, selon une unité qui reste toujours à faire et n'est
faite qu'après coup.
« Toujours en apprentissage et en
épreuve», toujours saisi à travers autre chose, à côté de lui,
le moi est emporté dans un mouvement qui interdit d'assi-
Montaigne
219
gner un être : « Je ne peins pas l'être.
Je peins le passage»
(III.
2).
Que le temps soit la forme phénoménale du moi
explique à la fois le caractère instable de l'écriture et le
statut vacillant du moi : « C'est un contrerolle de divers et
muables accidents et d'imaginations irrésolues et, quand il
y échoit, contraires : soit que je sois autre moi-même, soit
que je saisisse les sujets par autres circonstances et considérations » (III.
2).
Mais cette critique du moi, qui est un thème sceptique
constant, prend son sens plein dans le socratisme de Montaigne, en renvoyant précisément à un moi insaisissable,
mais substantiel et profond.
Ce moi véritable, qui est dissimulé et désigné par les Essais, n'est pas du côté d'un
homme universel que Montaigne a toujours tenu pour abstrait.
Contre les interprétations « humanistes », il faut rappeler le nominalisme de Montaigne : les représentations
universelles ne sont que des mots, seul existe et est substantiel l'individu.
Que « chaque homme porte la forme entière
de l'humaine condition» (III.
2), loin de signifier que chaque homme exprime l'universel, veut dire qu'il n'y a pas
d'humanité en soi, séparée de chaque individu.
Le moi véritable, absolument singulier et absolument réel, substantiel
parce qu'il demeure le même sous les accidents, doit valoir
contre une apparence avec laquelle nous sommes toujours
tentés de le confondre.
Il faut « distinguer la peau de la
chemise » (III.
10), et notre essence réelle ne peut être
atteinte que contre le masque que nous présentons à autrui,
contre la comédie· (« La plupart de nos vacations sont farcesques », III.
10) que nous jouons dans la société et qui
nous trompe nous-mêmes.
Le précepte socratique enseigne
d'avoir à se retrouver soi-même derrière les personnages
sociaux auxquels on s'identifie.
Se connaître soi-même ne
peut donc résulter d'une description qui en reste à la surface, mais seulement d'une conversion pratique à l'exigence de maîtrise de soi : exister, c'est-s'arracher au monde
et se poser soi-même, en se donnant à soi-même sa loi.
Le
platonisme de Montaigne (cf le Gorgias) transfigure son
scepticisme : « Retirez-vous en vous, mais préparez-vous
premièrement de vous y recevoir : ce serait folie de vous
fier à vous-mêmes, si vous ne vous savez gouverner.
» (1.
39).
220
Montaigne
Pour se connaître soi-même, il faut d'abord se gouverner
soi-même, bref, être quelqu'un.
Revenir à soi-même, cette tâche s'accomplit contre ce
qui, au plus près de nous, nous sépare de nous-mêmes, ou
y crée le tumulte : le temps et l'imagination.
Le temps
Le temps est la forme selon laquelle le moi s'apparaît à
lui-même, ce pourquoi il ne se saisit que par esquisses et
toujours à côté, selon le « déjà plus » ou le « pas encore».
Plus profondément, comme « prévoyance et sollicitude de
l'avenir» (1.
3), le temps résume l'inquiétude (« sollicitude » = souci) et le malheur de l'homme, exprime sa noncoïncidence _avec lui-même et avec le monde, sa dépossession ontologique : « Nous ne sommes jamais chez nous,
nous sommes toujours au-delà» (1.3).
La crainte, le désir,
1' espérance sont représentations qui nous emportent au-delà
de nous, et, en ce sens, cette sagesse épicurienne qui veut
nous épargner le souci de l'avenir et recommande çie vivre
dans l'instant doit être comprise, socratiquement, comme
invitant au retour à soi-même.
Mais, forme même de notre représentation, le temps
caractérise notre subjectivité comme radicalement impuissante à retenir l'être substantiel, l'inconstance est notre lot
et marque les limites de notre connaissance : « Finalement,
il n'y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de
celui des objets.
Et nous, et notre jugement, et toutes choses
mortelles, vont coulant et roulant sans cesse.
Ainsi il ne se
peut établir rien de certain de l'un à l'autre, et le jugement
et le jugé étant en continuelle mutation et branle.
» (II.
12).
Marqué par le devenir, l'homme est donc privé de toute
« communication à l'être», l'être des choses, comme le
sien propre.
Le fond du scepticisme, qui récuse toute connaissance objective, est dramatique: il est conscience d'une
instabilité foncière, conscience du leurre de toute objectivité, par quoi la connaissance de soi s'achève en une
réflexion sur la finitude, si bien que le scepticisme pourrait
préparer à la foi (cf.
II.
12, fin).
Montaigne
221
Les sens et l'imagination
Incapable de s'atteindre lui-même, le moi se perd encore
par son incapacité à atteindre des objets.
Une rigoureuse
critique del'imagination (c'est-à-dire des sens) réduit toute
objectivité : aucune connaissance ne peut découler de ce
que nous livrent nos sens.
Montaigne développe jusqu'au
bout le thème sceptique du refus de la « représentation
compréhensive », affirmant que nos impressions sensibles
ne sont représentatives que par illusion, ne portant la marque d'aucun objet.
« L'incertitude et la faiblesse de nos
sens» sont « le plus grand fondement et preuve de notre
ignorance » (II.
12).
L' Apologie de Raimond Sebond
(II.
12) recueille la liste des contradictions de nos sens,
qui en détruit l'autorité.
Ils ne permettent aucune certitude,
limités et contingents, ils ne se comprennent pas même les
uns les autres.
De leur confusion naissent toutes les représentations imaginables, et, contre Epicuriens et Stoïciens,
ce sont les sens comme tels qu'il faut récuser, et.non les
seuls jugements ou opinions que nous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓