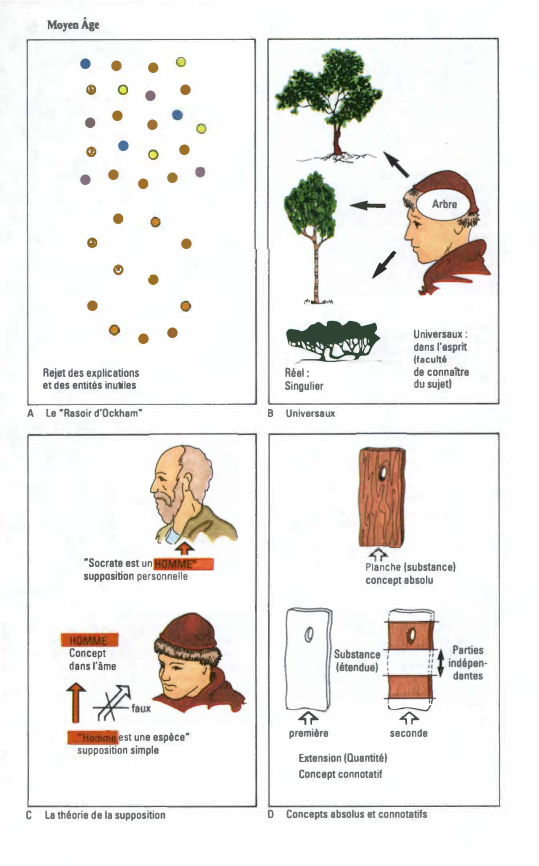Moyen Âge • • •• • • • • • • •• • •• • • • ••• • •...
Extrait du document
«
Moyen Âge
• • ••
• • • •
• • ••
• •• • •
• •••
• •
•
•
• •
•
•
• • •
0
0
0
0
�
½l9
Rejet des explications
et des entités inutiles
A
Le "Rasoir d'Ockham•
/
Réel:
Singulier
B
Universaux:
dans l'esprit
(faculté
de connaître
du sujet)
Universaux
"Socrate est un
supposition personnelle
Planche (substance)
concept absolu
Concept
dans l'âme
◊
première
est une espèce·
supposition simple
C
La théorie de la supposition
�
seconde
Extension (Quantité)
Concept connotatif
0
Concepts absolus et connotatifs
Scolastique tardive/ Guillaume d'Ockham
Guillaume d'Ockham (vers 1280-vers 1348) est à
l'origine d'un courant philosophique dont les
principes préparent la pensée moderne.
Le mou
vement entamé par ÜCKHAM constitue la « nou
velle voie" (via moderna) opposée à « I 'ancieMe
voie" (via antiqua) des écoles rattachées à
ALBERT LE GRAND.
St TlloMAS.
et DuNS Sror.
Deux principes servent à fonder la théorie philo
sophique d'ÜCKHAM:
- Le prindpe dit d'omnipotenœ selon lequel
Dieu, du fait de sa toute-puissance, aurait pu
aussi créer les choses autrement, et que cc qu'il
produit par la médiation de causes temporelles
(l'enchaînement naturel des causes dans le
monde), il peut aussi le produire lui-même sans
médiation.
Il s'ensuit que nous ne pouvons pas
davantage conna.i"tre l'existence des choses, que
leur enchaînement selon l'ordre de la n6ccssité.
Aucun être A n'implique en soi l'existence
n6cessaire de B.
On peut uniquement affirmer
que B suit A régulièrement et naturellement
(par exemple la fumée après le feu).
Le monde créé apparaît ainsi pour l'homme
comme un enchaînement de faits contingents.
Ce ne sont pas des fondements a priori qui ren
dent sa coMaissance possible, mais I'exp«!
rience et l'étude de ce qui arrive et qui se pro
duit concrètement.
- Le principe dit d'économie (le Rasoir d' Ock
ham) selon lequel :
« On ne doit jamais multiplier les êtres sans
n6cessité (pluritas numquam est ponenda.
sine
necessitate).
"
Recourir à l'universel pour expliquer l'indivi
duel a pour seul effet de dédoubler artificielle
ment les êtres, sans expliquer quoi que cc soit.
Il s'ensuit que tous les principes qui ne sont pas
n6cessaires à l'explication d'une chose sont
superflus et doivent être rejetés.
Ce principe iœthodique implique aussi wie cri
tique Jœtaphysique fO!ldœ sur la conception que
se fait ÜCKHAM du langage.
Il s'oppose aux fausses
croyances d'�s lesquelles à toute expression
verl>ale devrait conespondre wie réalité.
Cc qui
conduit à wie multiplication injustifiée des entités
en vertu de simples données du langage.
Dans la Querelle des Universaux, ÜCKHAM adopte
un point de vue nominaliste.
Seul le singulier est
réel.
C'est pourquoi ÜCKHAM n'emploie aucun
principe d'individuation, puisque tout être est
créé individuellement par Dieu.
Cc qui est uni
versel existe uniquement dans l'esprit (in mente).
« Je pense fermement que rien d'universel
n'existe de quelque façon que ce soit hors de
l'âme, mais tout cc....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓