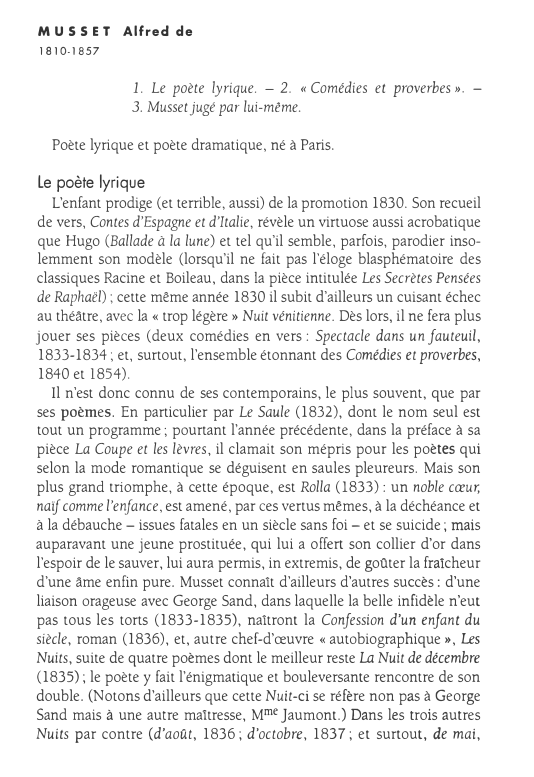MUSSET Alfred de 1810-1857 1. Le poète lyrique. - 2. « Comédies et proverbes». 3. Musset jugé par lui-même. Poète...
Extrait du document
«
MUSSET Alfred de
1810-1857
1.
Le poète lyrique.
- 2.
« Comédies et proverbes».
3.
Musset jugé par lui-même.
Poète lyrique et poète dramatique, né à Paris.
Le poète lyrique
L'enfant prodige (et terrible, aussi) de la promotion 1830.
Son recueil
de vers, Contes d'Espagne et d'Italie, révèle un virtuose aussi acrobatique
que Hugo (Ballade à la lune) et tel qu'il semble, parfois, parodier inso
lemment son modèle (lorsqu'il ne fait pas l'éloge blasphématoire des
classiques Racine et Boileau, dans la pièce intitulée Les Secrètes Pensées
de Raphaël); cette même année 1830 il subit d'ailleurs un cuisant échec
au théâtre, avec la «trop légère » Nuit vénitienne.
Dès lors, il ne fera plus
jouer ses pièces (deux comédies en vers: Spectacle dans un fauteuil,
1833-1834; et, surtout, l'ensemble étonnant des Comédies et proverbes,
1840 et 1854).
Il n'est donc connu de ses contemporains, le plus souvent, que par
ses poèmes.
En particulier par Le Saule (1832), dont le nom seul est
tout un programme; pourtant l'année précédente, dans la préface à sa
pièce La Coupe et les lèvres, il clamait son mépris pour les poètes qui
selon la mode romantique se déguisent en saules pleureurs.
Mais son
plus grand triomphe, à cette époque, est Rolla (1833): un noble cœur;
naïf comme l'enfance, est amené, par ces vertus mêmes, à la déchéance et
à la débauche - issues fatales en un siècle sans foi - et se suicide ; mais
auparavant une jeune prostituée, qui lui a offert son collier d'or dans
l'espoir de le sauver, lui aura permis, in extremis, de goûter la fraîcheur
d'une âme enfin pure.
Musset connaît d'ailleurs d'autres succès: d'une
liaison orageuse avec George Sand, dans laquelle la belle infidèle n'eut
pas tous les torts (1833-1835), naîtront la Confession d'un enfant du
siècle, roman (1836), et, autre chef-d'œuvre «autobiographique», Les
Nuits, suite de quatre poèmes dont le meilleur reste La Nuit de décembre
(1835); le poète y fait l'énigmatique et bouleversante rencontre de son
double.
(Notons d'ailleurs que cette Nuit-ci se réfère non pas à George
Sand mais à une autre maîtresse, Mme Jaumont.) Dans les trois autres
Nuits par contre (d'août, 1836; d'octobre, 1837; et surtout, de mai,
1835), c'est avec sa «Muse» que dialoguera le poète; trop diaphane
allégorie qui ne parviendra pas à réchauffer ces poèmes en dépit de l'in
déniable éloquence qu'elle déploie.
Musset ici, comme dans Rolla et
dans La Confession d'un enfant du siècle est bien un homme de son
époque, un de ces innombrables fils de René, tempétueux et ravagés,
dont Chateaubriand dit, au même moment (dans les Mémoires qu'il lit
à Mme Récamier): « Si René n'existait pas, je ne l'écrirais pas, je ne
l'écrirais plus [ ...] Une famille de Renés poètes et de Renés prosateurs
a pullulé.»
Du moins, de tous ces« Renés poètes», comme dit leur père, Musset
est le seul qui ait cru à son rôle.
Alors qu'Hugo, Lamartine et Chateau
briand lui-même ne perdent nullement la tête, font la part de la passion
désintéressée et de l'action profitable, Musset reste, qu'il soit seul avec
sa rame de papier ou dans un salon, débordé par le tumulte qu'il a évo
qué; victime vraiment, comme Rolla, du « mal du siècle».
C'est ce
Musset-là, possédé par son lyrisme, qui va se laisser, tour à tour, dégra
der, réduire au silence, vieillir avant l'âge et mourir (à quarante
sept ans).
« Comédies et proverbes»
L'autre Musset, le Musset des Comédies et proverbes, n'est pas lié à sa
propre biographie; ni, surtout, aux courants esthétiques de son
époque, qu'il aborde même à rebours de leur avancée.
Après la rebuf
fade de La Nuit vénitienne, dès 1830, il décide que désormais, s'il lui
prend envie d'écrire quelque pièce de théâtre, il ne cédera pas à la ten
tation de la voir « sur scène».
Paradoxe, sans aucun doute; mais à la
faveur de quoi le trop vulnérable poète va pouvoir prendre ses dis
tances, tant avec le public de son temps qu'avec lui-même.
On a de la
peine à croire que c'est à l'époque où triomphent le tonitruant Hernani
(1830) de Hugo, l'Antony (1831) de Dumas père, le Chatterton (1835)
de Vigny, la Lucrèce Borgia et l'Angelo tyran de Padoue (1833 et 1835)
du même Hugo, que sont composés et publiés dans La Revue des Deux
Mondes - sans écho d'ailleurs - ces adorables et troublants Caprices de
Marianne (le chef-d'œuvre de Musset; 1833), On ne badine pas avec
l'amour et Fantasia (tous deux en 1834), Le Chandelier (1835) et, la
même année, Lorenzaccio.
De cette dernière œuvre, la plus longue et la
plus pathétique, nous essaierons, un peu plus loin, de montrer l'intérêt
(en soi, d'abord; et, de plus, en liaison avec la personnalité littéraire de
Musset, dont elle donne peut-être la clé).
MUSSET
À l'exception de Lorenzaccio, en effet, ce sont bien des« comédies», à
la manière de Marivaux, et des «proverbes» , à la manière du petitmaître Carmontelle.
Œuvres légères d'allure, où la cruauté n'est qu'effleurée.
Cependant, ces jeux « à demi-j eu» (comme disent les musiciens) ne constituent pas des œuvres de «demi-caractère».
C'est là, au
contraire, un exercice périlleux de corde raide entre les deux versants
du tragique et du comique, une chute sans cesse évitée ; et Les Caprices
de Marianne, en ce sens, approchent de la perfection: Octave et Célio,
les deux héros d'humeur opposée, ont en commun la grâce ; et que dire,
sur ce point, de Marianne? (Giraudoux seul sait faire parler les jeunes
filles avec cette simplicité ambiguë .) Mais l'art est d'avoir fait, de cette légèreté mëme, le ressort le plus puissant de l'émotion.
Et, lorsque Octave
pleure son ami Célio, tué devant les yeux de Marianne et pour l'amour
de Marianne, elle proposera à Octave de le consoler désormais par ses
sourires; à quoi Octave répond, de façon tout aussi simple et tout aussi
atroce :Je ne vous aime pas, Marianne, c'est Célio qui vous aimait.
Au demeurant, si Musset nous convainc toujours mieux lorsqu'il ne
parle pas de lui-même, on peut le reconnaître pourtant, dans certains
monologues où il s'abandonne au lyrisme.
(Ainsi dans Fantasia et aussi,
parfois, dans tels monologues féminins.) À moins encore qu'il ne préfère - comme il fit ailleurs : dans La Nuit de décembre - laisser dialoguer
entre elles ces « moitiés » de lui-même que sont par exemple Octave, le
libertin ironique, et Célio, le passionné.
Au surplus un tel chef-d'œuvre
d'équilibre instable entre deux tonalités n'est pas réalisé à tous coups, et
il advient qu'aux Caprices de Marianne succède une réussite plus formelle, plus facile .
Ainsi dans On ne badine pas avec l'amour, où, d'une
part, la dose de légèreté, si l'on peut dire, est un peu trop lourde (le
groupe d'hurluberlus ou de grotesques qui entourent le couple tragique
Perdican-Camille) tandis que, d'autre part, le pathétique, si tranchant et
si efficacement implicite à l'ordinaire, est ici noyé dans les remous d'une
déclamation redoutable : les « phoques» (dans la tirade de Perdican sur
l'amour) sont bien proches des «pélicans», père et enfants, qui agrémentaient de leurs « goitres hideux», « sanglantes mamelles» et « cris
sauvages», La Nuit de mai.
Toutefois, de tels écarts d'avec la formule
initiale sont peu fréquents; et Musset, même après le monumental
Lorenzaccio, n'hésite pas à revenir à la fantaisie , au menu « proverbe »:
Barberine (1835, avec sa délicieuse Chanson: Beau chevalier, qui semble
une vraie chanson populaire), Il ne faut jurer de rien (1836) et aussi, bref
chef-d'œuvre, Un caprice (1837) .
91
92
MUSSET
Or cette dernière pièce est représentée avec succès en Russie, et
frappe une actrice de passage, Mme Allan, qui alerte le public français,
et va entraîner de proche en proche la découverte de toute l'œuvre
théâtrale de Musset.
Mais il est bien tard (1847), et le poète, pratiquement muet depuis dix années, assistera quasi impuissant à ce triomphe,
ajoutant seulement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓