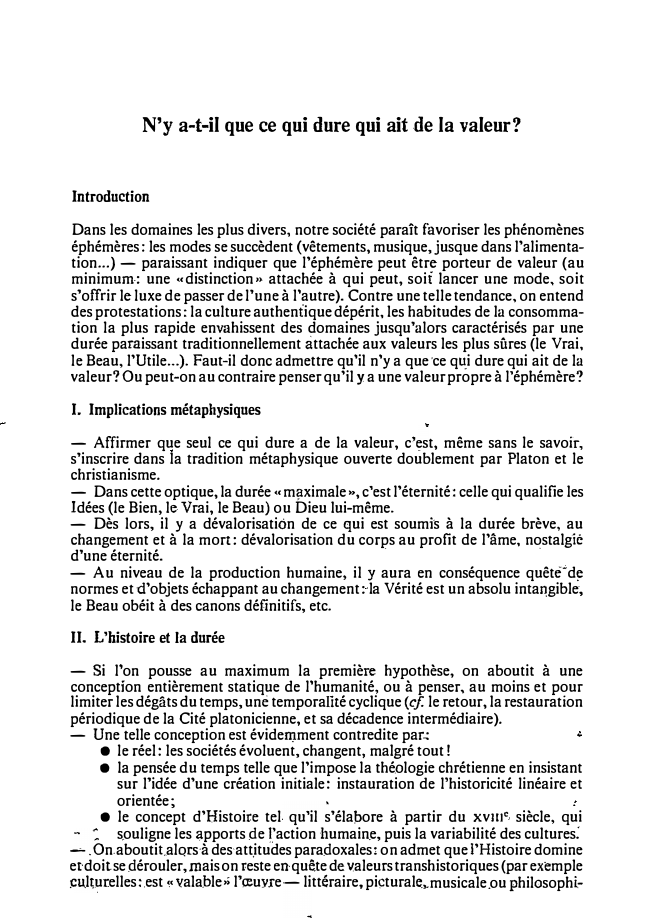N'y a-t-il que ce qui dure qui ait de la valeur? Introduction Dans les domaines les plus divers, notre société...
Extrait du document
«
N'y a-t-il que ce qui dure qui ait de la valeur?
Introduction
Dans les domaines les plus divers, notre société paraît favoriser les phénomènes
éphémères: les modes se succèdent (vêtements, musique, jusque dans l'alimenta
tion...) - paraissant indiquer que l'éphémère peut être porteur de valeur (au
minimum: une «distinction» attachée à qui peut, soif lancer une mode, soit
s'offrir le luxe de passer de l'une à l'autre).
Contre une telle tendance, on entend
des protestations: la culture authentique dépérit, les habitudes de la consomma
tion la plus rapide envahissent des domaines jusqu'alors caractérisés par une
durée paraissant traditionnellement àttachée aux valeurs les plus sûres (le Vrai,
le Beau, l'Utile...).
Faut-il donc admettre qu'il n'y a que·ce qu_i dure qui ait de la
valeur? Ou peut-on au contraire penser qu'il y a une valeur propre à l'éphémère?
I.
Implications métaphysiques
- Affirmer que seul ce qui dure a de la valeur, c'est, même sans le savoir,
s'inscrire dans la tradition métaphysique ouverte doublement par Platon et le
christianisme.
- Dans cette optique, la durée «m!lximale», c'est l'éternité: celle qui qualifie les
Idées (le Bien, le Vrai, le Beau) ou Dieu lui-même.
- Dès lors, il y a dévalorisation de ce qui est soumis à la durée brève, au
changement et à la mort: dévalorisation du corps
· au profit de l'âme, nostalgîë
·
d'une éternité.
- Au niveau de la production humaine, il y aura en conséquence quête"d!!
normes et d'objets échappant au changement: la Vérité est un absolu inta�gible�
le Beau obéit à des canons définitifs, etc.
II.
L'histoire et la durée
- Si l'on pousse au maximum la première hypothèse, on aboutit à une
conception entièrement statique de l'humanité, ou à penser, au moins et pour
limiter les dégâts du temps, unè temporalité cyclique (cf.
le retour, la restauration
périodique de la Cité platonicienne, et sa décadence intermédiaire).
- Une telle conception est évidellj.ment contredite par�
• le réel: les sociétés évoluent, changent, malgré tout!
• la pensée du temps telle que l'impose la théologie chrétienne en insistant
sur l'idée d'une création initiale: instauration de l'historicité linéaire et
orientée;
• le concept d'Histoire tel qu'il s'élabore à partir du xvm• siècle, qui
� s_ouligne les apports de l_'action humain.e, puis la variabilité des cultures:
--- .
On.aboutitalqrs·à des-att,itudes paradoxales: on admet que !'Histoire domine
et doit se dérouler, mais on reste enquête de valeurs transhistoriques (par exemple
J::Ulturelles: .est ,, valable,, l'œu:vre- littéraire, picturale,.
musicale .ou philosophi-
que - qui défie le temps et peu servir de modèle à tràvers les époques succe�sives).
- Développée au maxin:ium, la pensée de J.!Histoire déplace la Valeur (l'Etat, la
Liberté, le Communisme - selon que l'on suit Hegel ou Marx) vers un au-delà
de )'Histoire survenant à sa fin et récupérant certains aspects d'une durée
désormais délivrée du changement.
III.
Exigences de la consommation
- Dans un tel contexte, et jusque dans ses versions hegelienne et marxiste,
l'existence individuelle, parce que nécessairement limitée dans la durée, n'a de
valeur que par rapport à une humanité générale, qui l'englobe.
Les œuvres ont
bien une origine singulière (donc mortelle), mais elles n'acquièrent de valeur qu'en
la transcendant (en s'inscrivant dans une culture qui est au-delà de tous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓