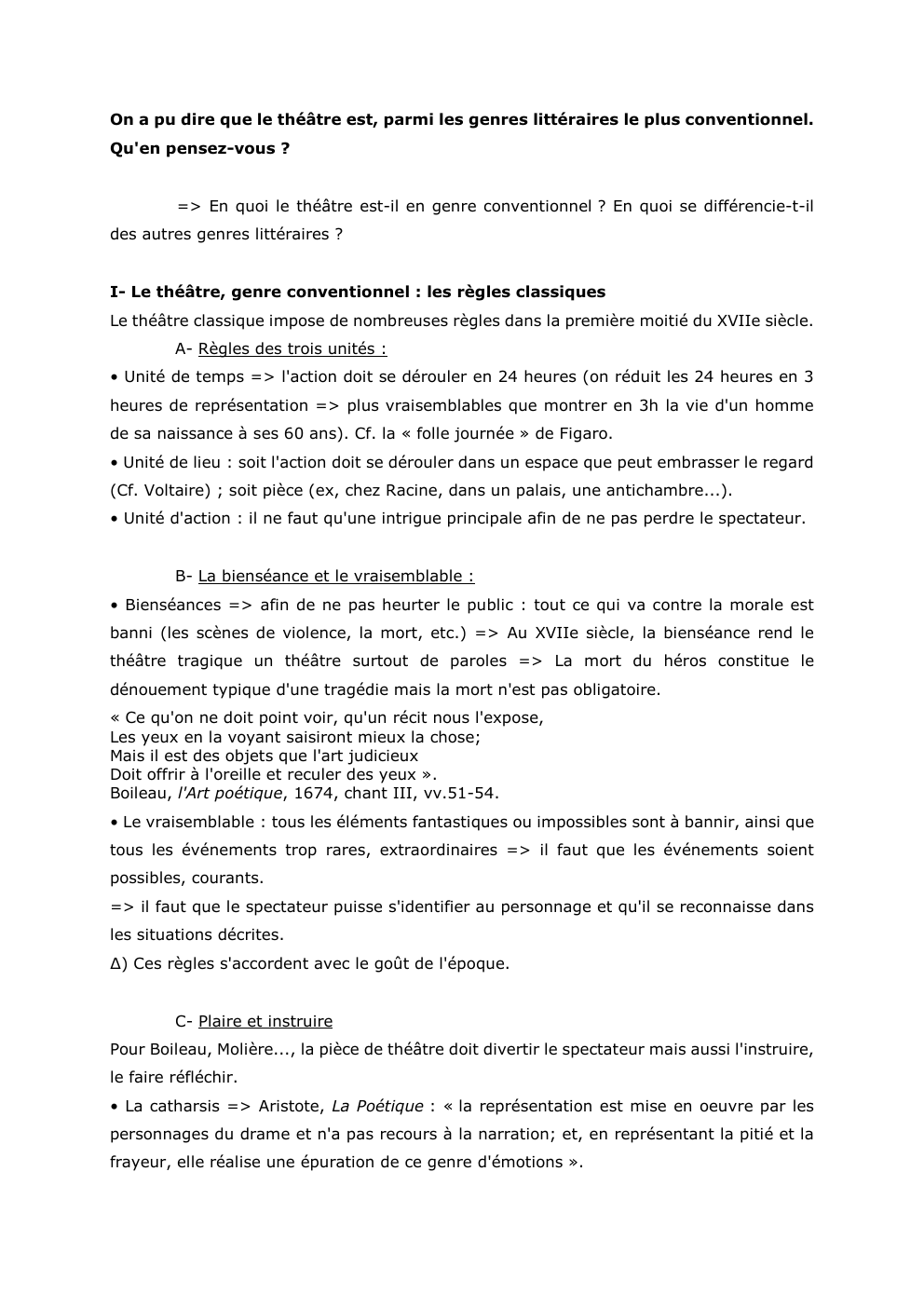On a pu dire que le théâtre est, parmi les genres littéraires le plus conventionnel. Qu'en pensez-vous ? => En...
Extrait du document
«
On a pu dire que le théâtre est, parmi les genres littéraires le plus conventionnel.
Qu'en pensez-vous ?
=> En quoi le théâtre est-il en genre conventionnel ? En quoi se différencie-t-il
des autres genres littéraires ?
I- Le théâtre, genre conventionnel : les règles classiques
Le théâtre classique impose de nombreuses règles dans la première moitié du XVIIe siècle.
A- Règles des trois unités :
• Unité de temps => l'action doit se dérouler en 24 heures (on réduit les 24 heures en 3
heures de représentation => plus vraisemblables que montrer en 3h la vie d'un homme
de sa naissance à ses 60 ans).
Cf.
la « folle journée » de Figaro.
• Unité de lieu : soit l'action doit se dérouler dans un espace que peut embrasser le regard
(Cf.
Voltaire) ; soit pièce (ex, chez Racine, dans un palais, une antichambre...).
• Unité d'action : il ne faut qu'une intrigue principale afin de ne pas perdre le spectateur.
B- La bienséance et le vraisemblable :
• Bienséances => afin de ne pas heurter le public : tout ce qui va contre la morale est
banni (les scènes de violence, la mort, etc.) => Au XVIIe siècle, la bienséance rend le
théâtre tragique un théâtre surtout de paroles => La mort du héros constitue le
dénouement typique d'une tragédie mais la mort n'est pas obligatoire.
« Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose,
Les yeux en la voyant saisiront mieux la chose;
Mais il est des objets que l'art judicieux
Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux ».
Boileau, l'Art poétique, 1674, chant III, vv.51-54.
• Le vraisemblable : tous les éléments fantastiques ou impossibles sont à bannir, ainsi que
tous les événements trop rares, extraordinaires => il faut que les événements soient
possibles, courants.
=> il faut que le spectateur puisse s'identifier au personnage et qu'il se reconnaisse dans
les situations décrites.
∆) Ces règles s'accordent avec le goût de l'époque.
C- Plaire et instruire
Pour Boileau, Molière..., la pièce de théâtre doit divertir le spectateur mais aussi l'instruire,
le faire réfléchir.
• La catharsis => Aristote, La Poétique : « la représentation est mise en oeuvre par les
personnages du drame et n'a pas recours à la narration; et, en représentant la pitié et la
frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d'émotions ».
Le spectateur se purge de ses passions en assistant à une tragédie => le théâtre est une
libération salutaire.
Prenez en exemple une tragédie que vous connaissez Phèdre,
Andromaque...
=> Pour les classiques, dont Boileau, le spectateur qui va au théâtre doit ressentir terreur
et pitié afin de se purger de ces sentiments => force du spectacle qui doit être extraordinaire.
• La comédie de Molière : Moraliste => écrivait ses comédies afin de faire prendre
conscience au spectateur de ses défauts.
Il mettait donc en scène nos travers afin que
nous en prenions conscience et que nous y remédions.
L'Avare : dans son esprit, le
spectateur qui voit Harpagon et son argent, son « cher ami » prend conscience du défaut
de l'avare, réalise qu'il est lui-même avare et donc décide de ne plus l'être.
∆) Ces règles assez strictes => théâtre genre conventionnel.
Toutefois, ces règles ont été
remises en question.
II- Les règles remises en question
A- Un cadre rigide mais favorable à l'oeuvre
Ces règles certes contraignantes ont pourtant permis à des auteurs de mettre en scène de
véritables chefs d'oeuvres joués des siècles après.
Ex : Racine a su utiliser de manière intelligente ces règles.
• Aimait écrire des pièces à partir de presque rien et se focaliser sur la crise => unité
d'action.
• Crise => cela peut donc se dérouler en quelques heures, pas de problème de temps.
• Pièce centrée sur la crise, pas besoin d'espaces => esthétique de la concentration
extrême, lieu tragique.
∆) La règle des trois unités a fourni à Racine un cadre idéal pour sa vision de la tragédie
=> l'essence du tragique est dans le personnage, pas dans les péripéties extérieures ;
Le tragique, qui va purger le spectateur, se joue donc dans le personnage => importance
d'un bon acteur (ex : une bonne Phèdre), du jeu et de la mise en scène.
B- Remise en cause des règles classiques
Corneille, par contre, remettait en question ces règles.
Pour lui, l'unité d'action limitait
l'intrigue et surtout, l'unité de temps lui semblait peu crédible :
Ex : en une journée, Rodrigue se bat deux fois en duel, mène une armée contre les Maures,
s'entretient avec son père, sa fiancée et le roi !
=> pas très vraisemblable, très contraignant.
• Volonté des dramaturges de s'affranchir des règles traditionnelles, jugées trop
contraignantes.
Ex : fin de la règle des trois unités.
Souci réalisme : on délaisse parfois le
vers pour la prose et on privilégie le pittoresque et l'émotion.
• Volonté de mêler « le sublime et le grotesque » (et pas d'écrire une pièce entièrement
tragique...).
NB : Avec le mélange d'actions, la complexité des personnages prônés par Hugo pour le
drame romantique...
on s'y perd ! Dans Hernani, parfois, le lecteur voudrait seulement
suivre l'histoire d'amour entre Dona Sol et Hernani et oublier l'intrigue politique très
compliquée.
R :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓