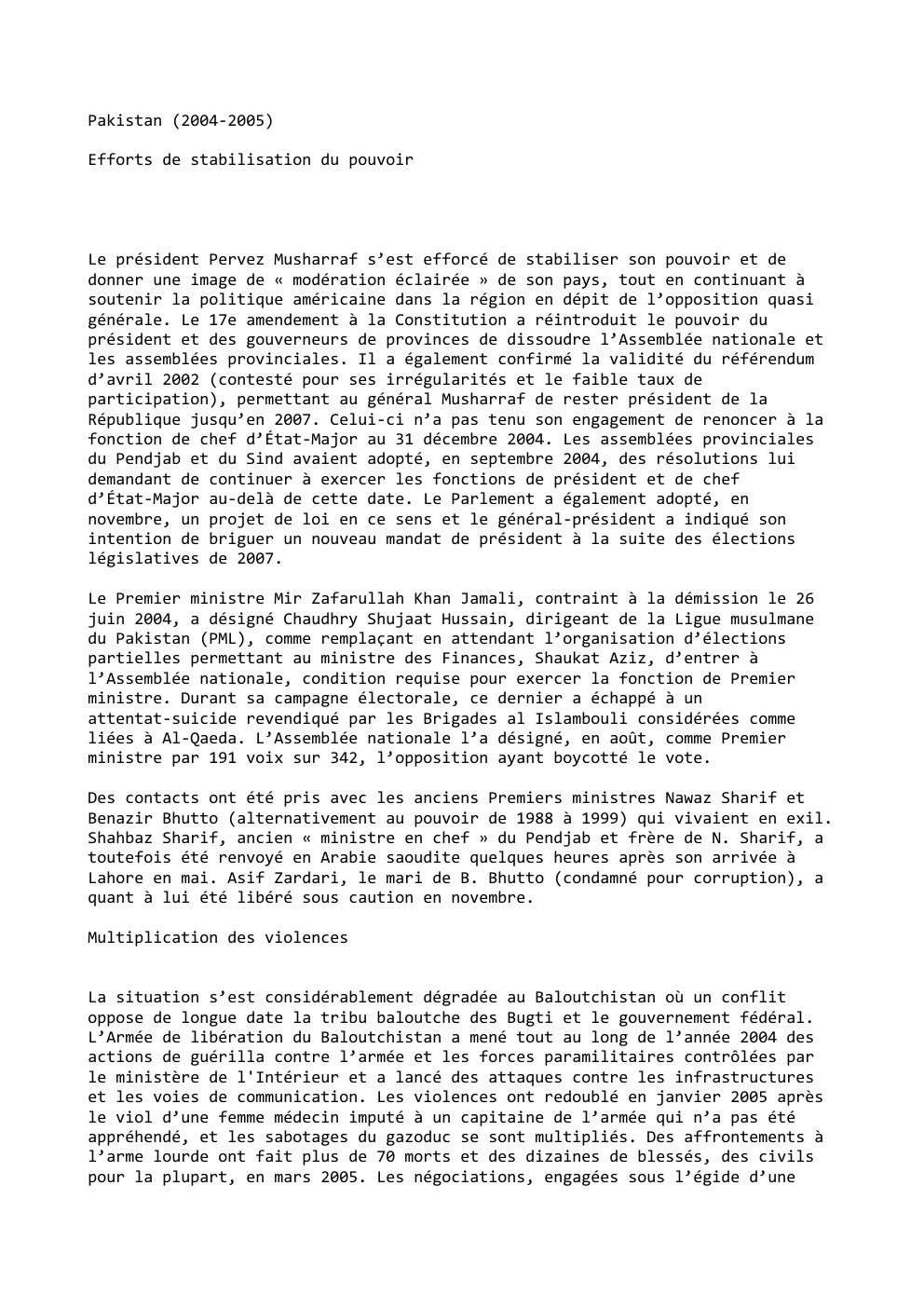Pakistan (2004-2005) Efforts de stabilisation du pouvoir Le président Pervez Musharraf s’est efforcé de stabiliser son pouvoir et de donner...
Extrait du document
«
Pakistan (2004-2005)
Efforts de stabilisation du pouvoir
Le président Pervez Musharraf s’est efforcé de stabiliser son pouvoir et de
donner une image de « modération éclairée » de son pays, tout en continuant à
soutenir la politique américaine dans la région en dépit de l’opposition quasi
générale.
Le 17e amendement à la Constitution a réintroduit le pouvoir du
président et des gouverneurs de provinces de dissoudre l’Assemblée nationale et
les assemblées provinciales.
Il a également confirmé la validité du référendum
d’avril 2002 (contesté pour ses irrégularités et le faible taux de
participation), permettant au général Musharraf de rester président de la
République jusqu’en 2007.
Celui-ci n’a pas tenu son engagement de renoncer à la
fonction de chef d’État-Major au 31 décembre 2004.
Les assemblées provinciales
du Pendjab et du Sind avaient adopté, en septembre 2004, des résolutions lui
demandant de continuer à exercer les fonctions de président et de chef
d’État-Major au-delà de cette date.
Le Parlement a également adopté, en
novembre, un projet de loi en ce sens et le général-président a indiqué son
intention de briguer un nouveau mandat de président à la suite des élections
législatives de 2007.
Le Premier ministre Mir Zafarullah Khan Jamali, contraint à la démission le 26
juin 2004, a désigné Chaudhry Shujaat Hussain, dirigeant de la Ligue musulmane
du Pakistan (PML), comme remplaçant en attendant l’organisation d’élections
partielles permettant au ministre des Finances, Shaukat Aziz, d’entrer à
l’Assemblée nationale, condition requise pour exercer la fonction de Premier
ministre.
Durant sa campagne électorale, ce dernier a échappé à un
attentat-suicide revendiqué par les Brigades al Islambouli considérées comme
liées à Al-Qaeda.
L’Assemblée nationale l’a désigné, en août, comme Premier
ministre par 191 voix sur 342, l’opposition ayant boycotté le vote.
Des contacts ont été pris avec les anciens Premiers ministres Nawaz Sharif et
Benazir Bhutto (alternativement au pouvoir de 1988 à 1999) qui vivaient en exil.
Shahbaz Sharif, ancien « ministre en chef » du Pendjab et frère de N.
Sharif, a
toutefois été renvoyé en Arabie saoudite quelques heures après son arrivée à
Lahore en mai.
Asif Zardari, le mari de B.
Bhutto (condamné pour corruption), a
quant à lui été libéré sous caution en novembre.
Multiplication des violences
La situation s’est considérablement dégradée au Baloutchistan où un conflit
oppose de longue date la tribu baloutche des Bugti et le gouvernement fédéral.
L’Armée de libération du Baloutchistan a mené tout au long de l’année 2004 des
actions de guérilla contre l’armée et les forces paramilitaires contrôlées par
le ministère de l'Intérieur et a lancé des attaques contre les infrastructures
et les voies de communication.
Les violences ont redoublé en janvier 2005 après
le viol d’une femme médecin imputé à un capitaine de l’armée qui n’a pas été
appréhendé, et les sabotages du gazoduc se sont multipliés.
Des affrontements à
l’arme lourde ont fait plus de 70 morts et des dizaines de blessés, des civils
pour la plupart, en mars 2005.
Les négociations, engagées sous l’égide d’une
commission sénatoriale, n’ont pas permis de mettre un terme à ces violences.
L’opération militaire contre les « mécréants » (nom donné par les autorités aux
militants d’Al-Qaeda retranchés dans la Zone tribale du Sud-Waziristan) a connu
une escalade durant l’été 2004, faisant de nombreuses victimes civiles et
entraînant d’importants dommages matériels et l’exode de la population.
Les
États-Unis ont accordé une aide militaire de 300 millions de dollars pour
pourchasser les militants d’Al-Qaeda dans cette région où quelque 70 000
militaires pakistanais ont été déployés.
Selon le porte-parole de l’armée, plus
de 600 militants auraient été arrêtés au Waziristan et environ 300 autres tués
(dont la moitié étaient des étrangers, ouzbeks pour la plupart) ; au moins 200
militaires ont par ailleurs trouvé la mort.
Des accords ont été conclus avec les
tribus wazir ahmadzai et mehsud et des programmes de développement ont démarré
dans les Zones tribales.
Les affrontements se sont toutefois poursuivis de façon
sporadique, notamment au Nord-Waziristan, et la trêve restait précaire.
Les
autorités afghanes continuaient d'accuser le Pakistan de fermer les yeux sur la
présence, dans les Zones tribales, de taliban et d'activistes d'Al-Qaeda qui
menaient des opérations de guérilla contre les troupes de la coalition dans le
sud et l'est de l'Afghanistan.
Très peu de militants étrangers ont été capturés dans les Zones tribales.
En
revanche, Ahmed Khalfan Gailani, un Tanzanien faisant partie de la liste des 22
terroristes les plus recherchés par les États-Unis, a été arrêté en juillet 2004
à Gujrat (Pendjab) et Abu Faraj al-Libbi, un Libyen présenté comme « le numéro
trois d’Al-Qaeda » et soupçonné d’être impliqué dans les deux tentatives
d’attentat de décembre 2003 contre le président Musharraf, a été capturé à
Mardan (Province de la frontière du Nord-Ouest) en mai 2005.
Les violences confessionnelles n’ont pas connu de répit ; plus de 200 personnes
ont trouvé la mort en 2004, qui a été l’une des années les plus meurtrières.
Des
dignitaires religieux sunnites et chiites ont été assassinés à Karachi et à
Gilgit où la tension est restée vive en 2004.
Près de 80 personnes ont notamment
trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessées en octobre à la suite
d’attentats qui ont visé des mosquées....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓