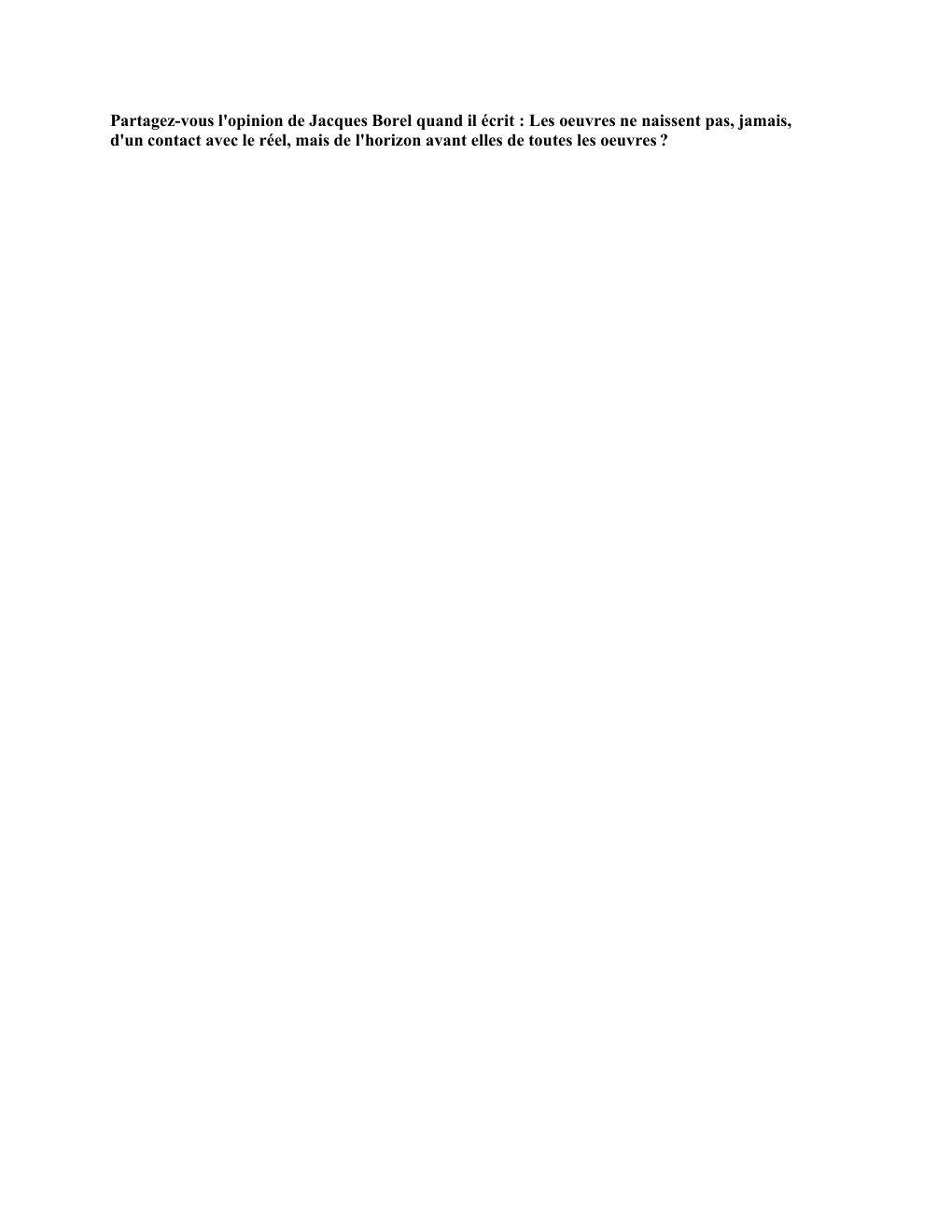Partagez-vous l'opinion de Jacques Borel quand il écrit : Les oeuvres ne naissent pas, jamais, d'un contact avec le réel,...
Extrait du document
«
Partagez-vous l'opinion de Jacques Borel quand il écrit : Les oeuvres ne naissent pas, jamais,
d'un contact avec le réel, mais de l'horizon avant elles de toutes les oeuvres ?
Partagez-vous l'opinion de Jacques Borel quand il écrit : Les oeuvres ne naissent pas, jamais, d'un
contact avec le réel, mais de l'horizon avant elles de toutes les oeuvres[1] ?
La notion d'héritage est centrale en matière artistique => en poésie, les maîtres et les modèles sont
multiples.
I- L'héritage des poètes précédents
S'inspirer, imiter les Anciens, les poètes précédents : étape qui peut être indispensable.
A- Des codes traditionnels respectés
• Les poètes se sont très souvent inspirés de leurs ancêtres.
Ex : la Pléiade s'est inspirée des Latins (Ronsard qui a pris exemple sur Pindare)
• Théorie de l'imitation chez Du Bellay (Défense et illustration de la langue française 1549) => Véritable
traité d'inspiration à partir de l'imitation.
: « ...je veux bien avertir ceux qui aspirent à cette gloire (ceux
qui veulent donner à la langue française tout son lustre) d'imiter les bons auteurs grecs et romains, voire
bien italiens, espagnols et autres...
».
B- Transformation de ces codes
Certains poètes ont renversé certains codes (ils s'en inspirent mais les transforment).
Ex : Tristan Corbière dans Les Amours jaunes =>joue avec les codes de l'écriture poétique.
« Sonnet à Sir Bob - Chien de femme légère, braque anglais pur sang « .
« Beau chien, quand je te vois
caresser ta maîtresse...
»
• Jules Laforgue => profondément imprégné des traditions qui le précèdent (la poésie lyrique du
seizième siècle, le Romantisme, Baudelaire), mais qui a fait éclater ces formes sans renier ses dettes.
Ex : Reprise du spleen baudelairien pastiché => « Tout m'ennuie aujourd'hui.
J'écarte mon rideau...
».
C- L'imitation est quasi indispensable
• Les poètes reconnaissent le besoin d'imiter mais cela leur permet aussi de la tenir à distance.
(R : très
souvent, les poètes ont eu aussi besoin de rejeter leurs prédécesseurs pour exister mais ce qui ne les a
pas empêchés de les imiter un peu).
Ex : Baudelaire qui a rejeté les romantiques mais qui parfois écrivait des poèmes romantiques aussi.
Ex : Rimbaud qui a commencé par imiter la poésie parnassienne pour la parodier et s'en détacher, voire
la dénoncer.
Une Saison en enfer : « Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux.
-Et je l'ai trouvée
amère.
-Et je l'ai injuriée.[...] Le malheur a été mon dieu.
Je me suis allongé dans la boue.
Je me suis
séché à l'air du crime ».
∆) Les poètes ont très souvent imité leurs pères, même si c'était pour s'en détacher.
Toutefois, il ne faut
pas opposer l'héritage et la création.
II- Héritage et création
A- Etymologie :
• poiêsis => création, création par le langage.
Figures de styles, beauté des formes fixes, travaillées.
• Remise en cause de la syntaxe traditionnelle : sonorités, musicalité, assonances, allitérations mais
graphisme important (disposition dans la page, calligrammes).
Ex : Hugo «Les souffles de la nuit
flottaient sur Galgal » allitérations en « l » qui fait entendre le souffle du vents.
• La syntaxe et le vocabulaire de la poésie sont spécifiques.
Ex : onde pour eau ou « sur un arbre perché »
pour « perché sur un arbre ».
=> le poème n'est pas un texte qui peut être résumé.
Il s'agit surtout d'une alliance de sonorités, d'effets,
d'images...
• Le poète crée parfois sa propre langue pour jouer plus librement avec elle.
Étrangeté des métaphores
symbolistes, « déracinement du langages ».
• Surréalistes : images insolites => nouvel univers.
« La terre est bleue comme une orange » Eluard /
« Bergère, Ô Tour Eiffel/ Le troupeau des ponts bêle »
Ex : « la poésie...
n'est ni le rythme, ni la rime, ni le chant, ni l'image, ni la couleur, ni la figure, ni la
métaphore...elle n'est pas même le vers ; elle est tout cela dans la forme, bien qu'elle soit aussi tout
entière sans forme, mais elle autre chose encore que cela : elle est la poésie » Lamartine, Cours familier
de littérature.
=>La poésie est donc une innovation constante, une manière de s'exprimer complètement différente de
la prose.
B- La poésie alchimie
• Le talent du poète ressemble au talent du chimiste (ou de l'alchimiste): maîtrise du langage, de ses
ressources et talent pour passer à l'image (transformation, Cf.
Hugo, Rêverie, Les Orientales.
Sartre :
"...les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage....Le poète s'est retiré d'un seul coup du
langage-instrument; il a choisi une fois pour toute l'attitude poétique qui considère les mots comme des
choses et non comme des signes..." Qu'est-ce que la littérature.
• L'alchimie poétique chez Rimbaud => Faire de l'or poétique avec le langage, telle était son ambition,
à l'image des alchimistes avec de vils métaux.
« À moi.
L'histoire d'une de mes folies....
».
Rimbaud, Une Saison en enfer.
"Alchimie du verbe"
Rimbaud propose une synthèse de son cheminement poétique.
Il expose ses sources d'inspiration:
mélange hétéroclites de sources diverses, ses ambitions: dérèglement des sens, sa quête : découvrir la
beauté
=> D'abord contester les conventions, inventer une nouvelle langue éloignée de la vieillerie des
traditions.
Puis vient la rupture, l'abandon, car il ne s'agissait que d'une expérience, désormais le poète
voyage pour découvrir et saluer la beauté.
C- Le cercle tradition/innovation
• Peut-être que l'on pourrait considérer que la poésie serait comme un cercle où le poète prend appui sur
l'héritage pour sans cesse le renouveler, le modifier, le contredire, le dépasser.
R : Le langage poétique explore toujours les mêmes questions : comment situer l'homme dans son
histoire et quels rapports existent entre lui et le monde.
Ces questions....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓