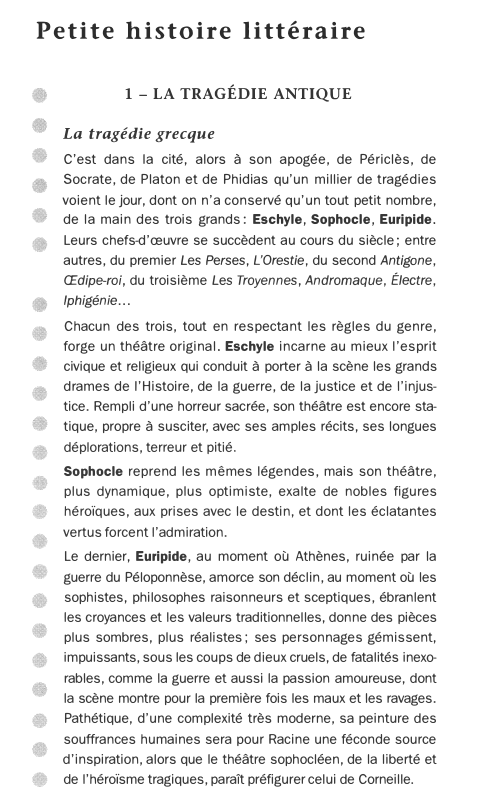Petite histoire littéraire • 1 - LA TRAGÉDIE ANTIQUE • La tragédie grecque • • • • • • e...
Extrait du document
«
Petite histoire littéraire
•
1 - LA TRAGÉDIE ANTIQUE
• La tragédie grecque
•
•
•
•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
e
C'est dans la cité, alors à son apogée, de Périclès, de
Socrate, de Platon et de Phidias qu'un millier de tragédies
voient le jour, dont on n'a conservé qu'un tout petit nombre,
de la main des trois grands: Eschyle, Sophocle, Euripide.
Leurs chefs-d'œuvre se succèdent au cours du siècle; entre
autres, du premier Les Perses, L'Orestie, du second Antigone,
Œdipe-roi, du troisième Les Troyennes, Andromaque, Électre,
Iphigénie...
Chacun des trois, tout en respectant les règles du genre,
forge un théâtre original.
Eschyle incarne au mieux l'esprit
civique et religieux qui conduit à porter à la scène les grands
drames de !'Histoire, de la guerre, de la justice et de l'injustice.
Rempli d'une horreur sacrée, son théâtre est encore statique, propre à susciter, avec ses amples récits, ses longues
déplorations, terreur et pitié.
Sophocle reprend les mêmes légendes, mais son théâtre,
plus dynamique, plus optimiste, exalte de nobles figures
héroïques, aux prises avec le destin, et dont les éclatantes
vertus forcent l'admiration.
Le dernier, Euripide, au moment où Athènes, ruinée par la
guerre du Péloponnèse, amorce son déclin, au moment où les
sophistes, philosophes raisonneurs et sceptiques, ébranlent
les croyances et les valeurs traditionnelles, donne des pièces
plus sombres, plus réalistes; ses personnages gémissent,
impuissants, sous les coups de dieux cruels, de fatalités inexo
rables, comme la guerre et aussi la passion amoureuse, dont
la scène montre pour la première fois les maux et les ravages.
Pathétique, d'une complexité très moderne, sa peinture des
souffrances humaines sera pour Racine une féconde source
d'inspiration, alors que le théâtre sophocléen, de la liberté et
de l'héroïsme tragiques, paraît préfigurer celui de Corneille.
• La tragédie latine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
On sait que les Romains se mirent à l'école de la Grèce.
Ils
reprirent donc le genre, imitant leurs prestigieux prédéces
seurs.
La plupart des tragédies latines sont elles aussi perdues.
Seules ont survécu quelques œuvres du philosophe
Sénèque (un contemporain de l'empereur Néron): Agamemnon, Phèdre, Médée ...
Son théâtre, qui se complaît dans les
paroxysmes les plus dramatiques, a une prédilection pour
l'exceptionnel, voire le monstrueux; imprégné des idées stoïciennes, il tend à élever l'homme au-dessus de l'adversité;
volontiers oratoire, de style savant et très orné, il aura une
influence décisive sur la tragédie classique.
2 - LA TRAGÉDIE« CLASSIQUE»
• Quelle époque?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'âge classique peut être compris comme la période qui
s'étend du XVI' au XVII' siècle.
Pour ce qui est du théâtre,
c'est la Renaissance qui rallume le flambeau antique dans
les tragédies dites •humanistes"; le XVII• siècle est celui
de l'apogée, de l'équilibre, atteints en deux vagues successives; le XVlll8 slècle s'inspire des chefs-d'œuvre de
Corneille et de Racine, avec lesquels Voltaire tente de rivaliser.
La survie du genre se prolonge jusqu'à la coupure de
l'âge romantique.
Il vaut mieux parler de •tragédies classiques" pour le seul
XVII' siècle, plus précisément les règnes de Louis XIII et de
Louis XIV, plus exactement la période 1630-1680.
Au début
du siècle un théâtre en liberté, •baroque•, celui des tragicomédies, n'a pas grand-chose de classique.
La première
moisson se fera dans les années 1630-1640, qu'a fini par
résumer un seul nom: Corneille.
La seconde, après la crise
et le coup d'arrêt de la Fronde, est celle des années 16601680, qui voient le triomphe de la dramaturgie classique
dans le théâtre de Racine.
Le parallèle entre les deux
«Grands• deviendra un lieu commun, Racine paraissant
l'emporter pour la fidélité à l'esthétique consacrée.
La tragédie humaniste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les poètes de la Pléiade avaient appelé de leurs vœux, dans
la célèbre Défense et illustration de la langue française
(1549), une renaissance de la tragédie antique.
N'étaient-ils
pas des «humanistes», c'est-à-dire des lettrés épris de
cette civilisation gréco-romaine qu'ils redécouvraient, imitaient avec zèle, et voulaient faire servir à la création d'un
homme nouveau, retrempé dans le savoir, l'expérience et
les arts d'un lointain passé? La première tragédie moderne,
à sujet profane et en français, sera la Cléopâtre captive
(1553) de Jodelle, directement imitée, avec ses chœurs, du
théâtre grec.
Ensuite, dans toute la production de l'époque
l'on retrouvera les mêmes traits: des œuvres pathétiques,
très statiques, où des victimes exemplaires, secondées par
des chœurs compatissants, se répandent en longues lamen
tations tout à la fois lyriques et rhétoriques.
Ainsi dans
!'Hippolyte (1573), !'Antigone (1580), Les Juives (1583) de
Robert Garnier, le plus grand poète dramatique du temps.
L'époque Louis XIII
Une passion constante du théâtre, une véritable « théâtro
manie », telle sera l'impulsion décisive pour la promotion
d'une nouvelle tragédie, moderne, dégagée d'une imitation
trop servile des Anciens, et tout à fait originale.
Passion personnelle et volonté politique du cardinal-ministre Richelieu,
féru d'art dramatique, un art éminemment social qui doit
faciliter l'instauration du nouvel ordre monarchique et renfor
cer le prestige du roi de France.
Engouement des grands, de
la cour, de la ville, des salons pour les fêtes et les plaisirs
d'un divertissement mondain de qualité.
Mécénat d'État ou
privé, intense développement des lettres et des arts sous
l'égide de l'Académie française, créée en 1635; installation
à Paris de troupes permanentes, construction de salles de
spectacles; reconnaissance sociale, littéraire, des auteurs,
des comédiens, auparavant peu considérés, voire discrédités (de simples amuseurs ou saltimbanques!); un débat
•
•
•
nourri, souvent polémique, dont La Querelle du Cid (1637)
constituera un sommet, autour de la dramaturgie classique
et de ses règles; une première génération, enfin, féconde
d'écrivains de théâtre (et pas seulement Corneille!}, voilà
tout le contexte politique, social et artistique, qui conduira
peu à peu la tragédie classique à son zénith!
La tragédie cornélienne
L'œuvre phare du premier classicisme théâtral est celle,
ample et variée, de Pierre Corneille (1606-1684), une œuvre
constituée au fil d'une longue carrière, de comédies mon
daines, de pièces étranges, inclassables, de drames specta
culaires et de...
tragédies classiques, les quatre grandes
surtout, consacrées par la postérité et l'usage scolaire: Le
Cid (1637), Horace (1640), Cinna (1642), Polyeucte (1643).
Le chant du cygne sera, en 1674, Suréna, tragédie aussi
belle et achevée que les précédentes.
Le génie cornélien
réussit le tour de force de respecter et de transgresser tout
à la fois les règles de la dramaturgie classique.
�
e
Intériorité, action, noblesse, telles sont les caractéristiques
essentielles de ce théâtre.
Il s'agit d'analyser, de montrer
sur la scène les mécanismes des passions, celles de la
gloire, de l'honneur, de la , vertu», du pouvoir et de l'amour.
L'intrigue est complexe et mouvementée, d'un puissant
dynamisme, avec ses péripéties, ses , suspensions,, ses
rebondissements; l'action autant que dans les événements
est dans les cœurs, où des sentiments, des valeurs antago
nistes s'affrontent en dilemmes «cornéliens».
Et tout est
grand: les personnages, rois, reines, héros, héroïnes venus
de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓