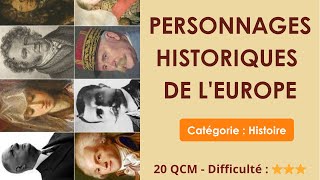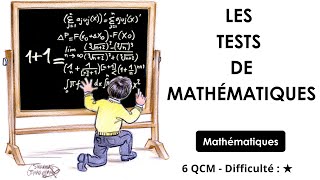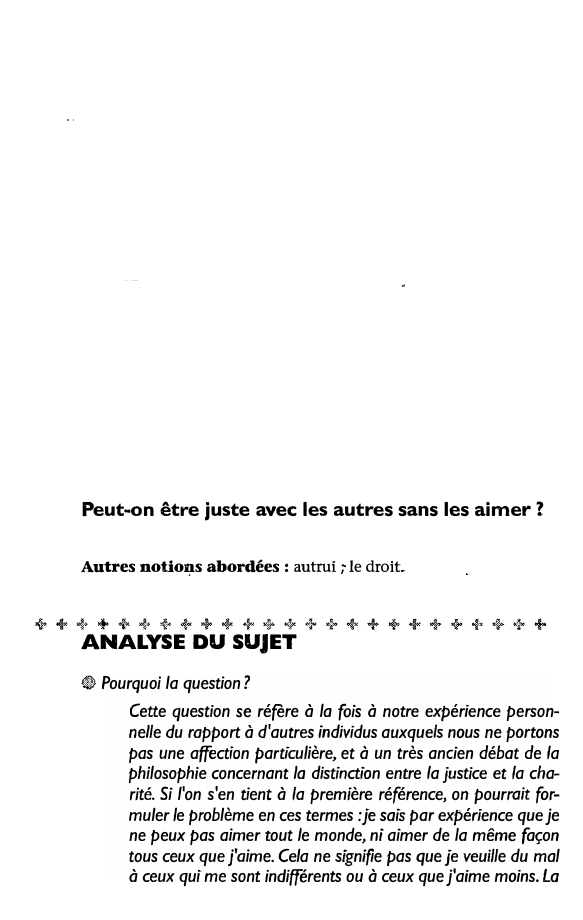Peut-on être juste avec les autres sans les aimer? Autres notio�s abordées : autrui ; le droit. +++++++++++++++++++++++++ ANALYSE DU...
Extrait du document
«
Peut-on être juste avec les autres sans les aimer?
Autres notio�s abordées : autrui ; le droit.
+++++++++++++++++++++++++
ANALYSE DU SUJET
@ Pourquoi la question?
Cette question se réfère à la fois à notre expérience person
nelle du rapport à d'autres individus auxquels nous ne portons
pas une affection particulière, et à un très ancien débat de la
philosophie concernant la distinction entre la justice et la cha
rité.
Si l'on s'en tient à la première référence, on pourrait for
muler le problème en ces termes :je sais par expérience que je
ne peux pas aimer tout le monde, ni aimer de la même façon
tous ceux que j'aime.
Cela ne signifie pas que je veuille du mal
à ceux qui me sont indifférents ou à ceux que j'aime moins.
La
justice n'est-elle pas alors l'attitude appropriée à leur égard ?
Mais cette vertu elle-même ne suppose-t-elle pas un minimum
d'amour ou de bienveillance à l'égard des autres ?
€& Dans quelle mesure la justice est-elle indépendante de l'amour ?
- En quoi la demande de justice s'appuie-t-elle sur un système
de droit ? Quel est son mérite ? On étudiera ici la différence
entre la loi de la cité et la «loi du cœur ».
- En quoi l'exigence d'impartialité implique-t-elle qu'on fasse
abstraction des sentiments ? On analysera ici la distinction entre
égalité et préférence.
- Ne peut-on opposer le souci d'exactitude de la justice et la
générosité de l'amour qui donne sans compter ? On se trouverait ici devant l'opposition entre un système rationnel et un
sentiment passionnel.
«w Dans quelle mesure la justice suppose-t-elle la bienveillance ?
- On pourrait rappeler ici la distinction entre justice arithmétique (à chacun la même chose) et justice géométrique
ou proportionnelle (à chacun ce qui lui revient): la seconde
forme, qui semble plus proche de la justice véritable mais aussi
plus difficile à mettre en œuvre, suppose que l'on cherche à
savoir ce qui revient effectivement à chacun, et notamment que
l'on soit prêt à reconnaître /es mérites d'autrui.
- L'expression « aimer les autres» ne désigne-t-elle que l'amour,
ne peut-elle se référer à une bienveillance qui transcenderait
nos préférences subjectives? Être disposé à être juste, n'est-ce
pas à tout le moins avoir renoncé à l'égoïsme pur et simple, à
l'attitude qui consiste à chercher notre avantage en toute circonstance ? Un tel renoncement n'implique-t-il pas une disposition bienveillante envers autrui en général ?
«w Construire le plan
La question est à présent de savoir comment organiser les idées
autrement que dans une opposition frontale oui / non.
li semble
naturel de montrer en premier lieu que la définition courante
de la justice est indépendante de la notion d'amour; il s'agira
ensuite de montrer non pas qu'il est impossible d'être juste sans
aimer les autres, mais que l'idée d'amour ou de bienveillance
est au travail dans l'exigence qui habite la justice comme vertu.
Au cours de ces deux parties, la notion de justice se précise, et
!!!SR~0~rt1o&1if.:sd1ü,G1,,!IJ.111aB1Uto:!,Q~iv"'pa~Y!:=--------------....;..---Philosophie - Ser,e ES
211
l'expression «aimer /es autres» s'affine.
On pourra donc terminer en montrant que la pratique de la justice est une des façons
pour nous de mieux comprendre cette expression.
Ainsi la question n'est plus tant de savoir s'il est possible d'être juste sans
aimer /es autres, mais de se demander si être juste n'est pas
une des meilleures entrées dans la compréhension de cette idée
difficile qu'est la bienveillance envers autrui.
Introduction
Nos relations avec les autres hommes sont marquées par différents liens
d'affection ou d'amitié, différents niveaux de proximité.
Nous nous sentons
particulièrement engagés à l'égard de ceux que nous aimons le plus.
Mais
nous savons aussi qu'une exigence universelle nous est adressée : celle de la
justice.
Je n'ai pas le droit de prendre la part d'autrni sous prétexte que je
n'ai aucune affection pour lui.
Mais d'où vient une telle exigence ? S'il ne
s'agit pas seulement de la contrainte extérieure d'une loi qui me retient de
faire du tort à ceux que je n'aime pas, la justice n'implique-t-elle pas une
bienveillance fondamentale ? Peut-on être juste avec les autres sans les
aimer?
Nous verrons dans un premier temps que l'exigence de justice doit être
formulée indépendamment de la question de l'amour ou de l'affection; nous
nous demanderons ensuite dans quelle mesure la justice en tant que disposition, vertu, implique une reconnaissance bienveillante d'autrui ; et enfin
dans quelle mesure la pratique de la justice peut être une pédagogie de
l'amour.
I.
La justice est le fruit de la limitation
de notre sympathie
~
Nous ne pouvons pas aimer tout le monde
Hume évoque la justice à travers ses deux sources : d'une part, nous ne
vivons pas dans une situation de surabondance généralisée, la plupart des
biens ne sont pas disponibles pour tous, d'où la nécessité de partager et d'élaborer des critères de distribution ; d'autre part, notre capacité d'affection
212 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pour autrui est limitée.
Nous ne pouvons pas aimer tout le monde et nous
n'aimons pas de la même façon tous ceux que nous aimons.
C'est pourquoi les lois nous prescrivent une conduite extérieure
indépendante de nos sentiments
Or il est clair que la situation deviendrait rapidement intenable si nous
pensions avoir le droit de faire du tort à toute personne que nous n'aimons
pas, même s'il s'agit d'une simple indifférence sans hostilité.
Rousseau
montre que le contrat social implique un respect inconditionné de la personne et des biens d'autrui; Kant rappelle que l'on ne peut ordonner à quelqu'un d'aimer les autres, et que le droit impose à tous la même conduite en
faisant abstraction des sentiments de chacun.
C'est ainsi que l'on peut accéder à l'impartialité qui implique
l'objectivité
La justice implique en effet l'impartialité et donc une certaine objectivité dans les jugements.
L'amour,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓