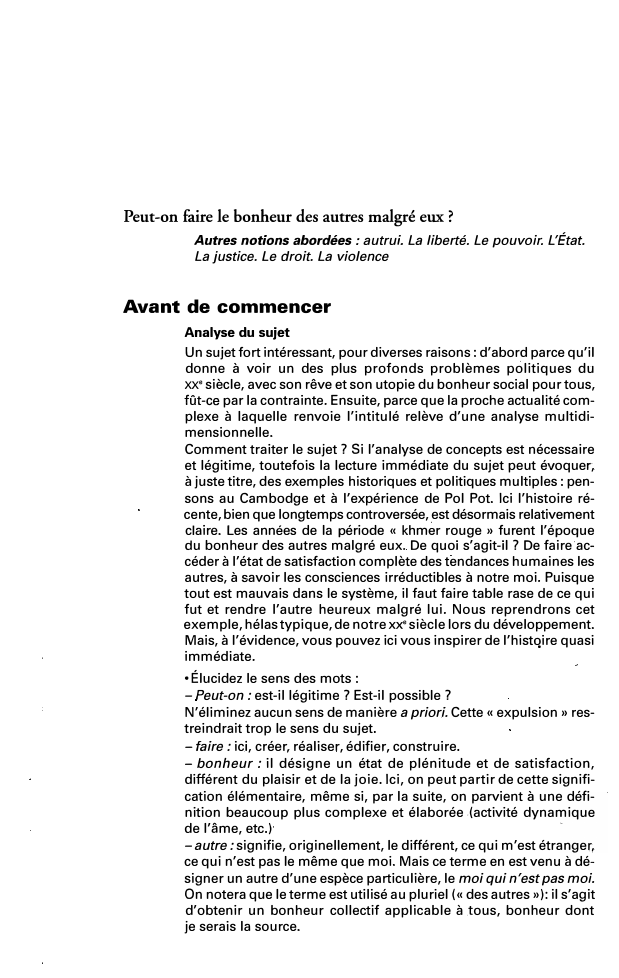Peut-on faire le bonheur des autres malgré eux? Autres notions abordées : autrui. La liberté. Le pouvoir. L'État. La justice....
Extrait du document
«
Peut-on faire le bonheur des autres malgré eux?
Autres notions abordées : autrui.
La liberté.
Le pouvoir.
L'État.
La justice.
Le droit.
La violence
Avant de commencer
Analyse du sujet
Un sujet fort intéressant, pour diverses raisons: d'abord parce qu'il
donne à voir un des plus profonds problèmes politiques du
XX' siècle, avec son rêve et son utopie du bonheur social pour tous,
fût-ce par la contrainte.
Ensuite, parce que la proche actualité com
plexe à laquelle renvoie l'intitulé relève d'une analyse multidi
mensionnelle.
Comment traiter le sujet? Si l'analyse de concepts est nécessaire
et légitime, toutefois la lecture immédiate du sujet peut évoquer,
à juste titre, des exemples historiques et politiques multiples: pen
sons au Cambodge et à l'expérience de Pol Pot.
Ici l'histoire ré
cente, bien que longtemps controversée, est désormais relativement
claire.
Les années de la période « khmèr rouge » furent l'époque
du bonheur des autres malgré eux.
De quoi s'agit-il? De faire·ac
céder à l'état de satisfaction complète des tendances humaines les
autres, à savoir les consciences irréductibles à notre moi.
Puisque
tout est mauvais dans le système, il faut faire table rase de ce qui
fut et rendre l'autre heureux malgré lui.
Nous reprendrons cet
exemple, hélas typique, de notre xx' siècle lors du développement.
Mais, à l'évidence, vous pouvez ici vous inspirer de l'histqire quasi
immédiate.
• Élucidez le sens des mots:
- Peut-on : est-il légitime? Est-il possible?
N'éliminez aucun sens de manière a priori.
Cette «expulsion» res
treindrait trop le sens du sujet.
- faire: ici, créer, réaliser, édifier, construire.
- bonheur : il désigne un état de plénitude et de satisfaction,
différent du plaisir et de la joie.
Ici, on peut partir de cette signifi
cation élémentaire, même si, par la suite, on parvient à une défi
nition beaucoup plus complexe et élaborée .(activité dynamique
de l'âme, etc.)
-autre: signifie, originellement, le différent, ce qui m'est étranger,
ce qui n'est pas le même que moi.
Mais ce terme en est venu à dé
signer un autre d'une espèce particulière, le moi qui n 'est pas moi.
On notera que le terme est utilisé au pluriel («des autres»): il s'agit
d'obtenir un bonheur collectif applicable à tous, bonheur dont
je serais la source.
- malgré : ici, en dépit de, contrairement à, par l'usage de la vio
lence physique ou spirituelle, etc.
- malgré eux: cette expression sous-entend clairement que le mo
dèle de bonheur du« on» n'est pas spontanément reconnu par les
autres, qu'il n'est pas universel.
Cependant, « on » le considère
comme supérieur à tout autre.
•Vous parvenez à un premier sens du sujet, sens résultant d'une
lecture attentive de l'intitulé: l'élaboration de ce« sens du sujet»
est indispensable si vous ne voulez pas vous égarer dans les ma
récages du hors sujet.
Est-il possible et légitime de faire parvenir à un état de satisfaction
durable tous ces« moi qui ne sont pas moi», ces consciences qui
me sont étrangères, et ce contre leur volonté, par la violence phy
sique ou morale? On notera le caractère paradoxal de la question
posée, puisque c'est par la contrainte que l'on veut amener les
autres à être satisfaits.
•Cet intitulé nous engage dans tout un questionnement: le bon
heur est-il une affaire privée ou publique ? relevant de la volonté
du sujet ou de celle du législateur ? Désigne-t-il une activité de
l'âme, libre, dynamique et rationnelle, ou bien un état de passivité
irréductible pouvant être produit et fabriqué en quelque sorte? En
définitive, le bonheur est-il affaire de politique? Tel semble être le
problème, qui se circonscrit de la manière suivante: la violence est
elle le moyen parfois nécessaire d'une politique rationnelle ?
Pourquoi choisir ce problème ? Il est central et gros d'enjeux.
Il a
le mérite de nous relier à une thématique centrale de la pensée
depuis le xv111• siècle.
• Quel est l'enjeu? Le dèstin politique et social de l'espèce humaine,
le devenir de la politique et des stratégies inhérentes à cette der
nière.
En définitive, le gain de pensée sera ici théorique aussi bien
que pratique.
Plan
Quel plan choisir? Nous avons ici le choix entre un plan progressif,
partant d'une réponse affirmative et aboutissant à une construc
tion rationnelle et un plan dialectique, par thèse, antithèse et syn
thèse.
Nous opterons ici pour le plan dialectique, malgré ses diffi
cultés.
Introduction
Problématique: le bonheur est-il affaire de politique? La violence,
moyen parfois nécessaire d'une politique rationnelle ?
Discussion
A) Il est possible et légitime de faire le bonheur des autres malgré
eux(thèse)
Le bonheur d'autrui par la violence exercée sur lui.
Transition : ne s'agit-il pas d'un faux bonheur, mortifère et des
tructeur?
B) Il n'est ni possible ni légitime de faire le bonheur des autres
malgré eux, contre leur volonté (antithèse)
Le bonheur est un état de l'âme libre et donc irréductible à un
produit de la violence.
Transition : peut-on toutefois mettre entre parenthèses les condi
tions pratiques et concrètes du bonheur?
C) Il est possible et légitime de contribuer au bonheur des autres
avec eux, en exerçant sur eux le minimum de violence
Remarque : c'est l'examen de la sphère éducative qui justifie cet
appel à une violence minimale.
Conclusion
On ne peut faire le bonheur des autres malgré eux.
!!12l!imlmctmlm.21&!52sroJf2m,1
Bibliographie
ARON,
Histoire et dialectique de la violence, Gallimard.
La Vertu de force, PUF.
GUSDORF,
1) Introduction
Est-il possible et légitime, du domaine du réalisable et de celui du droit, de faire
parvenir à un état de satisfaction durable - où les tendances humaines s'actua
lisent pleinement - les autres, à savoir ces « moi qui ne sont pas moi >\, ces
consciences qui sont étrangères à la mienne et, en même temps, si proches de
moi, et ce en faisant appel à un processus s'effectuant malgré eux, c'est-à-dire
à l'intérieur d'une certaine violence ?
On notera, dès l'abord, le sens profondément engagé de la question, grosse de
perspectives et thématiques contemporaines, au sein des réalités opaques du
XX" siècle, l'histoire étant« un cauchemar dont j'essaie de me réveiller » Garnes
Joyce).
Le bonheur, affaire privée ou publique ? Phénomène relevant d'une stratégie
politique ou d'une rationalité individuelle ? Le bonheur est-il affaire de poli
tique ? La violence est-elle le moyen nécessaire d'une politique rationnelle ? Tel
est, en définitive, le problème.
L'enjeu, ce que l'intitulé nous fait gagner ou perdre, est manifeste : ce sont nos
conduites politiques et sociales qui doivent se trouver ici éclairées.
Le gain
spéculatif et pratique est lié à l'intérêt philosophique de la question.
Agir
par contrainte et violence, ou bien par rationalité transparente ?
2.) Discussion
A.
Il est possible et légitime de faire le bonheur des autres malgré eux
(thèse)
L'idée qu'il serait à la fois possible et légitime de faire le bonheur des autres mal
gré eux, contre eux et en violant leur liberté s'enracine dans une thématique si
ancienne qu'il semble difficile de ne pas commencer par répondre affirmative
ment à la question posée.
Oui, faisons le bonheur des autres malgré eux.
Pourquoi ce projet est-il légitime ? Après tout, les hommes sont aveuglés gé
néralement par leurs passions ou leurs désirs sensibles.
Ils sont, bien souvent,
en proie à des désirs déréglés: l'âme n'est-elle pas dominée par des désirs vio
lents ? Une partie de notre âme n'est-elle pas aveugle, sauvage et irréfléchie ?
Dès lors, comment le bonheur serait-il accessible à l'âme humaine ? Bonheur
signifie réconciliation, unité,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓