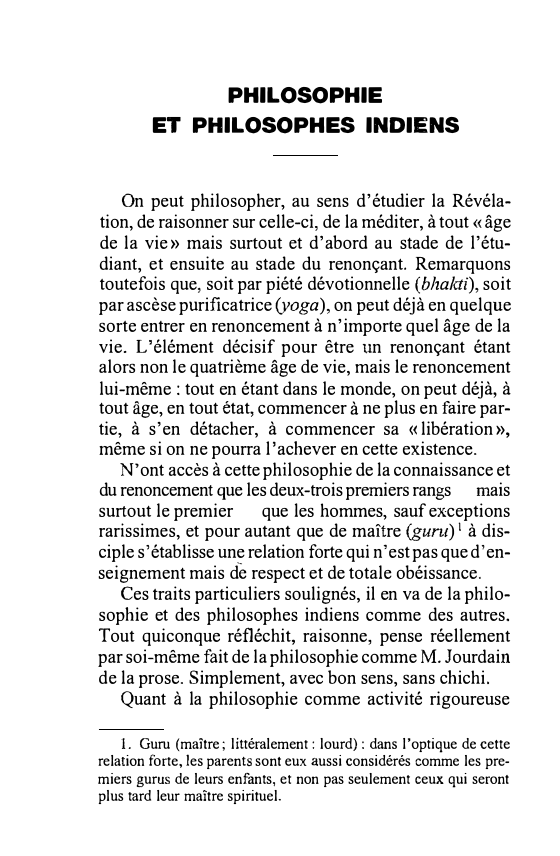PHILOSOPHIE ET PHILOSOPHES INDIENS On peut philosopher, au sens d'étudier la Révéla tion, de raisonner sur celle-ci, de la méditer,...
Extrait du document
«
PHILOSOPHIE
ET PHILOSOPHES INDIENS
On peut philosopher, au sens d'étudier la Révéla
tion, de raisonner sur celle-ci, de la méditer, à tout « âge
de la vie» mais surtout et d'abord au stade de l'étu
diant, et ensuite au stade du renonçant.
Remarquons
toutefois que, soit par piété dévotionnelle (bhakti), soit
par ascèse purificatrice (yoga), on peut déjà en quelque
sorte entrer en renoncement à n'importe quel âge de la
vie.
L'élément décisif pour être un renonçant étant
alors non le quatrième âge de vie, mais le renoncement
lui-même : tout en étant dans le monde, on peut déjà, à
tout âge, en tout état, commencer à ne plus en faire par
tie, à s'en détacher, à commencer sa «libération»,
même si on ne pourra l'achever en cette existence.
N'ont accès à cette philosophie de la connaissance et
du renoncement que les deux-trois premiers rangs mais
surtout le premier que les hommes, sauf exceptions
rarissimes, et pour autant que de maître (gunt) 1 à dis
ciple s' établisse une relation forte qui n'est pas que d'en
seignement mais dè respect et de totale obéissance.
Ces traits particuliers soulignés, il en va de la philo
sophie et des philosophes indiens comme des autres.
Tout quiconque réfléchit, raisonne, pense réellement
par soi-même fait de la philosophie comme M.
Jourdain
de la prose.
Simplement, avec bon sens, sans chichi.
Quant à la philosophie comme activité rigoureuse
1.
Guru (maître; littéralement: lourd): dans l'optique de cette
relation forte, les parents sont eux aussi considérés comme les pre
miers gurus de leurs enfants, et non pas seulement ceux qui seront
plus tard leur maître spirituel.
de l'esprit raisonnant, elle est et a toujours été l'affaire
soit de clercs (religieux, moines, prêtres, soumis à des
règles et professant un credo), soit de lettrés (clercs
indépendants, mais jamais totalement), soit de fortes
individualités libres de toute appartenance.
Mais alors qu'il pourrait bien y avoir de purs
mathématiciens, de purs savants, géomètres, gram
mairiens, il ne peut, semble+il, y avoir en Inde de
purs philosophes étant donné le caractère existentiel
du questionnement qui, dans ce pays plus que partout
peut-être, implique préalablement et continûment une
pratique du renoncement, un détachement du monde.
Tout se passe comme s'il s'agit d'abord de renoncer,
d'acquitter le prix d'un retrait du monde pour avoir
droit à chercher le savoir.
Il est clair que tout quiconque veut philosopher ne
le peut qu'à partir d'un univers anthropologique et
idéologique, situé dans le temps et l'espace, et qu'au
départ de croyances et/ou d'évidences données qu'il
s'efforce de rendre intelligibles à .tout être pensant
doué de raison (et d'abord donc à soi-même).
Quoique le but poursuivi soit de rendre le « réel»
quoi qu'on entende par ce terme - intelligible, et
d'en appréhender donc la «vérité» - quoi qu'on
entende par ce mot-, une discipline de vie en résulte.
Vérité oblige!
Autrement dit, s'il s'agit de raisonner juste (grâce
à la logique formelle et argumentative), et de tenir
compte des savoirs qu'accumulent progressivement
les sciences, le but de l'acte dè philosopher est d'ac
quérir la sagesse, de l'aimer en tout cas - ce que dit
précisément le terme même de philosophie : amour de
la sagesse.
Connaître la vérité (ou à défaut le vraisem
blable) et agir moralement (du mieux que l'on peut)
en connaissance de cause et de conscience, tels sont
traditionnellement les buts premiers de la philosophie.
A quoi peuvent s'adjoindre l'amour du beau, mais
aussi le politique comme promotion raisonnable du
bien commun (et donc des liens communs qui unissent
les hommes) en vue de l'instauration raisonnable (et
sans doute progressive) d'une paix universelle.
Dans ces....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓