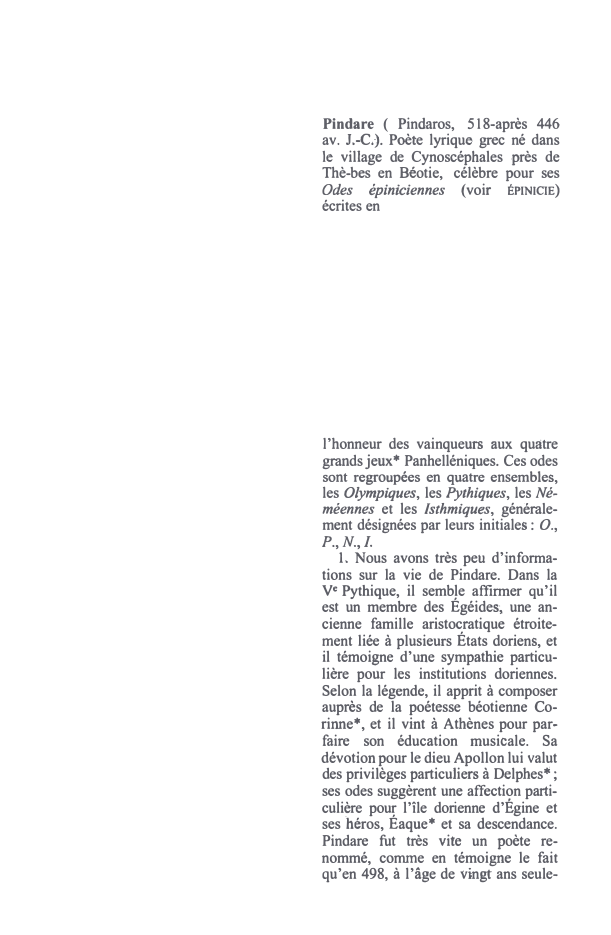Pindare ( Pindaros, 518-après 446 av. J.-C.). Poète lyrique grec né dans Je village de Cynoscéphales près de Thèbes en...
Extrait du document
«
Pindare ( Pindaros, 518-après 446
av.
J.-C.).
Poète lyrique grec né dans
Je village de Cynoscéphales près de
Thèbes en Béotie, célèbre pour ses
Odes épiniciennes (voir ÉPINICIE)
écrites en
!'honneur des vainqueurs aux quatre
grands jeux* Panhelléniques.
Ces odes
sont regroupées en quatre ensembles,
les Olympiques, les Pythiques, les Né
méennes et les Isthmiques, générale
ment désignées par leurs initiales: O.,
P.,N.,l.
L Nous avons très peu d'informa
tions sur la vie de Pindare.
Dans la
V• Pythique, il semble affirmer qu'il
est un membre des Égéides, une an
cienne famille aristocratique étroite
ment liée à plusieurs États doriens, et
il témoigne d'une sympathie particu
lière pour les institutions doriennes.
Selon la légende, il apprit à composer
auprès de la poétesse béotienne Co
rinne*, et il vint à Athènes pour par
faire son éducation musicale.
Sa
dévotion pour le dieu Apollon lui valut
des privilèges particuliers à Delphes*;
ses odes suggèrent une affection parti
culière pour l'île dorienne d'Égine et
ses héros, Éaque* et sa descendance.
Pindare fut très vite un poète re
nommé, comme en témoigne le fait
qu'en 498, à l'âge de vingt ans seule-
ment, la puissante famille thessalienne
des Aleuades lui passa commande
d'une ode (P.
10), pour l'un de ses
membres qui avait remporté une vic
toire (voir irifra).
L'année suivante, il
gagna un concours de dithyrambes.
À
l'égard des grands événements histo
riques de son temps, il adopta un point
de vue plutôt panhellénique qu'étroite
ment lié à des fidélités locales.
Il
considéra ainsi les invasions perses
comme une menace pour la Grèce
dans son ensemble, la délivrance de la
Grèce comme une bénédiction.
On ne
peut découvrir ses sentiments person
nels sur les conséquences du soutien
de Thèbes aux Perses, même s'il se la
mente sur la détresse et les pertes que
la guerre lui a occasionnées.
Son ad
miration pour Athènes semble ne pas
avoir souffert des mauvaises relations
entre les deux cités.
On dit que ses
compatriotes lui infligèrent une amen
de pour ses éloges d'Athènes, mais
que les Athéniens lui versèrent le
double de son montant.
Ils lui élevè
rent aussi une statue ( que le voyageur
grec Pausanias vit sur l'agora, au
11• siècle apr.
J.•C.), mais ce fut sans
doute bien après sa mort.
Pindare
voyagea dans toutes les régions du
monde .
grec.
Certaines de ses plus
grandes odes furent dédiées aux tyrans
de Sicile, en particulier Hiéron 1 °' de
Syracuse* (1).
On rapporte qu'il mou
rut à Argos à l'âge de quatre-vingts
ans (c.-à-d.
en 438; son dernier poème
daté fut écrit en 446).
Il :jouit d'une
grande réputation de son vivant, et fut
vite cité comme une autorité (par
exemple.par Hérodote et Platon).
Lors
de la destruction de Thèbes en 335
(punition pour sa révoltt contre la do
mination macédonienne), Alexandre le
Grand ordonna que l'on épargnât la
maison de Pindare ; ses ruines étaient
encore visibles quand Pausanias visita
Thèbes, vers 150 apr.J.�c.
2.
Les nombreux poèmes de Pin
dare, où l'on trouve les principales
formes de la lyrique* chorale, furent
regroupés par les savants d'Alexandrie
en 17 livres et classés par genres :
les épinicies (4 livres); les éloges, les
chants funéraires, les hymnes; les
péans (un livre par catégorie); les di
thyrambes, les prosodies, les hypor
chémata, les parthénéia (deux livres
par genre); et un dernier livre pour une
autre catégorie de parthénéia.
De cet
ensemble, seuls survivent les quatre
livres d'Odes épiniciennes, à peu près
intacts, dans la tradition manuscrite.
On connaît les autres poèmes essen
tiellement grâce à des citations, bien
que les découvertes de papyrus, à la
fin du x1x• et au xxe siècle aient consis
dérablement élargi nos connaissances,
en particulier sur les péans.
3.
Pindare a écrit dans le dialecte*
littéraire dorien, mais a aussi utilisé
des formes épiques, en particulier pour
les récits mythiques.
Parmi les Épinî
èies; la moitié sont écrites en un vers
connu sous le nom de « dactylo-épi
trite », l'autre moitié dans une variante
syncopée de ce mètre, que l'on dé
signe, de manière inexacte comme
« éolique » (voir MÈTRE I, 8, 111); La
structure de la phipart de ces poèmes
est triadiqtie (voit TRIADE); certains
d'entre eux sont sous forme de
strophes: li n'y a pas deux odes iden°
tiques sur le plan de la métrique' (à
l'exception d'isthmiques 3 et 4 pour
des raisons paitiëulières).
L'analyse
détaillée des odes révèle.
qu'elles sui
vent le schéma conventionnel de l'élo
ge.
Certains éléments y figurent de
manière obligée : le nom du vain
queur, sa vietoire, les victoires plus
anciennes qu'il a remportées ; l'éloge
de sa famille et de sa patrie; peut-être
l'éloge de l'art de la poésie qui a le
pouwoir d!immortaliser le vainqueur, et
un récit mythique qui vient souligner
de manière indirecte les autres élé
ments de l'élQge.
L'art du poète
consiste à entrecroiser ces éléments
assez disparates dans un tout artis
tique, et l'attention du lecteur se
trouve détournée des aspects tech
niques de la composition grâce à la ra
pidité et la variété du déroulement
poétique.
Le caractère fortement répé
titif des sujets n'est pas trop apparent,
même lorsqu'on lit à la suite les qua
rante-quatre odes, ce que leur auteur
aurait difficilement imaginé.
C'est
plutôt la variété qui frappe dans ce re
cueil.
Pindare contrôle parfaitement la
forme qu'il a choisie, et sa technique
est remarquable par ses variations
constantes, sa complexité et sa vitalité.
Certaines de ses phrases se présentent
comme de longues périodes, dont les
pauses se situent à des moments souli
gnés par la métrique, par exemple au
début d'une nouvelle strophe.
D'autres
phrases doivent leur beauté à leur briè
veté.
Parfois, en particulier dans les
odes tardives, le langage semble
presque dépouillé, dépourvu d'orne
ments, l'ordre des mots paraît simple
et prosaïque; dans d'autres odes, en
revanche, le langage est riche et luxu
riant, l'ordre des mots complexe.
Le
poête construit avec habileté les cres
cendos et les paroxysmes de tension à
l'intérieur d'une ode: Les transitions
d'un sujet à l'autre sont tantôt brutales,
ce qui crée un effet rhétorique, tantôt
discrètes.
Les métaphores et les méto
nymies abondent (voir par exemple la
variété dès mots qui expriment la vic
toire).
4.
Les Odes épiniciennes sont
écrites d'un point de vue essentielle
ment religieux.
C'est cet arrière-plan
qui donne de la grandeur aux thèmes
et au langage de Pindare.
Les hommes
ne sont rien par eux-mêmes.
Le succès
est un doh des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓