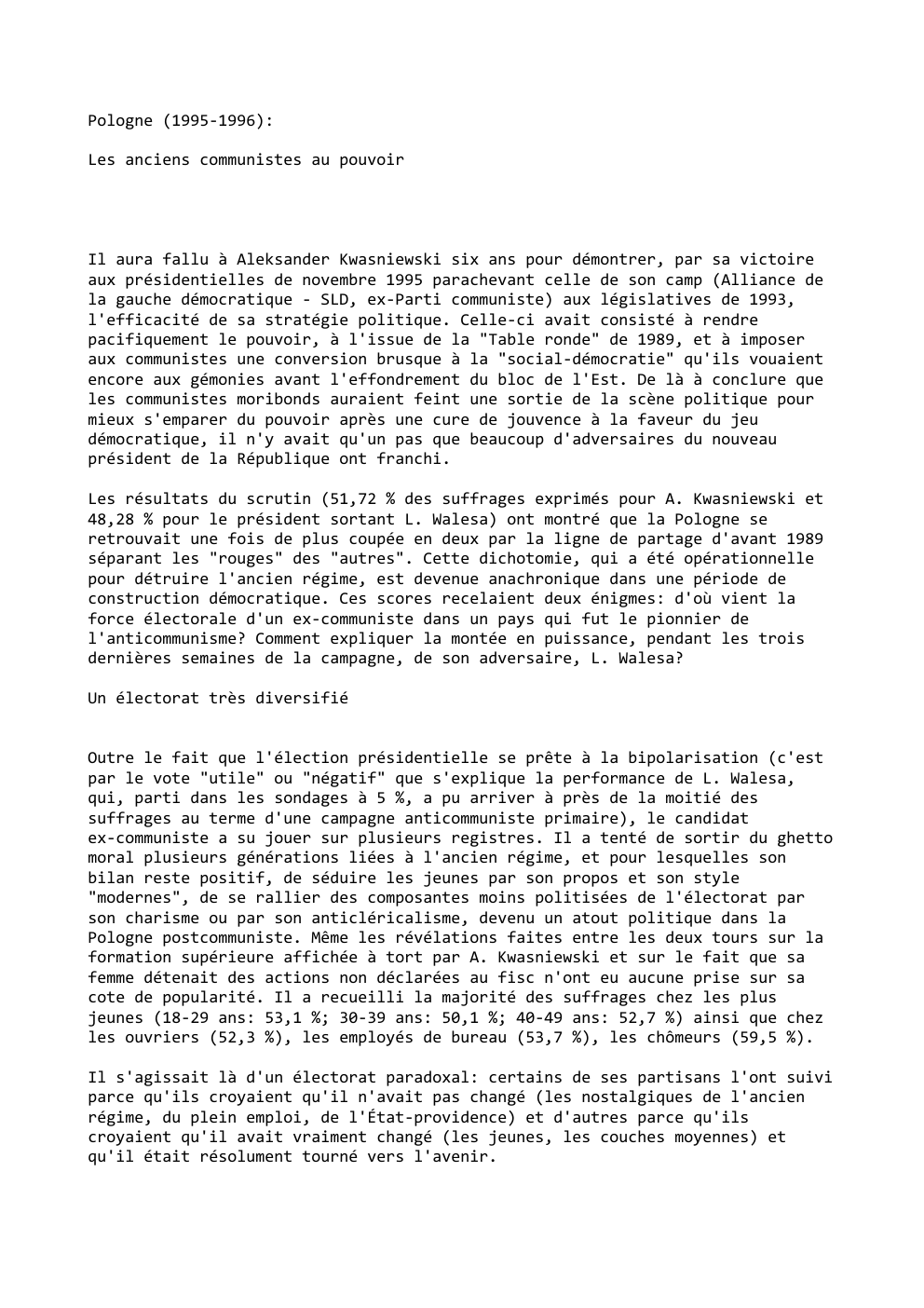Pologne (1995-1996): Les anciens communistes au pouvoir Il aura fallu à Aleksander Kwasniewski six ans pour démontrer, par sa victoire...
Extrait du document
«
Pologne (1995-1996):
Les anciens communistes au pouvoir
Il aura fallu à Aleksander Kwasniewski six ans pour démontrer, par sa victoire
aux présidentielles de novembre 1995 parachevant celle de son camp (Alliance de
la gauche démocratique - SLD, ex-Parti communiste) aux législatives de 1993,
l'efficacité de sa stratégie politique.
Celle-ci avait consisté à rendre
pacifiquement le pouvoir, à l'issue de la "Table ronde" de 1989, et à imposer
aux communistes une conversion brusque à la "social-démocratie" qu'ils vouaient
encore aux gémonies avant l'effondrement du bloc de l'Est.
De là à conclure que
les communistes moribonds auraient feint une sortie de la scène politique pour
mieux s'emparer du pouvoir après une cure de jouvence à la faveur du jeu
démocratique, il n'y avait qu'un pas que beaucoup d'adversaires du nouveau
président de la République ont franchi.
Les résultats du scrutin (51,72 % des suffrages exprimés pour A.
Kwasniewski et
48,28 % pour le président sortant L.
Walesa) ont montré que la Pologne se
retrouvait une fois de plus coupée en deux par la ligne de partage d'avant 1989
séparant les "rouges" des "autres".
Cette dichotomie, qui a été opérationnelle
pour détruire l'ancien régime, est devenue anachronique dans une période de
construction démocratique.
Ces scores recelaient deux énigmes: d'où vient la
force électorale d'un ex-communiste dans un pays qui fut le pionnier de
l'anticommunisme? Comment expliquer la montée en puissance, pendant les trois
dernières semaines de la campagne, de son adversaire, L.
Walesa?
Un électorat très diversifié
Outre le fait que l'élection présidentielle se prête à la bipolarisation (c'est
par le vote "utile" ou "négatif" que s'explique la performance de L.
Walesa,
qui, parti dans les sondages à 5 %, a pu arriver à près de la moitié des
suffrages au terme d'une campagne anticommuniste primaire), le candidat
ex-communiste a su jouer sur plusieurs registres.
Il a tenté de sortir du ghetto
moral plusieurs générations liées à l'ancien régime, et pour lesquelles son
bilan reste positif, de séduire les jeunes par son propos et son style
"modernes", de se rallier des composantes moins politisées de l'électorat par
son charisme ou par son anticléricalisme, devenu un atout politique dans la
Pologne postcommuniste.
Même les révélations faites entre les deux tours sur la
formation supérieure affichée à tort par A.
Kwasniewski et sur le fait que sa
femme détenait des actions non déclarées au fisc n'ont eu aucune prise sur sa
cote de popularité.
Il a recueilli la majorité des suffrages chez les plus
jeunes (18-29 ans: 53,1 %; 30-39 ans: 50,1 %; 40-49 ans: 52,7 %) ainsi que chez
les ouvriers (52,3 %), les employés de bureau (53,7 %), les chômeurs (59,5 %).
Il s'agissait là d'un électorat paradoxal: certains de ses partisans l'ont suivi
parce qu'ils croyaient qu'il n'avait pas changé (les nostalgiques de l'ancien
régime, du plein emploi, de l'État-providence) et d'autres parce qu'ils
croyaient qu'il avait vraiment changé (les jeunes, les couches moyennes) et
qu'il était résolument tourné vers l'avenir.
L'électorat du président sortant, qui a bénéficié au second tour du soutien de
l'Union pour la liberté (UW) - dont le candidat, opposant historique au
communisme et ministre du Travail remarqué de plusieurs gouvernements
postcommunistes, Jasek Kuron n'a obtenu que 9,22 % de voix -, a paru plus
éphémère.
Mobilisé essentiellement autour d'un dessein "négatif" - barrer le
chemin aux "rouges" -, il a fait l'objet, dès le lendemain des élections, d'une
forte fragmentation, qui caractérise l'état des droites polonaises.
Dès la fin de la campagne électorale, un scandale a éclaté lié à la personne du
Premier ministre Joseph Oleksy, qui, accusé d'intelligence avec la Russie, y
compris dans la période postérieure à l'effondrement de l'URSS, a dû
démissionner; il a été remplacé, le 7 février 1996, par Wlodzimierz Cimoszewicz.
L'enquête, aussitôt ordonnée, n'a pu prouver le bien-fondé de cette accusation,
mais le mal était fait.
La purge des services secrets a plus ressemblé à un
règlement de comptes qu'à la punition des responsables d'une opération mal
menée.
D'une part l'image....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓