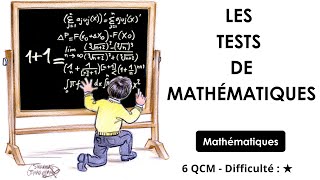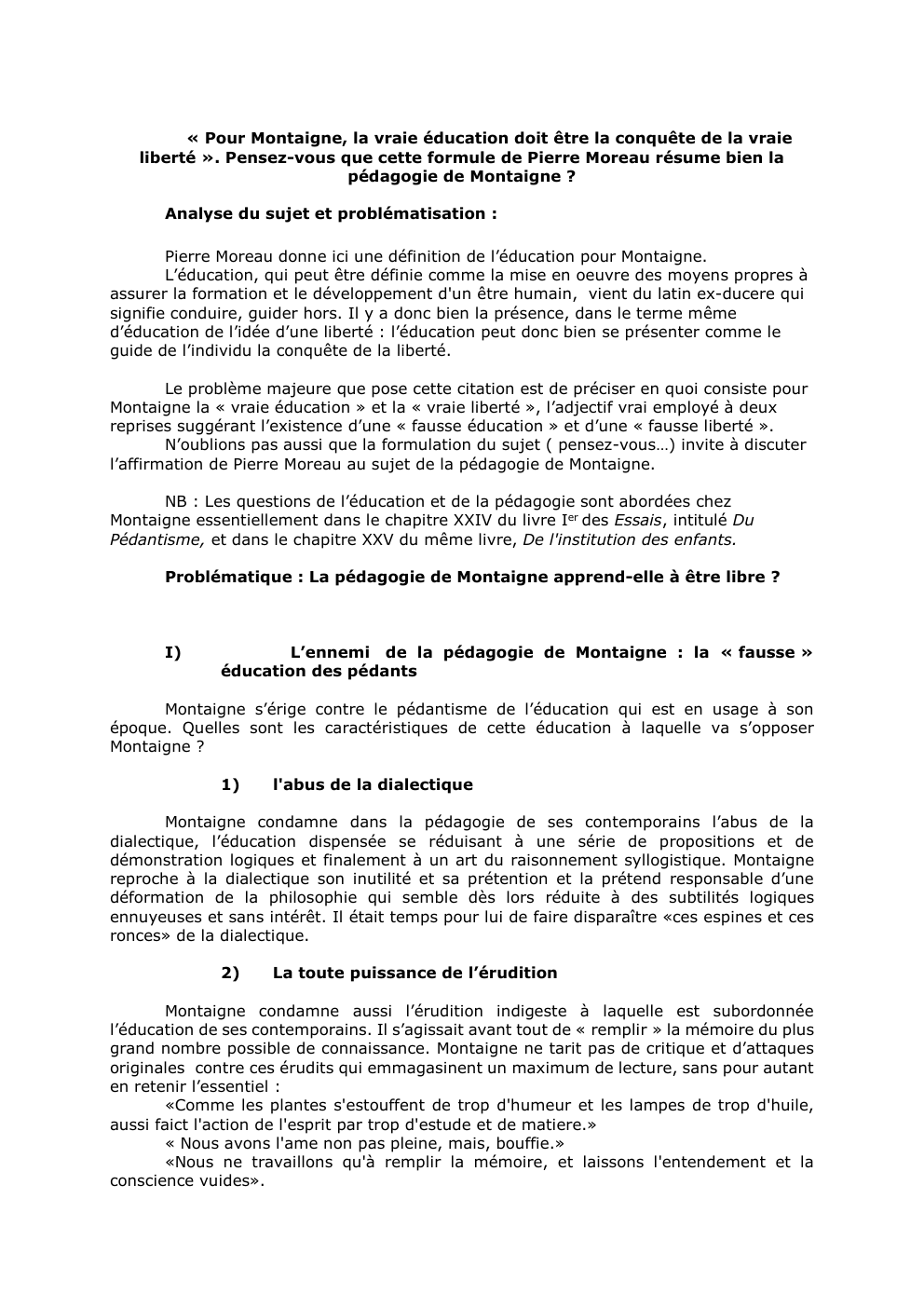« Pour Montaigne, la vraie éducation doit être la conquête de la vraie liberté ». Pensez-vous que cette formule de...
Extrait du document
«
« Pour Montaigne, la vraie éducation doit être la conquête de la vraie
liberté ».
Pensez-vous que cette formule de Pierre Moreau résume bien la
pédagogie de Montaigne ?
Analyse du sujet et problématisation :
Pierre Moreau donne ici une définition de l’éducation pour Montaigne.
L’éducation, qui peut être définie comme la mise en oeuvre des moyens propres à
assurer la formation et le développement d'un être humain, vient du latin ex-ducere qui
signifie conduire, guider hors.
Il y a donc bien la présence, dans le terme même
d’éducation de l’idée d’une liberté : l’éducation peut donc bien se présenter comme le
guide de l’individu la conquête de la liberté.
Le problème majeure que pose cette citation est de préciser en quoi consiste pour
Montaigne la « vraie éducation » et la « vraie liberté », l’adjectif vrai employé à deux
reprises suggérant l’existence d’une « fausse éducation » et d’une « fausse liberté ».
N’oublions pas aussi que la formulation du sujet ( pensez-vous…) invite à discuter
l’affirmation de Pierre Moreau au sujet de la pédagogie de Montaigne.
NB : Les questions de l’éducation et de la pédagogie sont abordées chez
Montaigne essentiellement dans le chapitre XXIV du livre Ier des Essais, intitulé Du
Pédantisme, et dans le chapitre XXV du même livre, De l'institution des enfants.
Problématique : La pédagogie de Montaigne apprend-elle à être libre ?
I)
L’ennemi de la pédagogie de Montaigne : la « fausse »
éducation des pédants
Montaigne s’érige contre le pédantisme de l’éducation qui est en usage à son
époque.
Quelles sont les caractéristiques de cette éducation à laquelle va s’opposer
Montaigne ?
1)
l'abus de la dialectique
Montaigne condamne dans la pédagogie de ses contemporains l’abus de la
dialectique, l’éducation dispensée se réduisant à une série de propositions et de
démonstration logiques et finalement à un art du raisonnement syllogistique.
Montaigne
reproche à la dialectique son inutilité et sa prétention et la prétend responsable d’une
déformation de la philosophie qui semble dès lors réduite à des subtilités logiques
ennuyeuses et sans intérêt.
Il était temps pour lui de faire disparaître «ces espines et ces
ronces» de la dialectique.
2)
La toute puissance de l’érudition
Montaigne condamne aussi l’érudition indigeste à laquelle est subordonnée
l’éducation de ses contemporains.
Il s’agissait avant tout de « remplir » la mémoire du plus
grand nombre possible de connaissance.
Montaigne ne tarit pas de critique et d’attaques
originales contre ces érudits qui emmagasinent un maximum de lecture, sans pour autant
en retenir l’essentiel :
«Comme les plantes s'estouffent de trop d'humeur et les lampes de trop d'huile,
aussi faict l'action de l'esprit par trop d'estude et de matiere.»
« Nous avons l'ame non pas pleine, mais, bouffie.»
«Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire, et laissons l'entendement et la
conscience vuides».
3)
Le scepticisme de Montaigne face à une éducation normative :
Montaigne refuse l’idée d’une pédagogie unique qui puisse éduquer tous les
hommes.
Selon lui, il ne faut pas considérer l'intelligence de l'élève comme un réceptacle
vide qu'il importe de remplir.
Cf.
Les Essais, livre 1, chap 26 :
Ceux qui, comme porte notre usage, entreprennent d’une
mesme leçon et pareille mesure de conduite regenter plusieurs
esprits de si diverses mesures et formes, ce n’est pas miracle si, en
tout un peuple d’enfans, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui
rapportent quelque juste fruit de leur discipline.
II)
En quoi consiste cette « vraie » éducation ?
1)
Une éducation générale de la nature humaine.
A la question « que doivent apprendre les enfants ? », Montaigne pourrait réponde
comme Putarque «Ce qu'ils doivent faire étant hommes.».
La pédagogie de Montaigne et
la « vraie » éducation doit avant tout former l’homme à devenir homme.
Une anecdote très célèbre formule les intentions pédagogiques de Montaigne :
Allant un jour à Orleans, je trouvay dans cette plaine, audeçà de Clery, deux regents qui venoyent a Bourdeaux, environ à
cinquante pas l'un de l'aultre; plus loing, derrière eux, je veoyois
une troupe, et un maistre en teste, qui estoit feu monsieur le comte
de la Rochefoucault.
Un de mes gents s'enquit au premier de ces
regents, qui estoit ce gentilhomme qui venait aprez luy: luy, qui
n'avoit pas veu ce train qui le suyvoit, et qui pensoit qu'on lui parlast
de son compaignon, respondit plaisamment: «Il n'est pas
gentilhomme, c'est un grammairien, et je suis logicien.» Or, nous
qui cherchons ici, au rebours, de former, non un grammairien ou
logicien, mais un gentilhomme, laissons-les abuser de leur loisir:
nous avons affaire ailleurs.
NB : Gentilhomme signifie ici tout simplement homme
Autre Ex : «C'est une grande simplesse d'apprendre à nos enfants la science des
astres, avant de leur apprendre la science de l'homme.»....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓