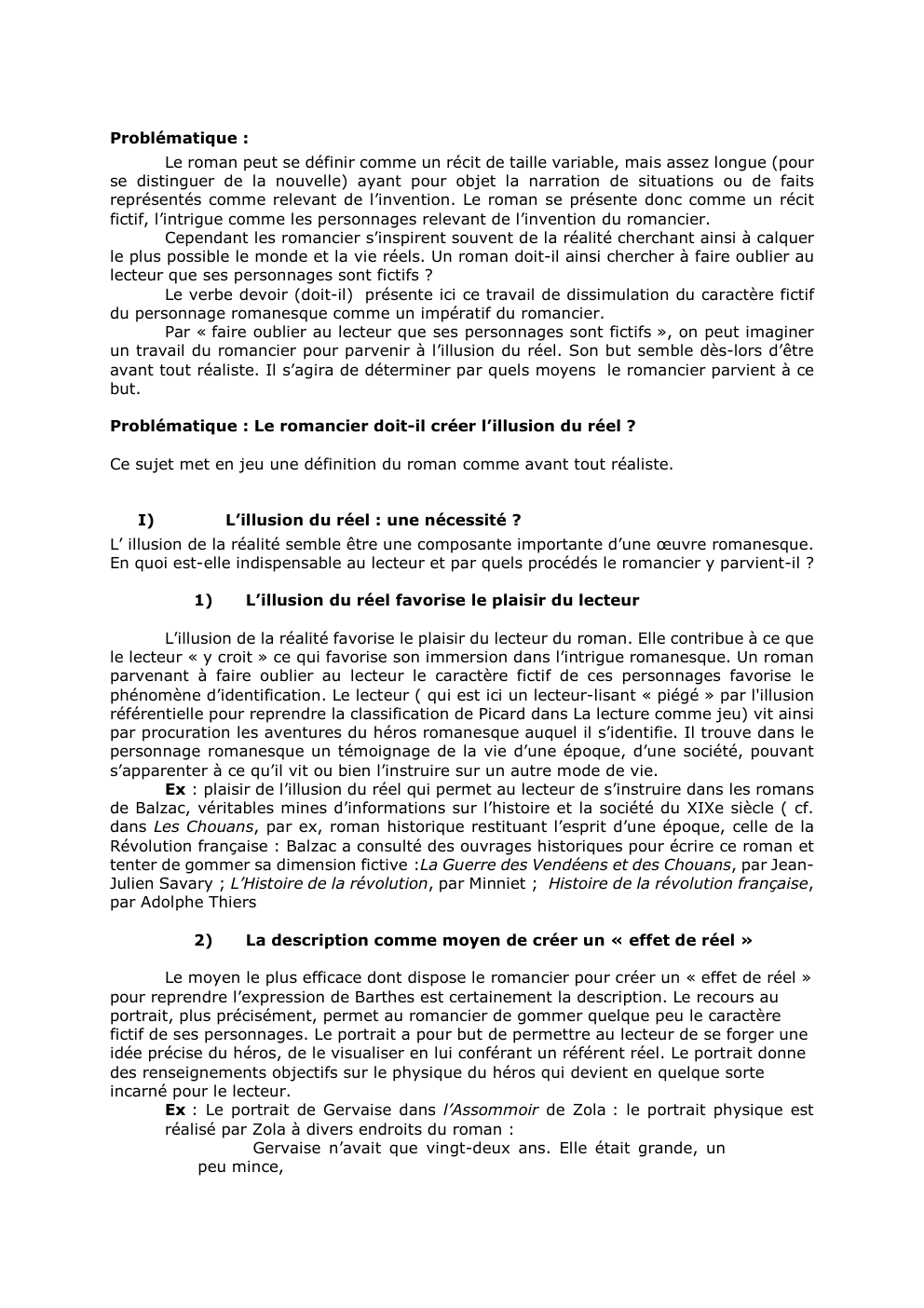Problématique : Le roman peut se définir comme un récit de taille variable, mais assez longue (pour se distinguer de...
Extrait du document
«
Problématique :
Le roman peut se définir comme un récit de taille variable, mais assez longue (pour
se distinguer de la nouvelle) ayant pour objet la narration de situations ou de faits
représentés comme relevant de l’invention.
Le roman se présente donc comme un récit
fictif, l’intrigue comme les personnages relevant de l’invention du romancier.
Cependant les romancier s’inspirent souvent de la réalité cherchant ainsi à calquer
le plus possible le monde et la vie réels.
Un roman doit-il ainsi chercher à faire oublier au
lecteur que ses personnages sont fictifs ?
Le verbe devoir (doit-il) présente ici ce travail de dissimulation du caractère fictif
du personnage romanesque comme un impératif du romancier.
Par « faire oublier au lecteur que ses personnages sont fictifs », on peut imaginer
un travail du romancier pour parvenir à l’illusion du réel.
Son but semble dès-lors d’être
avant tout réaliste.
Il s’agira de déterminer par quels moyens le romancier parvient à ce
but.
Problématique : Le romancier doit-il créer l’illusion du réel ?
Ce sujet met en jeu une définition du roman comme avant tout réaliste.
I)
L’illusion du réel : une nécessité ?
L’ illusion de la réalité semble être une composante importante d’une œuvre romanesque.
En quoi est-elle indispensable au lecteur et par quels procédés le romancier y parvient-il ?
1)
L’illusion du réel favorise le plaisir du lecteur
L’illusion de la réalité favorise le plaisir du lecteur du roman.
Elle contribue à ce que
le lecteur « y croit » ce qui favorise son immersion dans l’intrigue romanesque.
Un roman
parvenant à faire oublier au lecteur le caractère fictif de ces personnages favorise le
phénomène d’identification.
Le lecteur ( qui est ici un lecteur-lisant « piégé » par l'illusion
référentielle pour reprendre la classification de Picard dans La lecture comme jeu) vit ainsi
par procuration les aventures du héros romanesque auquel il s’identifie.
Il trouve dans le
personnage romanesque un témoignage de la vie d’une époque, d’une société, pouvant
s’apparenter à ce qu’il vit ou bien l’instruire sur un autre mode de vie.
Ex : plaisir de l’illusion du réel qui permet au lecteur de s’instruire dans les romans
de Balzac, véritables mines d’informations sur l’histoire et la société du XIXe siècle ( cf.
dans Les Chouans, par ex, roman historique restituant l’esprit d’une époque, celle de la
Révolution française : Balzac a consulté des ouvrages historiques pour écrire ce roman et
tenter de gommer sa dimension fictive :La Guerre des Vendéens et des Chouans, par JeanJulien Savary ; L’Histoire de la révolution, par Minniet ; Histoire de la révolution française,
par Adolphe Thiers
2)
La description comme moyen de créer un « effet de réel »
Le moyen le plus efficace dont dispose le romancier pour créer un « effet de réel »
pour reprendre l’expression de Barthes est certainement la description.
Le recours au
portrait, plus précisément, permet au romancier de gommer quelque peu le caractère
fictif de ses personnages.
Le portrait a pour but de permettre au lecteur de se forger une
idée précise du héros, de le visualiser en lui conférant un référent réel.
Le portrait donne
des renseignements objectifs sur le physique du héros qui devient en quelque sorte
incarné pour le lecteur.
Ex : Le portrait de Gervaise dans l’Assommoir de Zola : le portrait physique est
réalisé par Zola à divers endroits du roman :
Gervaise n’avait que vingt-deux ans.
Elle était grande, un
peu mince,
avec des traits fins, déjà tirés par les rudesses de sa vie.
Dépeignée,
en savates, grelottant sous sa camisole blanche où les
meubles
avaient laissé de leur poussière et de leur graisse, elle
semblait
vieillie de dix ans par les heures d'angoisse et de larmes
qu'elle
venait de passer.
[…]
Gervaise boitait de la jambe droite ; mais on ne s'en
apercevait guère
que les jours de fatigue, quand elle s'abandonnait, les
hanches
brisées.
Ce matin-là, rompue par sa nuit, elle traînait sa
jambe, elle
s'appuyait aux murs.
à Zola multiplie les détails précis du physique de son héroïne favorisant ainsi
l’illusion du réel.
3)
L’illusion réaliste nécessite un travail sur la psychologie des
personnages
Pour faire oublier au lecteur le caractère fictif des personnages romanesques, le
romancier doit nécessairement soigner l’élaboration de la psychologie des personnages
afin que celle-ci soit la plus réaliste possible.
Il doit conférer à ses personnages des
réactions physiques et psychiques proprement humaines ce qui contribue par ailleurs à
susciter l’émotion du lecteur.
Ex : Le roman dit « psychologique » qui privilégie l’atteinte de la vie intérieure des
personnages à l’intrigue ou à la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓