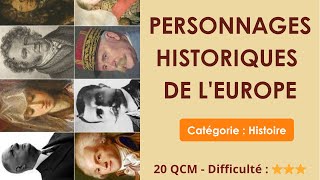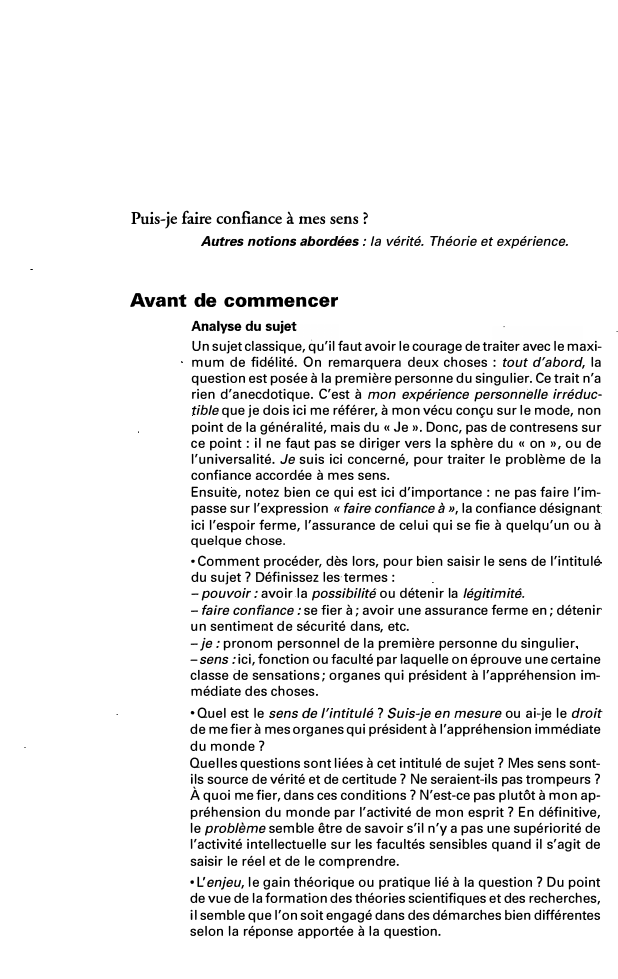Puis-je faire confiance à mes sens ? Autres notions abordées: la vérité. Théorie et expérience. Avant de commencer Analyse du...
Extrait du document
«
Puis-je faire confiance à mes sens ?
Autres notions abordées: la vérité.
Théorie et expérience.
Avant de commencer
Analyse du sujet
Un sujet classique, qu'il faut avoir le courage de traiter avec le maxi
mum de fidélité.
On remarquera deux choses : tout d'abord, la
question est posée à la première personne du singulier.
Ce trait n'a
rien d'anecdotique.
C'est à mon expérience personne/le irréduc
tible que je dois ici me référer, à mon vécu conçu sur le mode, non
point de la généralité, mais du «Je».
Donc, pas de contresens sur
ce point: il ne faut pas se diriger vers la sphère du « on », ou de
l'universalité.
Je suis ici concerné, pour traiter le problème de la
confiance accordée à mes sens.
Ensuite, notez bien ce qui est ici d'importance : ne pas faire l'im
passe sur l'expression « faire confiance à», la confiance désignant
ici l'espoir ferme, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à
quelque chose.
• Comment procéder, dès lors, pour bien saisir le sens de l'intitulé
du sujet? Définissez les termes:
- pouvoir: avoir la possibilité ou détenir la légitimité.
- faire confiance: se fier à; avoir une assurance ferme en; détenir
un sentimer.it de sécurité dans, etc.
- je: pronom personnel de la première personne du singulier.
-sens: ici, fonction ou faculté par laquelle on éprouve une certaine
classe de sensations; organes qui président à l'appréhension im
médiate des choses.
• Quel est le sens de l'intitulé? Suis-je en mesure ou ai-je le droit
de me fier à mes organes qui président à l'appréhension immédiate
du monde?
Quelles questions sont liées à cet intitulé de sujet? Mes sens sont
ils source de vérité et de certitude? Ne seraient-ils pas trompeurs?
À quoi me fier, dans ces conditions? N'est-ce pas plutôt à mon ap
préhension du monde par l'activité de mon esprit? En définitive,
le problème semble être de savoir s'il n'y a pas une supériorité de
l'activité intellectuelle sur les facultés sensibles quand il s'agit de
saisir le réel et de le comprendre.
•L'enjeu, le gain théorique ou pratique lié à la question ? Du point
de vue de la formation des théories scientifiques et des recherches,
il semble que l'on soit engagé dans des démarches bien différentes
selon la réponse apportée à la question.
Plan
Le plan sera de type dialectique, par thèse (je peux faire légitime
ment confiance à mes sens), antithèse (je dois les critiquer, les
mettre en doute) et synthèse (dans le domaine scientifique, en par
ticulier, je puis légitimement accorder foi à mes sens, intégrés dans
une forme et une structure abstraites).
Bibliographie
Le sujet étant extrêmement classique, la bibliographie consultée
sera évidemment importante.
Parmi les innombrables analyses
consacrées à ce sujet, notons les plus connues :
PLATON, La République, Garnier-Flammarion, livre VII, en particulier.
Théétète, éditions de poche diverses.
LUCRÈCE, De la nature des choses, Garnier-Flammarion, livre IV,
en particulier.
DESCARTES, Méditations métaphysiques, éditions de poche
diverses, Méditations 1, Il et VI.
ALAIN, Éléments de philosophie, Gallimard.
1!1) Introduction
Cela tombe sous le sens, dit-on couramment, en privilégiant (implicitement
ou explicitement) les sens comme facultés d'éprouver les impressions appor
rées par les objets matériels.
Apparemment donc, ce qui tombe sous le(s) sens,
�e qui est perçu ou perceptible par ces derniers est digne de confiance.
l.:odo
pt, l'ouïe, le toucher, la vue sont-ils toutefois si véridiques ? La question posée
interroge les certitudes du sens commun et l'adhésion immédiate à mes sens.
Ai-je le droit de me fier à mes organes qui président à l'appréhension immé
diate du réel et ma confiance relève-t-elle alors d'un processus légitime? C'est
la question de la légitimité qui est ici soulevée.
Je vois ce mimosa vert et jaune
devant moi.
Il se détache dans le ciel bleu de la Provence.
Suis-je en mesure de
çl.ire que mes affections sensibles, mon « jaune », mon « vert » sont véridiques
et fondés en réalité ?
Mes sens sont-ils source de vérité et de certitude ? Ne seraient-ils pas trompeurs
et générateurs d'illusions, de croyances fausses enracinées en moi ? Ne dois-je
pas légitimement les mettre en doute ? N'y a-t-il pas supériorité de l'activité
intellectuelle et conceptuelle par rapport aux facultés sensibles ? Tel est, en dé
finitive, le problème soulevé par le sujet, problème dont l'enjeu est manifeste car,
suivant la réponse apportée, j'organiserai mes recherches spéculatives ou
pratiques selon une optique et une démarche fondamentalement opposées.
!!
1) Discussion
A.
Je puis légitimement faire confiance à mes sens (thèse)
Faire confiance, c'est, on l'a vu, accorder crédit à une réalité.
Or comment mes
sens ne me sembleraient-ils pas dignes de confiance? Tout ce que je sais du monde,
je le sais à partir d'une expérience sensible sans laquelle rien ne pourrait être
appréhendé.
Les sens désignant les organes intermédiaires entre moi et l'uni
vers, ils paraissent, initialement, entièrement dignes de confiance, car ils
paraissent fonder mon vécu, qui s'origine en eux.
Dignes de confiance, d'abord, en ce qui concerne ce vécu à proprement parler.
Après tout, le concept, la notion, l'idée semblent multiples et surtout construits.
Or mes sens semblent m'apporter une vérité immédiate et initiale.
L immédia
teté n'est-elle pas insoupçonnable ? Il y a, en première approche, une dimen
sion privilégiée de l'expérience obtenue par les sens, par l'odorat, la vue ou
l'ouïe.
Il y a, dans mes sens, dans ces couleurs qui me sont apportées, des traits
qui paraissent immédiats et clairs et, par conséquent, je ne vois pas pourquoi
je les mettrais en doute.
Les sens m'apportent des impressions ou qualités im
médiates indubitables.
Cette tâche rouge que je vois sur le tapis n'est-elle pas
un irréductible ? Les sens véhiculent le monde vécu de manière directe et je
dois leur accorder crédit.
Mais le vécu n'est pas seul concerné par ces analyses.
Non seulement je puis lé
gitimement accorder ma confiance aux sens au niveau de l'immédiat, mais il
semble aussi que je doive leur faire crédit en ce qui concerne l'acquisition d'une
vérité scientifique élaborée.
Dois-je et puis-je accorder à mes sens crédit dans le
champ de la constitution de la vérité? Certainement.
Sens et sensation ne sont
ils pas la base de toute connaissance ? Toute vérité n'est-elle pas issue des sens ?
« Tu trouveras que la connaissance de la vérité nous vient primitivement des
sens et que leur témoignage ne peut être convaincu d'erreur.
Car on doit ac
corder davantage de foi à ce qui peut par soi-même assurer le triomphe du vrai
par rapport au faux.
Or, où trouver un témoignage plus sûr que celui des sens
? S'ils nous induisaient en erreur, dira-t-on que la raison pourra déposer contre
eux, elle qui leur doit toute son existence ? Si nous les supposons trompeurs,
la raison à son tour se transformera en une puissance de mensonge.
» (Lucrèce,
De la nature des choses)
Transition
Toutefois, ce qui est chaud et brûlant pour moi est glacial pour mon voisin.
Le
soleil et cette chaleur torride pour moi sont agréables climats pour l'autre.
La
relativité des sens conduit à approfondir la question : puis-je légitimement ac....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓