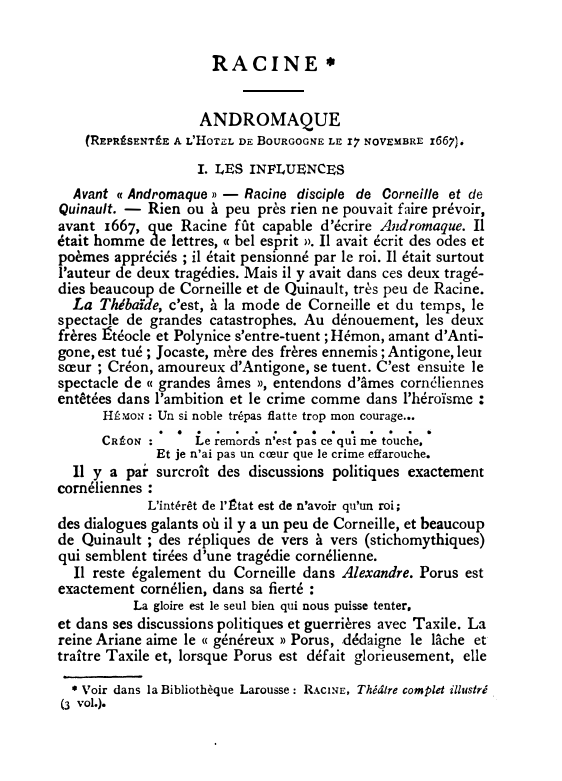RA C I N E * ANDROMAQUE (REPRÉSENTÉE A L'HOTEL DE BOURGOGNE LE I7 NOVEMBRE I 6 67) • I....
Extrait du document
«
RA C I N E *
ANDROMAQUE
(REPRÉSENTÉE A L'HOTEL
DE BOURGOGNE LE
I7
NOVEMBRE
I 6 67) •
I.
LES INFLUENCES
A vant « Andromaque
Quinault.
- Rien ou
>>
-
Racine disciple
de
Corneille et de
à peu près rien ne pouva it faire prévoir,
avant 1 667, que Racine fût capable d 'écrire Andromaque.
Il
était homme de lettres, >.
Il avait écrit des odes et
poèmes appréciés ; il était pens10nné par le roi .
Il était surtout
l'auteur de deux tragédies.
Mais il y avait dans ces deux tragé
di e s beaucoup de Corneille et de Quinault, très peu de Racine.
La Thébaïde, c'est, à la mode de Corneille et du temps, le
spectacle de grandes catastrophes.
Au dénouement, les deux
frères Étéocle et Polynice s'entre-tuent ; Hémon, amant d 'Anti
gone , est tué ; Jocaste, mère des frères ennemis ; Antigone, leur
sœur ; Créon, amoureux d'Antigone , se tuent .
C'est ensuite l e
spectacle d e « grandes âmes ll, entendons d 'âmes cornéliennes
entêtées dans l'ambition et le crime comme dans l'héroïsme :
HÉ MON : Un si n ob le trépas fiatte trop mon courage
.••
CRÉON :
L e remords n ' e�t p a s ce q u i me touche,
Et je n'ai pas un c œur qu e le crime effarouche.
y a par surcroît des discussions politiques exactement
Il
cornél iennes
:
L'int�rêt de l ' nt a t est de n'avoir qu'un roi ;
des dialogues galants où il y a un peu de Corneille, et beaucou p
de Quinault ; des répliques de vers à vers (stichomythiques)
qui semblent tirées d 'une tragédie cornélienne.
Il reste également du Corneille dans Alexandre.
Poru s est
exactement cornélien, dans sa fierté :
La gloire est le seul bien qui nous puisse tenter,
et dans ses discussions p o l i t ique s et guerrières avec Taxile.
La
reine Ariane aime le « généreux >> Porus , dédaigne l e lâche et
traître Taxile et, lorsque Porus est défait glorieusement, elle
• Voir dans l a Bibliothèque Larousse : RACINE, Théâtre complet illustré
(3 vol.).
X VIIe SIÈCLE
- 73
suit s a fortune comme i l convient aux grands cœurs qui ont
été à l'école de Cinna ou de Pompée.
Mais il y a aussi et surtout
du Quinault.
Quinault, qui n 'avait encore écrit que des tragédies, tragi
comédies ou comédies, était un auteur illustre.
Il ne S ŒUVRSS
6
chez Racine, ne se précise nulle part : il n'est pas un romantique.
Mais elle flotte, et, de temps à autre, elle semble se condenser
dans quelques-uns de ces vers où frémissent des vibrations
romantiques.
ORESTE
Tu m'as vu, depuis,
Trainer de mers en mers ma chaine et mes ennuis.
liERMIONE
Mool cœur, toi-même enfin de sa gloire éblouie,
Avaolt qu'il me trahît, vous m'avez tous trahie.
ANDROMAQUE
Songe, song�.
Céphise, à cette nuit cruell�
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle:
etc
•..
Conséquenoes techniques.
-
•
Andromaque » et /es règles.
-
Une des conséquences de cette transformation de la tragédie
fut l'aisance avec laquelle Racine se plia à la règle des trois
unités.
Conséquence et non pas calcul appliqué.
Racine a voulu
peindre des passions violentes et non pas chercher le plus sûr
moyen d'observer les règles.
Cette question des règles est, en
166-; , à la fois essentielle et secondaire.
C'est en 166o que Cor
neille publie ses Examens et ses Discours, où il examine et dis
cute surtout ce qu'il y a de régulier ou d'irrégulier dans ses
tragédies.
La Pratique du.
théâtre, de l'abbé d'Aubignac, est de
1657.
Dans ses premières préfaces.
Racine disserte, fort souvent,
sur les principes du poème dramatique.
C'est au nom de ces
principes que ses ennemis le critiqueront.
Mais nous avons
tendance aujourd'hui à croire que, parmi les rè�les, une seule
avait une importance décisive : celle des trois umtés.
En réalité,
c'était une règle parmi beaucoup d'autres, la plus claire seule
ment, la plus aisée à vérifier, non la plus importante.
Corneille
s'y était difficilement adapté.
On le tiendra pourtant, jusqu'à
la fin du siècle, pour un poète supérieur à Racine ou tout au
moins pour son égal.
Racine lui-même n'a pas tiré vanité de
cette régularité de ses tra�édies.
Remarquons même que si
l'unité de temps est poss1ble ou même vraisemblable pour
Andromaque, elle n'est pas la plus vraisemblable.
Oreste,
comme ambassadeur des Grecs., vient réclamer Asty
anax.
Jamais chef d'�tàt n'a été, même pour un ultimatum, obligé d�
répondre dans les vingt-quatre heures.
Il se peut que Pyrrhus,
excédé, exige d'Andromaque qu'elle se décide ; il n'est pas
nécessaire qu'il l'épouse le jour même.
Tout cela peut cepen-
dant se dérouler en un jour.
Racine, comme dans ses futures....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓