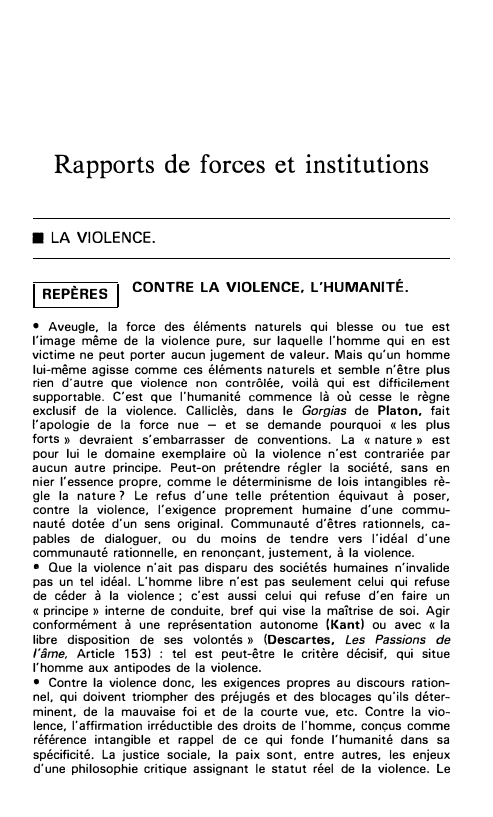Rapports de forces et institutions ■ LA VIOLENCE. REPÈRES CONTRE LA VIOLENCE. L'HUMANITÉ. • Aveugle, la force des éléments naturels...
Extrait du document
«
Rapports de forces et institutions
■ LA VIOLENCE.
REPÈRES
CONTRE LA VIOLENCE.
L'HUMANITÉ.
• Aveugle, la force des éléments naturels qui blesse ou tue est
l'image même de la violence pure, sur laquelle l'homme qui en est
victime ne peut porter aucun jugement de valeur.
Mais qu'un homme
lui-même agisse comme ces éléments naturels et semble n'être plus
rien d'autre que violence non contrôlée, voilà qui est difficilement
supportable.
C'est que l'humanité commence là où cesse le règne
exclusif de la violence.
Calliclès, dans le Gorgias de Platon, fait
l'apologie de la force nue - et se demande pourquoi « les plus
forts » devraient s'embarrasser de conventions.
La « nature » est
pour lui le domaine exemplaire où la violence n'est contrariée par
aucun autre principe.
Peut-on prétendre régler la société, sans en
nier l'essence propre, comme le déterminisme de lois intangibles rè
gle la nature ? Le refus d'une telle prétention équivaut à poser,
contre la violence, l'exigence proprement humaine d'une commu
nauté dotée d'un sens original.
Communauté d'êtres rationnels, ca
pables de dialoguer, ou du moins de tendre vers l'idéal d'une
communauté rationnelle, en renonçant, justement, à la violence.
• Que la violence n'ait pas disparu des sociétés humaines n'invalide
pas un tel idéal.
L'homme libre n'est pas seulement celui qui refuse
de céder à la violence; c'est aussi celui qui refuse d'en faire un
« principe » interne de conduite, bref qui vise la maîtrise de soi.
Agir
conformément à une représentation autonome (Kant) ou avec « la
libre disposition de ses volontés » (Descartes, Les Passions de
l'âme, Article 153) : tel est peut-être le critère décisif, qui situe
l'homme aux antipodes de la violence.
• Contre la violence donc, les exigences propres au discours ration
nel, qui doivent triompher des préjugés et des blocages qu'ils déter
minent, de la mauvaise foi et de la courte vue, etc.
Contre la vio
lence, l'affirmation irréductible des droits de l'homme, conçus comme
référence intangible et rappel de ce qui fonde l'humanité dans sa
spécificité.
La justice sociale, la paix sont, entre autres, les enjeux
d'une philosophie critique assignant le statut réel de la violence.
Le
« réalisme » vulgaire s'en prend très souvent aux exigences éthiques,
qu'il prétend disqualifier au nom de ce qui ne serait qu'un
« constat » : la prégnance multiforme de la violence dans les rap
ports sociaux.
Mais un tel « réalisme » {ou prétendu tel) ne fait qu'in
terpréter, lui aussi, ce qui se donne comme fait brut et irréductible.
Rien n'interdit de penser, comme Kant dans La Philosophie de /'his
toire, la valeur propre des idéaux de justice et de paix dans un
monde qui ne leur semble guère favorable.
Encore faut-il créditer
l'homme d'une faculté de progrès et de dépassement et, dans l'hy
pothèse même où il serait naturellement enclin à la violence, d'une
capacité de « résistance » à cette violence.
C'est ici que la Raison se
découvre des intérêts propres, pratiques et pas seulement théori
ques.
[LILLE B)
Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude
ordonnée.
Il ne doit y avoir aucune guerre; ni celle entre toi et moi dans l'état de
nature, ni celle entre nous en tant qu'États, qui bien qu'ils se trouvent
intérieurement dans un état légal, sont cependant extérieurement (dans
leur rapport réciproque) dans un état dépourvu de lois - car ce n'est pas
ainsi que chacun doit chercher son droit.
Aussi la question n'est plus de
savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel ou si ce n'est
qu'une chimère et si nous ne nous trompons pas dans notre jugement
théorique, quand nous admettons le premier cas, mais nous devons agir
comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait être, et en vue de sa
fondation établir la constitution qui nous semble la plus capable d'y me
ner et de mettre fin à la conduite de la guerre dépourvue de salut, vers
laquelle tous les États sans exception ont jusqu'à maintenant dirigé leurs
préparatifs intérieurs, comme vers leur fin suprême.
Et si notre fin, en ce
qui concerne sa réalisation, demeure toujours un vœu pieux, nous ne nous
trompons certainement pas en admettant la maxime d'y travailler sans
relâche, puisqu'elle est un devoir.
KANT
CORRIGÉ
ÉTUDE DE TEXTE ENTIÈREMENT RÉDIGÉE
• Introduction.
La guerre n'a cessé d'ensanglanter l'histoire humaine, et
de renaître malgré les traités de paix successifs.
Le vingtième
siècle a connu deux guerres mondiales, et la faillite notoire
de la Société des Nations (S.D.N.), destinée pourtant, après
les horreurs de la première guerre, à empêcher la seconde.
L'idée d'une paix perpétuelle serait-elle pure chimère ? Il n'y
a pas loin du constat à l'interprétation fataliste, qui voit dans
les faits passés et présents la nécessaire conséquence de la
méchanceté naturelle de l'homme, donnée comme évidente.
Ce « diagnostic » apparemment lucide n'annonce rien de bon
pour l'avenir, si les mêmes causes produisent les mêmes ef
fets.
La disqualification d'une espérance, lorsqu'elle conduit
l'homme à renoncer à son devoir, et justifie son cynisme en
le donnant comme réalisme, relève d'une approche critique
rigoureuse, car elle atteste une certaine confusion.
Le doute
quant à l'existence future d'un monde sans guerre justifie-t-il
ce qui, sous prétexte de réalisme politique, maintient entre
les États une logique de rapports de force ? Le paradoxe
habituel - « si tu veux la paix prépare la guerre » - est-il
aussi évident qu'on le prétend ? L'idée d'un droit internatio
nal permettant de s'acheminer vers la paix entre les États
est-elle si chimérique ? L'étude d'un texte de Kant va nous
permettre de prendre en charge ces questions, dont l'enjeu
est décisif pour définir le sens de l'idéal de paix.
• Étude ordonnée du texte.
Aucun homme, lorsqu'il dispose de sa raison, et prend
lucidement la mesure de ce qu'est une guerre, ne peut réel le
ment la vouloir.
Certes, il croit devoir s'y résoudre dans des
cas où elle lui semble nécessaire pour recouvrer une liberté,
pour résister à une agression.
Mais alors il ne la saisit que
comme moyen, et veut bien sûr en limiter la réalité au strict
nécessaire pour atteindre la fin visée.
C'est dire qu'aucun
homme ne peut_, lorsqu'il se comprend lui-même comme sujet
rationnel et partie prenante de l'humanité, vouloir la guerre
pour elle-même.
La guerre ne peut jamais être une fin en soi,
sauf peut-être pour ceux qui la valorisent en tant qu'aven
ture, et ne la valorisent ainsi que tant qu'ils n'en sont pas les
victimes.
En fait, la guerre n'est tout au plus que le substitut
déplorable d'une autre façon de faire de la politique (cf.
la
célèbre affirmation de Clausewitz : « la guerre est la conti
nuation de la politique par d'autres moyens »).
Le sens qu'il
faut donner à la maxime qui ouvre le texte est très clair : « il
ne doit y avoir aucune guerre ».
Le thème du texte est ici
dessiné : il s'agit de la paix comme fin idéale.
La maxime
évoquée par Kant est envisagée dans son application paral
lèle aux relations entre individus, et aux relations entre États.
Le caractère · très personnalisé de la formulation mérite ici
l'attention : « entre toi et moi dans l'état de nature, entre
nous en tant qu'États » - Kant n'écrit pas « entre les hom
mes », qui seraient alors entendus de façon anonyme.
S'il
envisage tour à tour les hommes dans l'état de nature et les
hommes dans l'exercice de la citoyenneté, comme partie pre
nante des États, ne cherche-t-il pas à faire éprouver, par sa
formulation, que chaque personne est une fin, en tant qu'elle
est comprise comme humanité, et, inversement, que l'huma
nité est en jeu dans chaque personne? C'est toujours une
personne qui meurt, et non un homme abstrait : et c'est
justement pour cela que toute mort me touche, car elle pour
rait être celle d'un proche.
Le point de vue de l'universel est
d'emblée en jeu dans la prise en considération de la personne
en tant que telle.
Ceux qui envisagent sans cas de
conscience une guerre n'appréhendent le plus souvent que la
figure la plus impersonnelle de la mort des autres.
L'admet
traient-ils aussi facilement si la perspective de la mort de
leurs proches se présentait à leur esprit? La pensée de ta
mort (la mort en « deuxième personne », selon Jankélévitch
cf.
La mort, Édition Champs-Flammarion), lorsqu'elle me sert
à saisir ce que peut être la mort de tout homme, me la rend
insupportable : les morts anonymes des guerres (en « troi
sième personne » dirait Jankélévitch), reconsidérées à tra
vers cette pensée, constituent un scandale permanent, trop
souvent banalisé, et auquel on ne peut ni ne doit s'habituer.
Kant évoque donc très fortement le refus de la guerre,
comme refus d'un état de nature, c'est-à-dire d'un état où
règne le seul rapport de forces, où le droit n'existe pas.
Mais
c'est pour souligner aussitôt une sorte d'anomalie : pour
mettre fin à l'état de nature et à ce qui pourrait bien être,
selon la formule de Hobbes, un « état de guerre de tous
contre tous », les hommes se sont donné un état légal « in
térieurement », mais ils ont négligé de le faire « extérieure
ment ».
La thématisation kantienne se précise ici dans une
réflexion sur le rapport qui pourrait bien exister entre la paix
civile et la « paix extérieure », c'est-à-dire à l'échelle cosmo
politique.
Si, selon la formule proposée, « chacun doit cher
cher son droit », ce ne peut être, pour Kant, que dans l'insti
tution de lois, afin de régler les rapports entre les États
comme se règlent, dans la constitution républicaine, les rap
ports entre les individus.
La thèse du texte est déjà large
ment suggérée par le parallélisme de Kant : si la fin idéale
est la paix; il faut la rechercher sur le plan international par
une constitution, permettant de régler les rapports entre les
États, de telle sorte que le faible et le fort soient soumis à
une loi commune, et que le faible ne soit pas assujetti au
fort.
Bref, s'il convient de s'éloigner de l'état de nature pour
que la vie civile d'un pays soit possible, il convient également
de le faire pour que la paix dans le monde le soit aussi.
Est-ce possible ? Les relations entre États peuvent-elles
échapper à la violence et à la loi du plus fort? D'emblée
Kant envisage les objections qu'on peut lui adresser, au nom
du réalisme (ce qui ne veut pas forcément dire conformément
au réalisme).
Si la paix perpétuelle (c'est-à-dire assez forte
pour ne plus être compromise) est difficile à atteindre, doit
elle cesser pour autant d'être un objectif visé? Autant dire
qu'on ne cherchera pas à soigner une maladie réputée aujour
d'hui incurable...
L'argumentation que développe Kant à par
tir de la seconde phrase mérite d'être analysée de près.
Pre
nons l'objectif que constitue la paix perpétuelle.
Qu'est-ce qui
permet de dire qu'il s'agit d'une chimère? Les arguments
invoqués en la matière sont-ils de véritables preuves? Se
référer à la multiplicité des guerres passées ou présentes,
c'est s'en tenir à l'expérience connue.
Expliquer ces guerres
par la « méchanceté naturelle de l'homme», c'est faire une
hypothèse, qui n'a rien d'évident.
A supposer qu'elle existe,
cette méchanceté produit-elle nécessairement de tels effets ?
Par ailleurs, ne peut-on pas tout aussi bien expliquer les ac
tes de dévouement, d'entraide, par la bonté naturelle de
l'homme ? La méchanceté est donc une des potentialités de
l'homme, mais la bonté aussi.
Ni l'une ni l'autre ne peuvent
constituer une explication suffisante, car on peut se deman
der ce qui fait qu'une potentialité passe à l'acte plutôt
qu'une autre.
La fatalisation de la guerre à partir d'une théo
rie de la nature humaine inférée d'une expérience limitée
n'est donc pas recevable, car sur deux points la théorie qui
la sous-tend est défaillante : la généralisation abusive qui
institue une expérience étendue, mais toujours limitée, en
preuve d'une nature permanente, dépourvue de toute liberté,
et partant susceptible de produire indéfiniment ses effets ; et
l'explication causale unilatérale qui confond potentialité et
disposition immédiate à agir.
Il n'est donc pas possible d'af
firmer que la guerre existera toujours sous prétexte qu'elle
s'est produite souvent.
De l'avenir, nous ne pouvons juger à
partir du passé ; nous pouvons tout au plus faire des conjec
tures, raisonner en termes de probabilités.
On ne peut donc
pas plus affirmer avec certitude que la guerre est perpétuelle,
ou que la paix perpétuelle existera effectivement.
L'expé
rience humaine déborde, par....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓