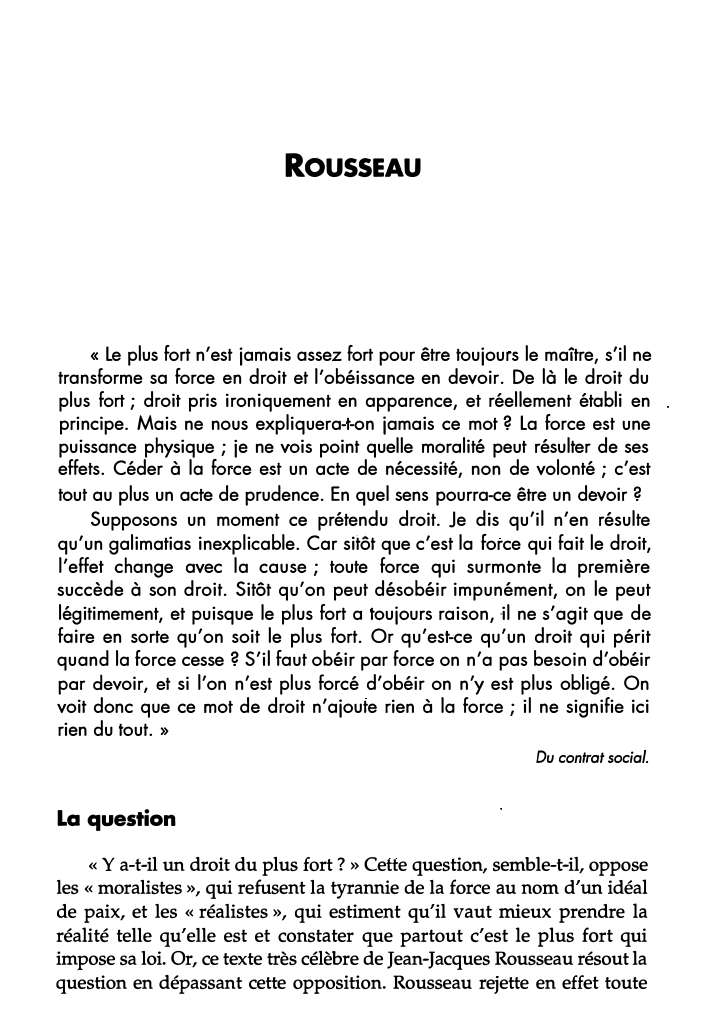ROUSSEAU « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en...
Extrait du document
«
ROUSSEAU
« Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne
transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.
De là le droit du
plus fort; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en
principe.
Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une
puissance physique; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses
effets.
Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté; c'est
tout au plus un acte de prudence.
En quel sens pourra-ce être un devoir ?
Supposons un moment ce prétendu droit.
Je dis qu'il n'en résulte
qu'un galimatias inexplicable.
Car sitôt que c'est la force qui fait le droit,
l'effet change avec la cause; toute force qui surmonte la première
succède à son droit.
Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut
légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, ·il ne s'agit que de
faire en sorte qu'on soit le plus fort.
Or qu'est-ce qu'un droit qui périt
quand la force cesse? S'il faut obéir par force on n'a pas besoin d'obéir
par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir on n'y est plus obligé.
On
voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force; il ne signifie ici
rien du tout.
»
Du contrat social.
La question
«Y a-t-il un droit du plus fort ? » Cette question, semble-t-il, oppose
les«moralistes», qui refusent la tyrannie de la force au nom d'un idéal
de paix, et les «réalistes», qui estiment qu'il vaut mieux prendre la
réalité telle qu'elle est et constater que partout c'est le plus fort qui
impose sa loi.
Or, ce texte très célèbre de Jean-Jacques Rousseau résout la
question en dépassant cette opposition.
Rousseau rejette en effet toute
1-:.,,�
ue
/ idée de droit du plus fort non pas au nom d'une préférence idéologiq ,
mais bien à l'aide d'une démonstration qui se veut définitive.
Ainsi est
établi un principe ,immuable de la réflexion politique.
Pour comprendre le texte
Le plus fort, par définition, c'est celui qui emporte la décision dans
un conflit.
Il convient de garder cette définition présente à l'esprit pour
êomprendre la démonstration de Rousseau.
Elle implique que la force ne
se réduit pas à la supériorité physique ; la ruse, la séduction, le nombre,
sont aussi des forces.
Elle implique surtout que la force soit relative à la
situation dans laquelle se trouve les adversaires.
« Le plus fort n'est
jamais assez fort pour être toujours le maître».
Si fort que l'on soit, la
situation peut se renverser, et par exemple un combattant que l'on croit
invincible est vulnérable durant son sommeil.
Ce principe, évident mais
parfois oublié, porte en lui un paradoxe riche de conséquences : d'un
certain point de vue, la force est faible, au sens où toute supériorité est
fragile, et qui veut la maintenir est condamné à déployer des efforts
considérables, jusqu'au moment où il lui faudra bien céder.
Par conséquent, il ne suffit pas d'être le plus fort, ou de gagner la
guerre, il faut encore gagner la paix.
Plus précisément, il faut donner à sa
supériorité une stabilité que la force seule ne peut suffire à conférer.
C'est à ce moment que le droit intervient.
Pour pérennisèr sâ
domination, il faut que le vainqueur « transforme sa force en droit et
l'obéissance en devoir».
Remarquons qu'une victoire n'est vraiment
acquise que lorsque le vaincu reconnaît sa défaite et renonce à lutter
davantage.
Pour que l'état de choses ainsi créé puisse être durable, il
faut donc que cette soumission du vaincu le soit également.
Cela
implique qu'il promette, tacitement ou non, de ne plus utiliser la force
pour renverser le rapport qui s'est établi.
C'est cela, la force transformée
en droit.
Une domination qui s'est installée par la force se prolonge par
la reconnaissance d'un devoir d'obéissance.
Telle est donc l'origine du trop fameux« droit du plus fort»,« pris
ironiquement en apparence», dit Rousseau, car il semble bien plutôt
traduire un mépris du droit.
Répondre à la question :« de quel droit ? »
par « du droit du plus fort ! » ne vise pas à convaincre celui qui est
soumis du bien-fondé de sa servitude, mais bien plutôt à se poser au
dessus du droit.
Mais ce prétendu droit est aussi« réellement établi en
principe», au sens où c'est bien en son nom que les tyrans prétendent
justifier leur domination.
Ainsi le peuple asservi est doublement
soumis: résigné à obéir, il est amené à reconnaître la légitimité, ou a�
moins le caractère normal, de son esclavage.
C'est ici que commence la réfutation opérée par Rousseau.
Elle ne se
traduit pas par une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓