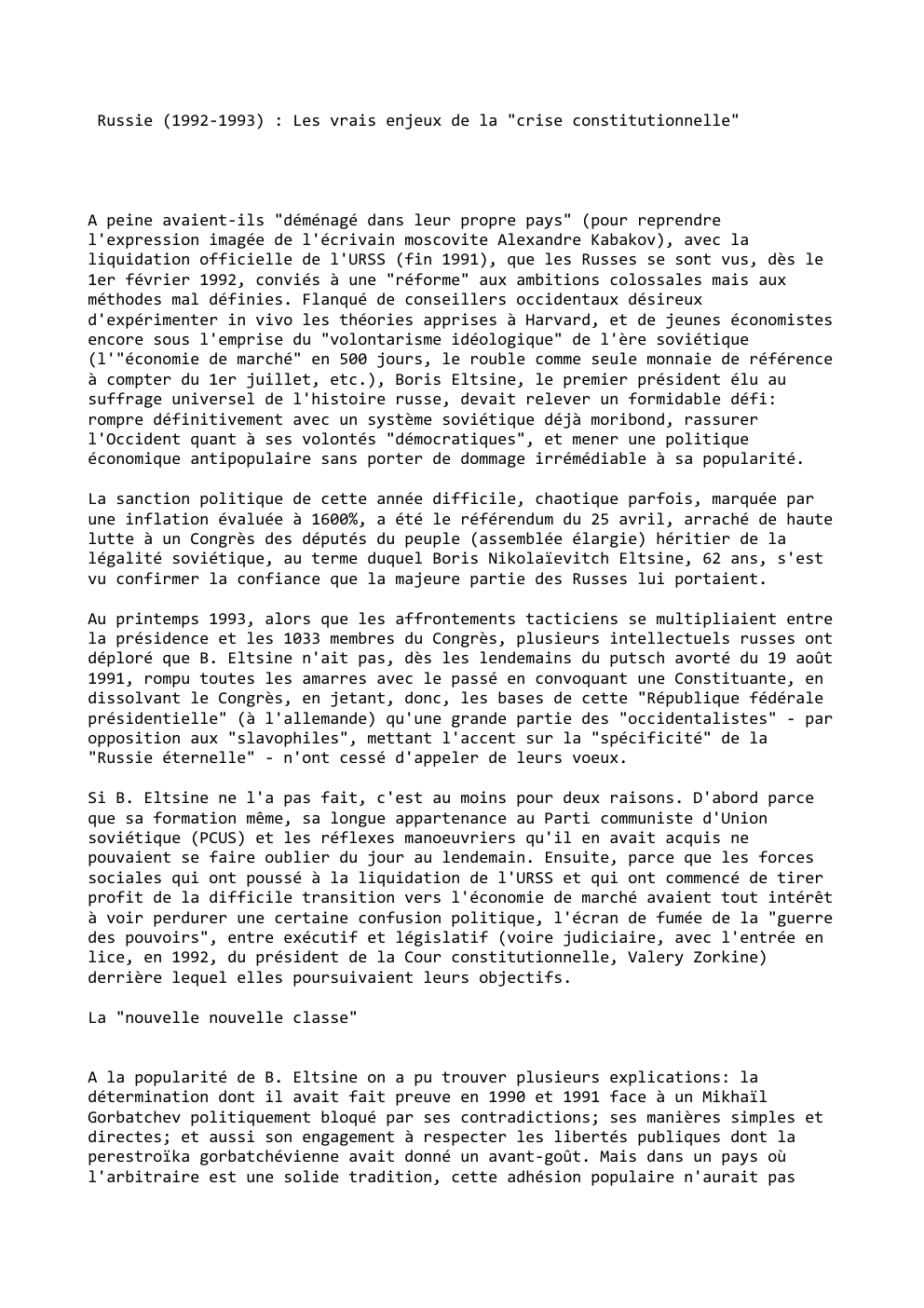Russie (1992-1993) : Les vrais enjeux de la "crise constitutionnelle" A peine avaient-ils "déménagé dans leur propre pays" (pour reprendre...
Extrait du document
«
Russie (1992-1993) : Les vrais enjeux de la "crise constitutionnelle"
A peine avaient-ils "déménagé dans leur propre pays" (pour reprendre
l'expression imagée de l'écrivain moscovite Alexandre Kabakov), avec la
liquidation officielle de l'URSS (fin 1991), que les Russes se sont vus, dès le
1er février 1992, conviés à une "réforme" aux ambitions colossales mais aux
méthodes mal définies.
Flanqué de conseillers occidentaux désireux
d'expérimenter in vivo les théories apprises à Harvard, et de jeunes économistes
encore sous l'emprise du "volontarisme idéologique" de l'ère soviétique
(l'"économie de marché" en 500 jours, le rouble comme seule monnaie de référence
à compter du 1er juillet, etc.), Boris Eltsine, le premier président élu au
suffrage universel de l'histoire russe, devait relever un formidable défi:
rompre définitivement avec un système soviétique déjà moribond, rassurer
l'Occident quant à ses volontés "démocratiques", et mener une politique
économique antipopulaire sans porter de dommage irrémédiable à sa popularité.
La sanction politique de cette année difficile, chaotique parfois, marquée par
une inflation évaluée à 1600%, a été le référendum du 25 avril, arraché de haute
lutte à un Congrès des députés du peuple (assemblée élargie) héritier de la
légalité soviétique, au terme duquel Boris Nikolaïevitch Eltsine, 62 ans, s'est
vu confirmer la confiance que la majeure partie des Russes lui portaient.
Au printemps 1993, alors que les affrontements tacticiens se multipliaient entre
la présidence et les 1033 membres du Congrès, plusieurs intellectuels russes ont
déploré que B.
Eltsine n'ait pas, dès les lendemains du putsch avorté du 19 août
1991, rompu toutes les amarres avec le passé en convoquant une Constituante, en
dissolvant le Congrès, en jetant, donc, les bases de cette "République fédérale
présidentielle" (à l'allemande) qu'une grande partie des "occidentalistes" - par
opposition aux "slavophiles", mettant l'accent sur la "spécificité" de la
"Russie éternelle" - n'ont cessé d'appeler de leurs voeux.
Si B.
Eltsine ne l'a pas fait, c'est au moins pour deux raisons.
D'abord parce
que sa formation même, sa longue appartenance au Parti communiste d'Union
soviétique (PCUS) et les réflexes manoeuvriers qu'il en avait acquis ne
pouvaient se faire oublier du jour au lendemain.
Ensuite, parce que les forces
sociales qui ont poussé à la liquidation de l'URSS et qui ont commencé de tirer
profit de la difficile transition vers l'économie de marché avaient tout intérêt
à voir perdurer une certaine confusion politique, l'écran de fumée de la "guerre
des pouvoirs", entre exécutif et législatif (voire judiciaire, avec l'entrée en
lice, en 1992, du président de la Cour constitutionnelle, Valery Zorkine)
derrière lequel elles poursuivaient leurs objectifs.
La "nouvelle nouvelle classe"
A la popularité de B.
Eltsine on a pu trouver plusieurs explications: la
détermination dont il avait fait preuve en 1990 et 1991 face à un Mikhaïl
Gorbatchev politiquement bloqué par ses contradictions; ses manières simples et
directes; et aussi son engagement à respecter les libertés publiques dont la
perestroïka gorbatchévienne avait donné un avant-goût.
Mais dans un pays où
l'arbitraire est une solide tradition, cette adhésion populaire n'aurait pas
suffi si des intérêts structurés avaient voulu le départ d'un homme qui, tout au
long de l'année 1992, a souvent paru hésitant, sur la défensive, impuissant à
contrôler un appareil d'État tenté par la corruption et la fronde localiste.
La force la plus visible, ostentatoire même, lorsqu'elle se pavane en luxueuses
voitures d'importation dans une Russie durement touchée par l'inflation, s'est
révélée être celle des "nouveaux riches", puissances financières encore fragiles
en raison des hésitations sur les réglementations commerciales.
Ce sont de
jeunes businessmen dont le credo, comme celui du Parti de la liberté économique
de Konstantin Borovoï, est apparu se résumer à la maxime "Laissez-nous nous
enrichir".
Cette couche sociale s'est retrouvée en contact - parfois
conflictuel, parfois fusionnel - avec l'"économie de l'ombre", la "mafia" aux
multiples facettes qui n'a cessé d'alimenter les chroniques de la presse à
sensation et qui, selon le vice-président Alexandre Routskoï, a étendu son
contrôle à près de 45% du PNB.
La majeure partie de l'ancienne nomenklatura soviétique, cette "couche
parasitaire" s'est, quant à elle, lentement transformée en "nouvelle classe",
mais ne pouvait l'être réellement que si ses privilèges matériels, jusqu'alors
"concédés" par un État surpuissant, se transformaient en réel capital-privilège.
Ainsi 1992 aura été l'année du "recyclage" en capital de l'influence économique
de ce que l'historien Youri Afanassiev a appelé la "nouvelle nouvelle classe",
processus chaotique, difficile, ouvrant des conflits de personnes, de groupes,
de régions entières, mais processus apparu irréversible.
Référendum: une victoire pour Eltsine
La crise politique de l'hiver et du printemps 1993, résumée à l'affrontement
personnel entre B.
Eltsine et le président du Parlement (émanation du Congrès
des députés), Rouslan Khasboulatov, dramatisée par les conseillers du président
jusqu'à un point folklorique - "nouvelle tentative de putsch bolchevik", "retour
des soviets", "pelotons d'exécution en vue pour les réformateurs", etc.
- a donc
pu s'interpréter comme une tentative des deux secteurs de l'appareil d'État de
se gagner les faveurs définitives de cette "nouvelle nouvelle classe".
Entre le
président russe et l'ancien professeur d'économie marxiste d'origine tchétchène
(peuple caucasien de religion musulmane), il n'y avait point de divergences
idéologiques sérieuses, point de projets de société concurrentiels.
Pour
l'appareil présidentiel, il s'agissait surtout, en frisant parfois un
anti-parlementarisme primaire, susceptible d'avoir des conséquences négatives
sur la formation de la conscience civique de la Russie nouvelle, de spéculer sur
l'impopularité évidente de ce Congrès toujours prêt à se draper dans une
Constitution datant de l'ère brejnévienne, et amendée tant de fois qu'elle en
est souvent devenue illisible.
Pour le Congrès et Rouslan Khasboulatov, le but
recherché, et contrecarré par le référendum du 25 avril 1992 - qui a ouvert la
voie à une république présidentielle et à la tenue d'élections législatives
anticipées -, était de faire porter au seul président et à son équipe la
responsabilité des conséquences sociales les plus dures du passage à l'économie
de marché.
Mais le véritable enjeu de ces empoignades rhétoriques a été le
contrôle du processus de privatisation, vecteur essentiel d'une "accumulation
primitive du capital".
Cette crise est aussi venue à point nommé pour pousser les dirigeants
occidentaux à décider d'efforts plus concrets pour aider la Russie à redresser
sa situation économique et financière.
L'aide de 43,5 milliards de dollars
solennellement accordée par le G-7 (Groupe des sept pays les plus
industrialisés), en avril puis en juillet 1992, outre qu'elle a témoigné d'un
assouplissement de la position japonaise, ne pouvait signifier grand-chose si
elle n'aboutissait pas à la satisfaction des deux grandes revendications russes:
un réel transfert de technologie pour secouer le géant industriel ex-soviétique
et l'ouverture des marchés occidentaux aux produits manufacturés venus de
Russie.
L'équipe présidentielle russe a cependant su habilement jouer de la
nerveuse inquiétude trahie par la jeune administration Clinton (entrée en
exercice en janvier 1993) pour obtenir plus que les vagues promesses de 1992.
Le soutien aux réformes en Russie tel que l'avaient, en effet, d'abord conçu le
FMI (Fonds monétaire international) et la Banque....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓