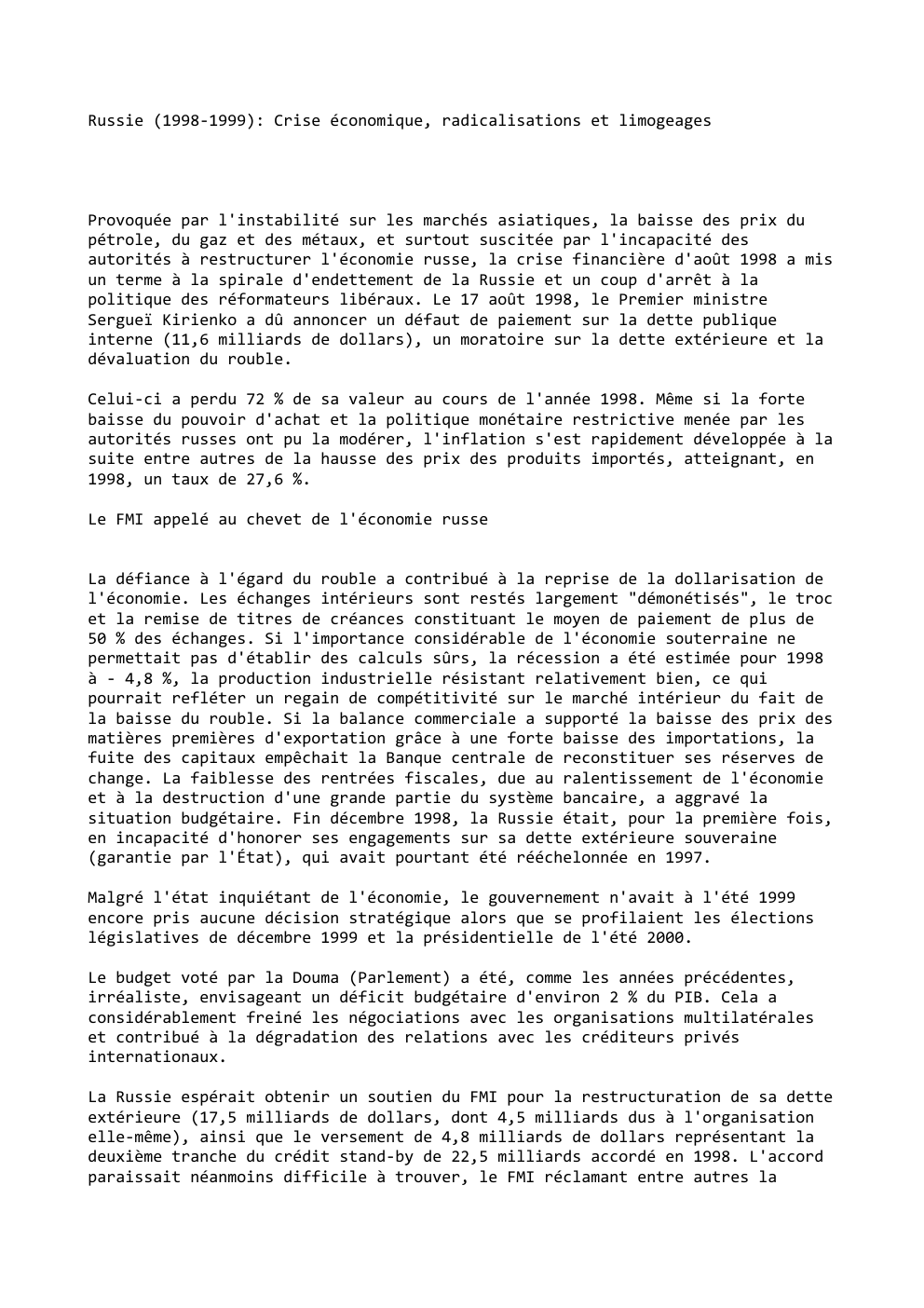Russie (1998-1999): Crise économique, radicalisations et limogeages Provoquée par l'instabilité sur les marchés asiatiques, la baisse des prix du pétrole,...
Extrait du document
«
Russie (1998-1999): Crise économique, radicalisations et limogeages
Provoquée par l'instabilité sur les marchés asiatiques, la baisse des prix du
pétrole, du gaz et des métaux, et surtout suscitée par l'incapacité des
autorités à restructurer l'économie russe, la crise financière d'août 1998 a mis
un terme à la spirale d'endettement de la Russie et un coup d'arrêt à la
politique des réformateurs libéraux.
Le 17 août 1998, le Premier ministre
Sergueï Kirienko a dû annoncer un défaut de paiement sur la dette publique
interne (11,6 milliards de dollars), un moratoire sur la dette extérieure et la
dévaluation du rouble.
Celui-ci a perdu 72 % de sa valeur au cours de l'année 1998.
Même si la forte
baisse du pouvoir d'achat et la politique monétaire restrictive menée par les
autorités russes ont pu la modérer, l'inflation s'est rapidement développée à la
suite entre autres de la hausse des prix des produits importés, atteignant, en
1998, un taux de 27,6 %.
Le FMI appelé au chevet de l'économie russe
La défiance à l'égard du rouble a contribué à la reprise de la dollarisation de
l'économie.
Les échanges intérieurs sont restés largement "démonétisés", le troc
et la remise de titres de créances constituant le moyen de paiement de plus de
50 % des échanges.
Si l'importance considérable de l'économie souterraine ne
permettait pas d'établir des calculs sûrs, la récession a été estimée pour 1998
à - 4,8 %, la production industrielle résistant relativement bien, ce qui
pourrait refléter un regain de compétitivité sur le marché intérieur du fait de
la baisse du rouble.
Si la balance commerciale a supporté la baisse des prix des
matières premières d'exportation grâce à une forte baisse des importations, la
fuite des capitaux empêchait la Banque centrale de reconstituer ses réserves de
change.
La faiblesse des rentrées fiscales, due au ralentissement de l'économie
et à la destruction d'une grande partie du système bancaire, a aggravé la
situation budgétaire.
Fin décembre 1998, la Russie était, pour la première fois,
en incapacité d'honorer ses engagements sur sa dette extérieure souveraine
(garantie par l'État), qui avait pourtant été rééchelonnée en 1997.
Malgré l'état inquiétant de l'économie, le gouvernement n'avait à l'été 1999
encore pris aucune décision stratégique alors que se profilaient les élections
législatives de décembre 1999 et la présidentielle de l'été 2000.
Le budget voté par la Douma (Parlement) a été, comme les années précédentes,
irréaliste, envisageant un déficit budgétaire d'environ 2 % du PIB.
Cela a
considérablement freiné les négociations avec les organisations multilatérales
et contribué à la dégradation des relations avec les créditeurs privés
internationaux.
La Russie espérait obtenir un soutien du FMI pour la restructuration de sa dette
extérieure (17,5 milliards de dollars, dont 4,5 milliards dus à l'organisation
elle-même), ainsi que le versement de 4,8 milliards de dollars représentant la
deuxième tranche du crédit stand-by de 22,5 milliards accordé en 1998.
L'accord
paraissait néanmoins difficile à trouver, le FMI réclamant entre autres la
réduction des dépenses publiques et l'augmentation sensible de la collecte des
impôts.
De plus, des accusations ont circulé sur le détournement de fonds déjà
versés et les Occidentaux se sont montrés réticents face à une Russie instable
où se développent les discours hostiles.
Un accord a néanmoins été conclu le 28
avril 1999, dans le contexte très politique de la crise du Kosovo.
Les grands perdants du krach financier ont été les épargnants et en particulier
la classe moyenne émergente, qui était le principal soutien des réformes.
Ont
moins souffert ceux qui étaient le moins insérés dans l'économie marchande.
Malgré les impayés de salaires et l'appauvrissement de la population, et
contrairement à ce que pouvait laisser croire la manifestation nationale de très
grande envergure d'octobre 1998, la mobilisation sociale est restée très faible,
les Russes préférant dans leur majorité le repli sur soi et les stratégies de
survie individuelles.
Le taux de chômage a pourtant continué à augmenter,
passant de 11,4 % à 14,1 % d'août 1998 à mars 1999, et les salaires réels à
baisser (43 % de juillet 1998 à mars 1999).
Enfin, la situation démographique et
sanitaire s'est largement détériorée.
Au sommet de l'État, toujours le jeu des chaises tournantes
La crise politique qui a suivi la tourmente économique a poussé le président
Boris Eltsine à renvoyer le Premier ministre S.
Kirienko, remplacé, après que la
Douma eut refusé le retour du chef de gouvernement limogé Victor Tchernomyrdine,
par Evgueni Primakov (précédemment ministre des Affaires étrangères) en
septembre 1998.
Celui-ci a formé un gouvernement d'union nationale avec
plusieurs communistes aux postes clés, dont Iouri Maslioukov, ancien patron du
Gosplan soviétique, nommé premier vice-premier ministre en charge du bloc
économique, tout en maintenant certains membres de l'équipe sortante, comme
Mikhaïl Zadornov, ministre des Finances en exercice depuis 1997 et ancien membre
du parti réformiste Iabloko.
Le conservateur Viktor Gerachtchenko, ancien
président de la Banque internationale de Moscou, mais aussi de la Gosbank du
temps de l'URSS, a été nommé à la tête de la Banque centrale.
La faiblesse
physique et politique de B.
Eltsine a provoqué un renforcement du pouvoir du
Premier ministre et créé un nouvel équilibre entre le président et la Douma, de
plus en plus favorable à cette dernière.
Marquée par l'affrontement entre le Parlement et la Présidence, d'une part, et
entre le gouvernement et le Kremlin, d'autre part, l'année a été rythmée par la
multiplication des scandales, des alliances et des limogeages ainsi que des
accusations de corruption aux plus hauts sommets de l'État.
Dans la course aux
élections, chacun paraissait lutter pour garder un statut susceptible de lui
assurer une certaine immunité et des privilèges.
Le 7 décembre 1998, B.
Eltsine a limogé le chef de son administration, Valentin
Ioumachev, ainsi que trois de ses adjoints, et l'a remplacé par Nikolaï
Bourdiouja, secrétaire du Conseil de sécurité, organe consultatif auprès du
président, limogé à son tour fin mars.
Le 4 mars 1999, sans consulter les autres
membres de la CEI (Communauté d'États indépendants), il a renvoyé de son poste
de secrétaire exécutif de l'organisation Boris Berezovski, qui avait vivement
critiqué le gouvernement et qui se trouvait affaibli politiquement.
Au milieu du
bras de fer continuel entre les pouvoirs exécutif et législatif, le procureur
général Iouri Skouratov, proche des communistes et des ultranationalistes,
devenant gênant pour le Kremlin, a été suspendu de ses fonctions par le
président Eltsine, mais le Conseil de la Fédération a refusé par deux fois
d'entériner cette décision.
Dans ce climat de très grande instabilité politique,
la Douma a décidé d'examiner la destitution de B.
Eltsine, lors d'une séance
fixée au 15 avril, puis repoussée au 13 mai.
Les cinq chefs d'accusation pesant
contre lui étaient: génocide contre le peuple russe, dissolution de l'URSS,
effondrement de l'armée et du complexe militaro-industriel, assaut contre le
Parlement en 1993 et guerre en Tchétchénie (1994-1996).
Le limogeage, le 12 mai
1999, d'E.
Primakov, remplacé par Sergueï Stepachine (lui-même remplacé le 9
août suivant par Vladimir Poutine), et l'échec de la procédure de destitution
ont à nouveau modifié l'équilibre politique.
A l'approche des élections législatives, fixées au 19 décembre 1999 et de la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓