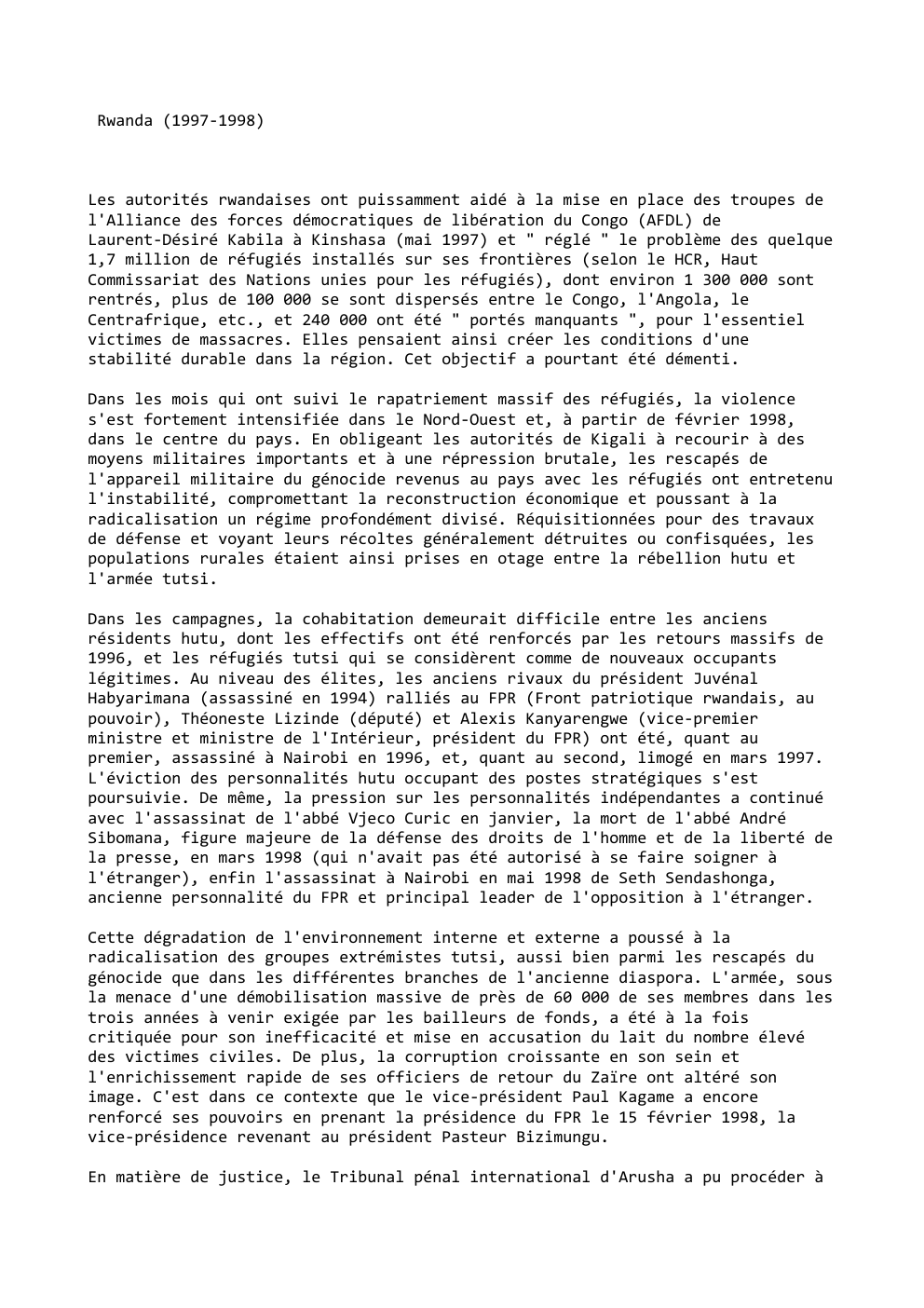Rwanda (1997-1998) Les autorités rwandaises ont puissamment aidé à la mise en place des troupes de l'Alliance des forces démocratiques...
Extrait du document
«
Rwanda (1997-1998)
Les autorités rwandaises ont puissamment aidé à la mise en place des troupes de
l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo (AFDL) de
Laurent-Désiré Kabila à Kinshasa (mai 1997) et " réglé " le problème des quelque
1,7 million de réfugiés installés sur ses frontières (selon le HCR, Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), dont environ 1 300 000 sont
rentrés, plus de 100 000 se sont dispersés entre le Congo, l'Angola, le
Centrafrique, etc., et 240 000 ont été " portés manquants ", pour l'essentiel
victimes de massacres.
Elles pensaient ainsi créer les conditions d'une
stabilité durable dans la région.
Cet objectif a pourtant été démenti.
Dans les mois qui ont suivi le rapatriement massif des réfugiés, la violence
s'est fortement intensifiée dans le Nord-Ouest et, à partir de février 1998,
dans le centre du pays.
En obligeant les autorités de Kigali à recourir à des
moyens militaires importants et à une répression brutale, les rescapés de
l'appareil militaire du génocide revenus au pays avec les réfugiés ont entretenu
l'instabilité, compromettant la reconstruction économique et poussant à la
radicalisation un régime profondément divisé.
Réquisitionnées pour des travaux
de défense et voyant leurs récoltes généralement détruites ou confisquées, les
populations rurales étaient ainsi prises en otage entre la rébellion hutu et
l'armée tutsi.
Dans les campagnes, la cohabitation demeurait difficile entre les anciens
résidents hutu, dont les effectifs ont été renforcés par les retours massifs de
1996, et les réfugiés tutsi qui se considèrent comme de nouveaux occupants
légitimes.
Au niveau des élites, les anciens rivaux du président Juvénal
Habyarimana (assassiné en 1994) ralliés au FPR (Front patriotique rwandais, au
pouvoir), Théoneste Lizinde (député) et Alexis Kanyarengwe (vice-premier
ministre et ministre de l'Intérieur, président du FPR) ont été, quant au
premier, assassiné à Nairobi en 1996, et, quant au second, limogé en mars 1997.
L'éviction des personnalités hutu occupant des postes stratégiques s'est
poursuivie.
De même, la pression sur les personnalités indépendantes a continué
avec l'assassinat de l'abbé Vjeco Curic en janvier, la mort de l'abbé André
Sibomana, figure majeure de la défense des droits de l'homme et de la liberté de
la presse, en mars 1998 (qui n'avait pas été autorisé à se faire soigner à
l'étranger), enfin l'assassinat à Nairobi en mai 1998 de Seth Sendashonga,
ancienne personnalité du FPR et principal leader de l'opposition à l'étranger.
Cette dégradation de l'environnement interne et externe a poussé à la
radicalisation des groupes extrémistes tutsi, aussi bien parmi les rescapés du
génocide que dans les différentes branches de l'ancienne diaspora.
L'armée, sous
la menace d'une démobilisation massive de près de 60 000 de ses membres dans les
trois années à venir exigée par les bailleurs de fonds, a été à la fois
critiquée pour son inefficacité et mise en accusation du lait du nombre élevé
des victimes civiles.
De plus, la corruption croissante en son sein et
l'enrichissement rapide de ses officiers de retour du Zaïre ont altéré son
image.
C'est dans ce contexte que le vice-président Paul Kagame a encore
renforcé ses pouvoirs en prenant la présidence du FPR le 15 février 1998, la
vice-présidence revenant au président Pasteur Bizimungu.
En matière de justice, le Tribunal pénal international d'Arusha a pu procéder à
partir....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓