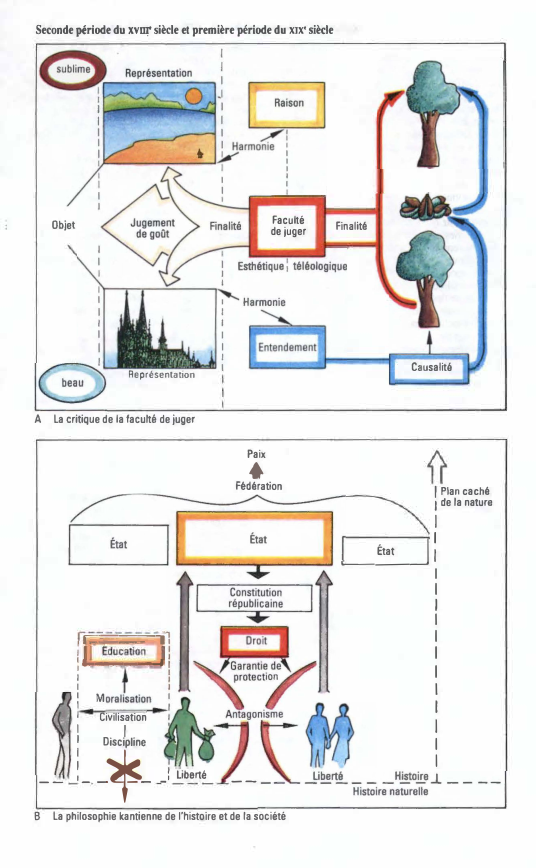Seconde période du XVII!' siècle et première période du XIX' siècle 1 1 ;G 1 1 / • 1 Harmonie...
Extrait du document
«
Seconde période du XVII!' siècle et première période du XIX' siècle
1
1
;G
1
1
/
•
1 Harmonie
y
1
'
:
1
:
1
1
Faculté
de juger
Objet
Finalité
Causalité
Représentation
A
La critique de la faculté de juger
•
Paix
Fédération
1 Plan caché
1 de la nature
1
· --�I ',
_
,r=;::::;;;;::;--'i
1
:a..----""
1
1
1
1
1
M
1
Civilisation
1
Discipline
-- !_ -'f- _I ""'"
B
1
10n
1
:
1
1
1
1
1
1
État
1
--
La philosophie kantienne de l'histoire et de la société
~
1
1
- - Histoire
-reÎÏe J.
- - - Histoire natu
Liberté -
- - -
Idéalisme allemand / Kant : Critique de la faaalti de juger
Avec la Critique de la facultl de juger, KAN!' L'anthropologie de KANT considère l'homme, au
achève en 1790 I' « entreprise attique ".
Dans son contraire de l'animal, comme déterminé non par
analyse de la r� de juger, il s'iolaroge sur la l'instinct mais par la raison.
C'est pourquoi chez
médiation entre la naJure (cf.
p.
137, CRP) et la l'individu l'éducation doit prévenir une possible
liberté (cf.
p.
143, CRPrat).
La farulté de juger est rechute dans 1'état brut, ou état initial de la nais
présentée comme WJ pouvoir situé entre l'entende sance.
L'�ucation doit éclairer, c.-à-d.
non seu
ment et la raison ; et le sentiment de plaisir et déplai lement« dresser,., mais amener l'enfant à penser.
sir, qui lui conespood.
est présenté comme situé Elle se réalise par
entre la faculté de CODrull"tre et celle de �ircr.
« la domestication de la sauvagerie " (disci
De façon gmmlela faculté de juger est la capa
line), l'in.structioo pour l'acquisition de l'babicité de subsumer le parti� sous le gmml.
et la cultuie.
La « faculté de juger rqlichissante », doit per La moralisation, qui doit transmettre une dispo
mettre l'accession au général, le particulier étant sition droite, est fondamentale.
donné.
Son �ipe est la�Une autre différence avec l'animal est l'histoire
Si la finahtécst subjective, il s'agit de la faculté humaine.
C'est dans ce champ qu' appanu"t le per
de juger « esthétique " ; si elle est objective, fectionnement, oblenu grice à la transmission de
KANT parle alors de faculté de juger « tél�lo l'acquis au fil des générations.
C'est par là que la
gique ».
nature accomplit son plan cac�.
qui consiste à
développer toutes ses dispositions dans l'huma
Dans son traitement critique de l'estMtique KANT nité.
Le moteur en est l'antagonisme de la nature
examine le beau et le sublime.
A l'invmcdu beau humaine, son « insociable sociabilité " :
le sublime se rapporte à l'illimité, dont la repré
l'homme aspire à la société et pourtant s'y
sentation est accompagnée de l'idée de totalité.
L'analytique du beau montre qu'wi jugement L'&on d'une société parfaitement juste est
esthétique est, selon les catégories, universel : ce
la « tâcbe la plus haute de la nature pour le genre
jugement demande aux autres de le suivre et il est
humain, parce que la nature ne peut [qu'ainsi)
nécessaire parce qu'il fait appel à un sens qui est
réaliser ses autres vues sur notre espèce "·
commun à tous les hommes.
Dans le jugement Selon la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓