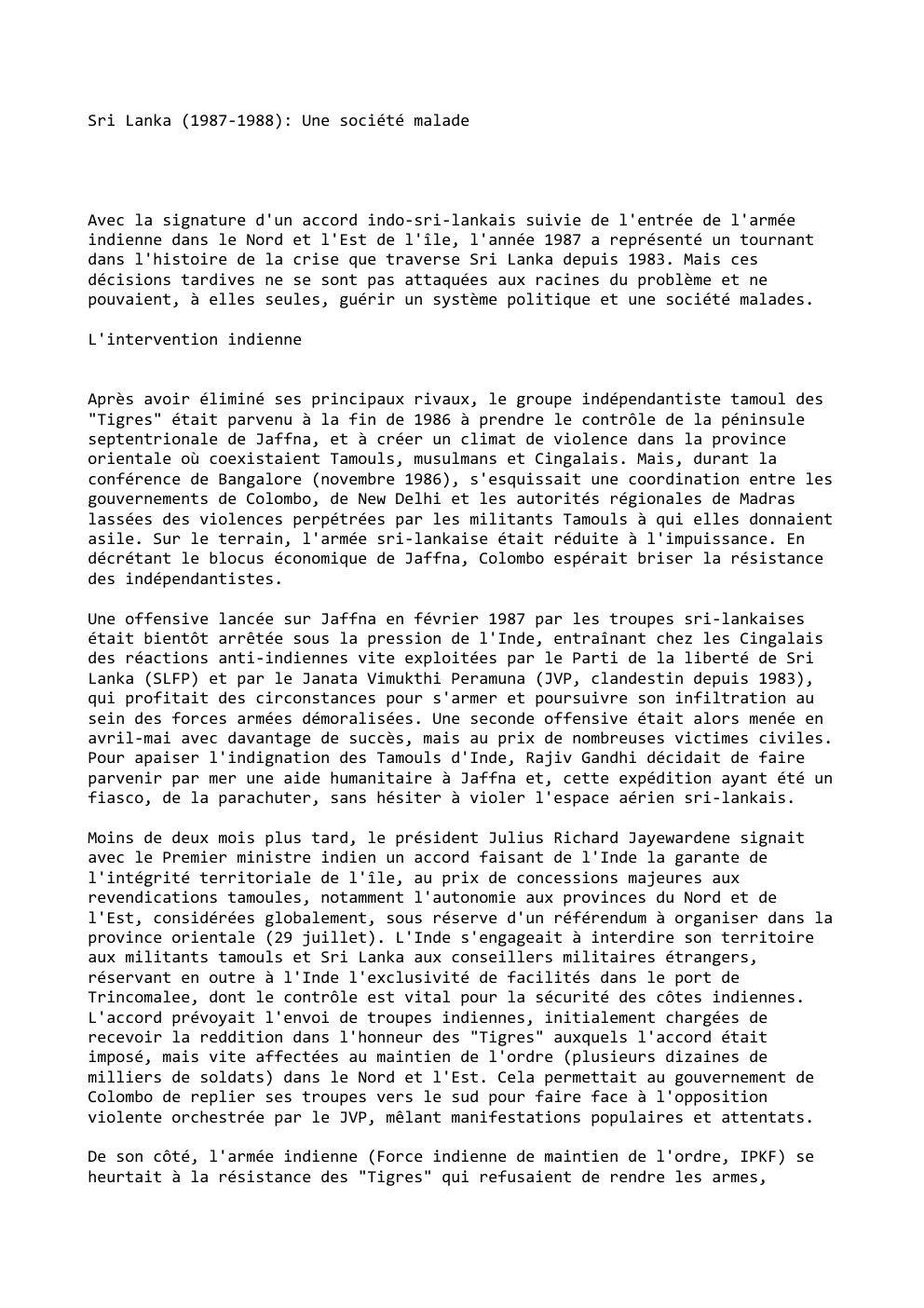Sri Lanka (1987-1988): Une société malade Avec la signature d'un accord indo-sri-lankais suivie de l'entrée de l'armée indienne dans le...
Extrait du document
«
Sri Lanka (1987-1988): Une société malade
Avec la signature d'un accord indo-sri-lankais suivie de l'entrée de l'armée
indienne dans le Nord et l'Est de l'île, l'année 1987 a représenté un tournant
dans l'histoire de la crise que traverse Sri Lanka depuis 1983.
Mais ces
décisions tardives ne se sont pas attaquées aux racines du problème et ne
pouvaient, à elles seules, guérir un système politique et une société malades.
L'intervention indienne
Après avoir éliminé ses principaux rivaux, le groupe indépendantiste tamoul des
"Tigres" était parvenu à la fin de 1986 à prendre le contrôle de la péninsule
septentrionale de Jaffna, et à créer un climat de violence dans la province
orientale où coexistaient Tamouls, musulmans et Cingalais.
Mais, durant la
conférence de Bangalore (novembre 1986), s'esquissait une coordination entre les
gouvernements de Colombo, de New Delhi et les autorités régionales de Madras
lassées des violences perpétrées par les militants Tamouls à qui elles donnaient
asile.
Sur le terrain, l'armée sri-lankaise était réduite à l'impuissance.
En
décrétant le blocus économique de Jaffna, Colombo espérait briser la résistance
des indépendantistes.
Une offensive lancée sur Jaffna en février 1987 par les troupes sri-lankaises
était bientôt arrêtée sous la pression de l'Inde, entraînant chez les Cingalais
des réactions anti-indiennes vite exploitées par le Parti de la liberté de Sri
Lanka (SLFP) et par le Janata Vimukthi Peramuna (JVP, clandestin depuis 1983),
qui profitait des circonstances pour s'armer et poursuivre son infiltration au
sein des forces armées démoralisées.
Une seconde offensive était alors menée en
avril-mai avec davantage de succès, mais au prix de nombreuses victimes civiles.
Pour apaiser l'indignation des Tamouls d'Inde, Rajiv Gandhi décidait de faire
parvenir par mer une aide humanitaire à Jaffna et, cette expédition ayant été un
fiasco, de la parachuter, sans hésiter à violer l'espace aérien sri-lankais.
Moins de deux mois plus tard, le président Julius Richard Jayewardene signait
avec le Premier ministre indien un accord faisant de l'Inde la garante de
l'intégrité territoriale de l'île, au prix de concessions majeures aux
revendications tamoules, notamment l'autonomie aux provinces du Nord et de
l'Est, considérées globalement, sous réserve d'un référendum à organiser dans la
province orientale (29 juillet).
L'Inde s'engageait à interdire son territoire
aux militants tamouls et Sri Lanka aux conseillers militaires étrangers,
réservant en outre à l'Inde l'exclusivité de facilités dans le port de
Trincomalee, dont le contrôle est vital pour la sécurité des côtes indiennes.
L'accord prévoyait l'envoi de troupes indiennes, initialement chargées de
recevoir la reddition dans l'honneur des "Tigres" auxquels l'accord était
imposé, mais vite affectées au maintien de l'ordre (plusieurs dizaines de
milliers de soldats) dans le Nord et l'Est.
Cela permettait au gouvernement de
Colombo de replier ses troupes vers le sud pour faire face à l'opposition
violente orchestrée par le JVP, mêlant manifestations populaires et attentats.
De son côté, l'armée indienne (Force indienne de maintien de l'ordre, IPKF) se
heurtait à la résistance des "Tigres" qui refusaient de rendre les armes,
décimaient leurs rivaux tamouls, massacraient dans l'Est des villageois
musulmans et cingalais, et entretenaient leur prestige par des jeûnes à mort ou
des suicides collectifs.
En octobre, pour échapper à l'enlisement, les troupes
indiennes se lançaient à leur tour dans une offensive contre les "Tigres"
retranchés à Jaffna: elles y perdaient plusieurs centaines d'hommes sans
parvenir à annihiler le noyau dur des militants, mais finissaient par s'emparer
durablement de la péninsule.
Le contrôle de la province orientale, où se trouve
Trincomalee, allait se révéler encore plus malaisé et, au début de 1988, un
climat de violence intercommunautaire y régnait encore, rendant impossible la
tenue des élections prévues par l'accord.
Enfin le décès de M.
G.
Ramachandran,
le chef du gouvernement de Madras, a multiplié les risques d'instabilité au
Tamilnadu indien et réduit la marge de manoeuvre de Rajiv Gandhi.
Le régime en péril
La signature de l'accord et l'installation des troupes indiennes ont représenté
des actes lourds de conséquences....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓