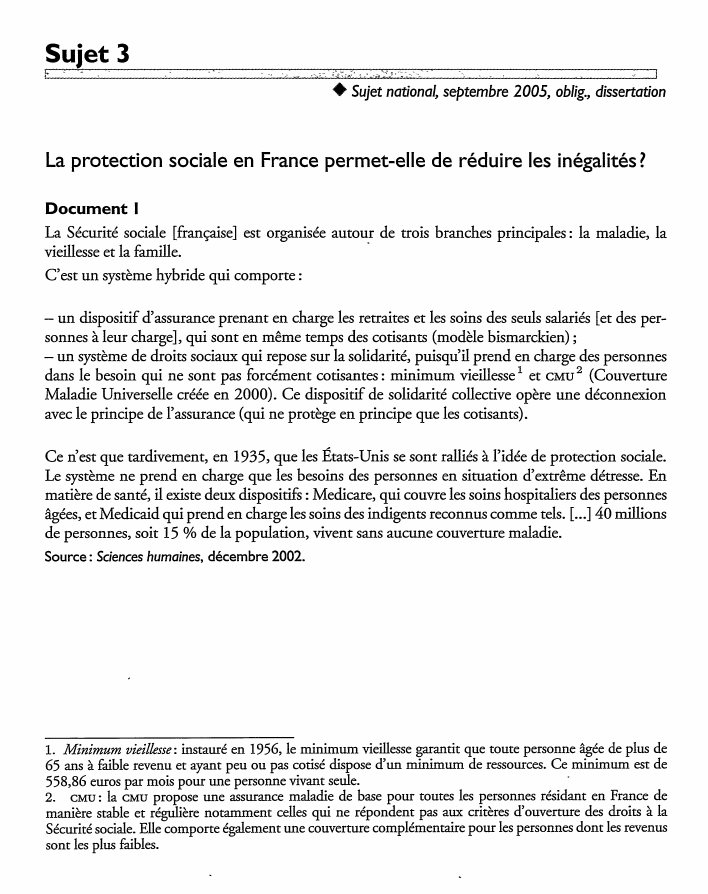Sujet 3 .- ;- ; : ".> ;• •• ' ', ,_ - - ♦ Sujet national, septembre 2005, oblig.,...
Extrait du document
«
Sujet 3
.- ;- ; : ".> ;• •• '
', ,_ - -
♦ Sujet national, septembre
2005, oblig., dissertation
La protection sociale en France permet-elle de réduire les inégalités?
Document 1
La Sécurité sociale [française] est organisée autour de trois branches principales: la maladie, la
vieillesse et la famille.
·
C'est un système hybride qui comporte :
- un dispositif d'assurance prenant en charge les retraites et les soins des seuls salariés [et des personnes à leur charge], qui sont en même temps des cotisants (modèle bismarckien);
- un système de droits sociaux qui repose sur la solidarité, puisqu'il prend en charge des personnes
dans le besoin qui ne sont pas forcément cotisantes : minimum vieillesse 1 et CMU 2 ( Couverture
Maladie Universelle créée en 2000).
Ce dispositif de solidarité collective opère une déconnexion
avec le principe de l'assurance (qui ne protège en principe que les cotisants).
Ce n'est que tardivement, en 1935, que les États-Unis se sont ralliés à l'idée de protection sociale.
Le système ne prend en charge que les besoins des personnes en situation cl' extrême détresse.
En
matière de santé, il existe deux dispositifs : Medicare, qui couvre les soins hospitaliers des personnes
âgées, et Medicaid qui prend en charge les soins des indigents reconnus comme tels.
[...] 40 millions
de personnes, soit 15 % de la population, vivent sans aucune couverture maladie.
Source: Sciences humaines, décembre 2002.
1.
Minimum vieillesse: instauré en 1956, le minimum vieillesse garantit que toute personne âgée de plus de
65 ans à faible revenu et ayant peu ou pas cotisé dispose d'un minimum de ressources.
Ce minimum est de
558,86 euros par mois pour une personne vivant seule.
·
2.
cMU: la CMU propose une assurance maladie de base pour toutes les personnes résidant en France de
manière stable et régulière notamment celles qui ne répondent pas aux critères d'ouverture des droits à la
Sécurité sociale.
Elle comporte également une couverture complémentaire pour les personnes dont les revenus
sont les plus faibles.
Document2
Prestations de protection sociale reçues par les ménages en France
d'euros)
145,4
183,6
Part des
f,restations
en%)
34,8
44,0
Variation
2001/200~
(en%)
5,8
4,1
42,3
10,1
3,6
27,7
12,8
5,7
6,6
3,1
1,4
0,4
3,3
0,4
417,5
100,0
4,3
2001 (en
milliards
Santé
Viellessesurvie
Maternité
famille
Emploi
Lo1reD1ent
Exclusion
sociale (RMI)
Total des
prestations
sociales
Source: d'après
TEF 2003-2004, INSEE.
Document]
En France, la Protection sociale remplit plusieurs fonctions : assurances sociales où chacun reçoit,
plus ou moins, selon ses cotisations (retraite, chômage) ; prestations universelles où chacun reçoit
selon ses besoins (prestations maladie en nature, allocations familiales) ; prestations· de solidarité
(prestations sous conditions de ressources, RMI).
Au total, elle représente 29 % du PIB qui se
répartissent en 50 % de prestations d'assurances, 35 % de prestations universelles et 15 % de
prestations de solidarité.
[...] !;extension des phénomènes d'exclusion a obligé à augmenter le poids
des prestations de solidarité.
Cela reste cependant limité.
Aussi, certains proposent-ils de concentrer la protection sociale sur les plus pauvres, ceci permettant
de les protéger de façon efficace tout en réduisant le poids des prélèvement obligatoires.
[...]
Les dépenses publiques sont financées par des prélèvements progressifs ou proportionnels, dont
une des justifications est que les classes moyennes et aisées profitent plus des dépenses publiques.
Aussi, un système où celles-ci ont droit et bénéficient effectivement des dépenses publiques est plus
satisfaisant du point du vue de la cohésion sociale et de la qualité des dépenses publiques qu'un
système où seuls les pauvres y ont recours.
Source: Réjane Hugounenq, Henri Sterdyniak, >, Lettre de
l'OFCE, septembre 1997, in Problèmes économiques, n° 2554.
Document4
En fait, l'inégalité fondamentale face à la retraite est l'inégalité des espérances de vie: les bas salaires ont en général des espérances de vie sensiblement plus faibles que les hauts salaires, si bien
qu'ils touchent leur retraite pendant une période sensiblement plus courte.
Les études disponibles
prenant en compte l'ensemble du système de retraite français indiquent que pour un franc de
cotisations versées pendant la vie active, les cadres supérieurs touchent pendant leur retraite une
pension totale qui est de 50 % plus élevée que celle touchée par les ouvriers.
Autrement dit, les
retraites opèrent une redistribution à l'envers : en moyenne, une partie importante des cotisations _
des ouvriers finance la retraite des cadres supérieurs.
II faut évidemment prendre en compte qu'un
système par capitalisation privée n'aurait peut être pas permis aux ouvriers d'avoir la moindre retraite, si l'épargne alimentée par les cotisations s'était perdue dans la spéculation et l'imperfection
des marchés.
Source : Thomas Piketty, I.:Économie des inégalités, La Découverte, 2002.
Document S
Tableau synoptique de certains indices d'inégalité entre les catégories socioprofessionnelles
Artisans,
Cadres et
Commerçants
professions
Chefs
d'entreprise
intellecruelles
+
+
++
+
++
+
+
+
-
++
+
+
Effet d'ensemble du
mécanisme redi5tributîf
++
n.d.
--
-
Revenu disporu"ble par
ménage
-
n.d.
++
+
Taux d'érudfanrs à
l'univeisité
-
-
++
+
Espérance de vie à 35 ans •
des hommes
+
+
++
+
Indice de dépenses de
médecin spêclaliste
-
-
++
Agricultems
ex-ploitams
Taux d"emploi stable
Tlll.lX de chômage
Taux d'emploi à temps
partiel
Professions
imennédiaîres
Employés
Ouvriers non
--
----
-
+
qualifiés
supérieures
----- f - - - -
+
--
=
- -- --
..
+
----
---
--
-l+ : position la plus fàvorable; +: position plus fàvorable que la moyenne;=; posirion équiw.Iente à la moyenne; - : position moins
favorable que la moyenne ;- - : position ra moins favorable.
n.-d..= non disponi.hle..
Source : d'après Alain Bihr Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités1 Syros-La Découverte, 1999.
Document6
Pauvreté et transferts sociaux
France
Suède
Pays-Bas
Royaume Uni
Portue:al
Taux de ri~ue de pauvreté 3
avant tran etts sociaux (2000)
(en%)
24
27
21
29
27
Taux de risque de pauvreté après
transfers sociaux (1999) (en %)
15
9
Il
19
21
Dépenses de protection sociale
en % du PIB (2000)
29,7
32,3
27,4
26,8
22,7
Source:
EUROSTAT,
La situation sociale dans l'Union européenne, 2003.
Corrigé
Introduction
Entre l'indispensable réforme et la nécessité de préserver les acquis sociaux, entre le modèle social
français et le malaise révélé par la crise des banlieues fin 2005, la société française est de plus en
plus conduite à s'interroger sur son modèle de protection sociale et à faire le constat de la fragilité
d'une cohésion sociale qui lui semblait pérenne.
Le système de protection sociale français, tel qùil fut institué après la Seconde Guerre mondiale et
développé pendant les Trente Glorieuses, visait en premier lieu à renforcer la cohésion sociale dans
une société en mutation et où le lien social devenait de plus en plus marchand par l'instauration
d'un contrepoids avec l'État-providence.
Dans cette logique, la recherche de légitimité et le sens
même du système conduisaient à la réduction des inégalités sociales de tout type qui frappaient
la société française d'alors, ce qui fut fait dans une large mesure jusqùà la crise.
Depuis les années 1980, la tendance semble s'être inversée, les inégalités paraissent toujours plus nombreuses,
tantôt qualifiées de ou bien encore de .
Face à cette réalité
nouvelle, la question de la capacité du système de protection sociale français à réduire les inégalités se pose de manière très aiguë aujourd'hui et ne manque pas de susciter nombre de débats
sur les indispensables réformes et leur urgence.
Alors, le système de protection sociale français
a-t-il été réellement capable de réduire les inégalités, l'est-il toujours, quelles sont les alternatives
envisageables et les choix que celles-ci imposent?
Nous verrons que si le système de protection sociale français vise bien dans ses objectifs et dans
sa mise en œuvre à la réduction des inégalités, il ri en demeure pas moins que ce système ri a pas
atteint tous ses objectifs, ce qui alimente le débat sur ses limites et les réformes à engager.
3.
Selon la norme statistique européenne, le taux de risque de pauvreté représente le pourcentage de personnes
dont le revenu disponsible est inférieur à 60 % du revenu médian.
1.
Si le système de protection sociale vise bien dans ses objectifs et dans sa mise
en œuvre à la réduction des inégalités...
Nous montrerons que l'objectif qui a dicté la mise en place du système de protection sociale français
visait bien à réduire les inégalités et que dans de nombreux domaines il y est parvenu.
1.
Le système de protection sociale français a été construit pour lutter contre les inégalités
a) Deux modèles de référence
Historiquement, le choix du système de protection sociale à mettre en place s'est fait entre deux
modèles.
D'une part, le modèle mis en place par Bismarck en Allemagne à la fin du XIXe siècle avec
l'instauration de mesures qui ne s'adressaient qu'aux ouvriers de la grande industrie, des mines et
des chemins de fer.
Ce système était fondé sur un principe d'assurance (document 1), puisque les ,
droits des individus à toucher une prestation étaient conditionnés par le versement de cotisations.
:C autre principe était celui de l'obligation d'affiliation, ce qui signifiait pour les ouvriers l'obligation
de cotiser aux organismes sociaux.
D'autre part, le modèle Beveridge au Royaume-Uni en 1942
qui a inspiré le système de protection sociale de nombreux pays et qui proposait dans le rapport
qui porte son nom d'étendre la protection sociale à toute la population.
Dans ce système, les
droits étaient non seulement équivalents quelles que soient les contributions, mais également quels
que soient les risques encourus.
Cela fonde le principe de l'assistance qui désigne les garanties
offertes aux personnes subissant des risques sociaux, même si celles-ci dont pas cotisé ou ont
insuffisamment cotisé.
b) Le système français: le choix d'un compromis
Le principe d'une protection sociale pour tous les citoyens est établi par le préambule de la Constitution de 1958, qui reprend ainsi celle de 1946.
La protection sociale ainsi mise en œuvre par
Pierre Laroque (directeur de la Sécurité sociale de 1944 à 1951) a donc pour objectif de protéger tous les individus face aux risques sociaux.
Dans une première étape, les risques sociaux
couverts (document 2) seront la perte d'emploi, la maladie et les accidents du travail.
Viendront
s'y ajouter le vieillesse, avec la mise en place du système de retraite par répartition et
le famille qui correspond aux charges liées à l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, c'est
le poste qui représente la part la plus importante des prestations sociales avec
44 %, devant les prestations avec 34,8 %.
Les autres postes occupent une part beaucoup
plus modeste, avec respectivement 10,1 % pour les prestations et 6,6 % pour
le poste .
Au total en 2001, les prestations sociales représentaient417,5 milliards d'euros.
Le système français de protection sociale est souvent présenté comme un compromis entre les
deux modèles historiques (document 3).
Le système qui s'est progressivement mis en place est donc
construit pour l'essentiel sur une logique de solidarité collective s'appuyant sur des prélèvements
obligatoires qui sont ensuite redistribués.
Depuis quelques années, le mode de financement de la
protection sociale en France a évolué, on assiste en particulier à la fiscalisation de ses ressources
avec la mise en place de prélèvements tels que la contribution sociale généralisée (csG).
Le principe
de redistribution est double.
On distingue la redistribution horizontale lorsque l'objectif est d'ins-
taurer une solidarité par risque.
Ainsi, les actifs cotisent pour les inactifs, les bien-portants pour les
malades...
On parle de redistribution verticale lorsque sa mise en œuvre vise à réduire les inégalités
à l'issue de la répartition primaire des revenus.
2.
De fait, sa mise en œuvre s'est traduite par le recul de nombreuses inégalités
a) Un objectif, la réduction....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓