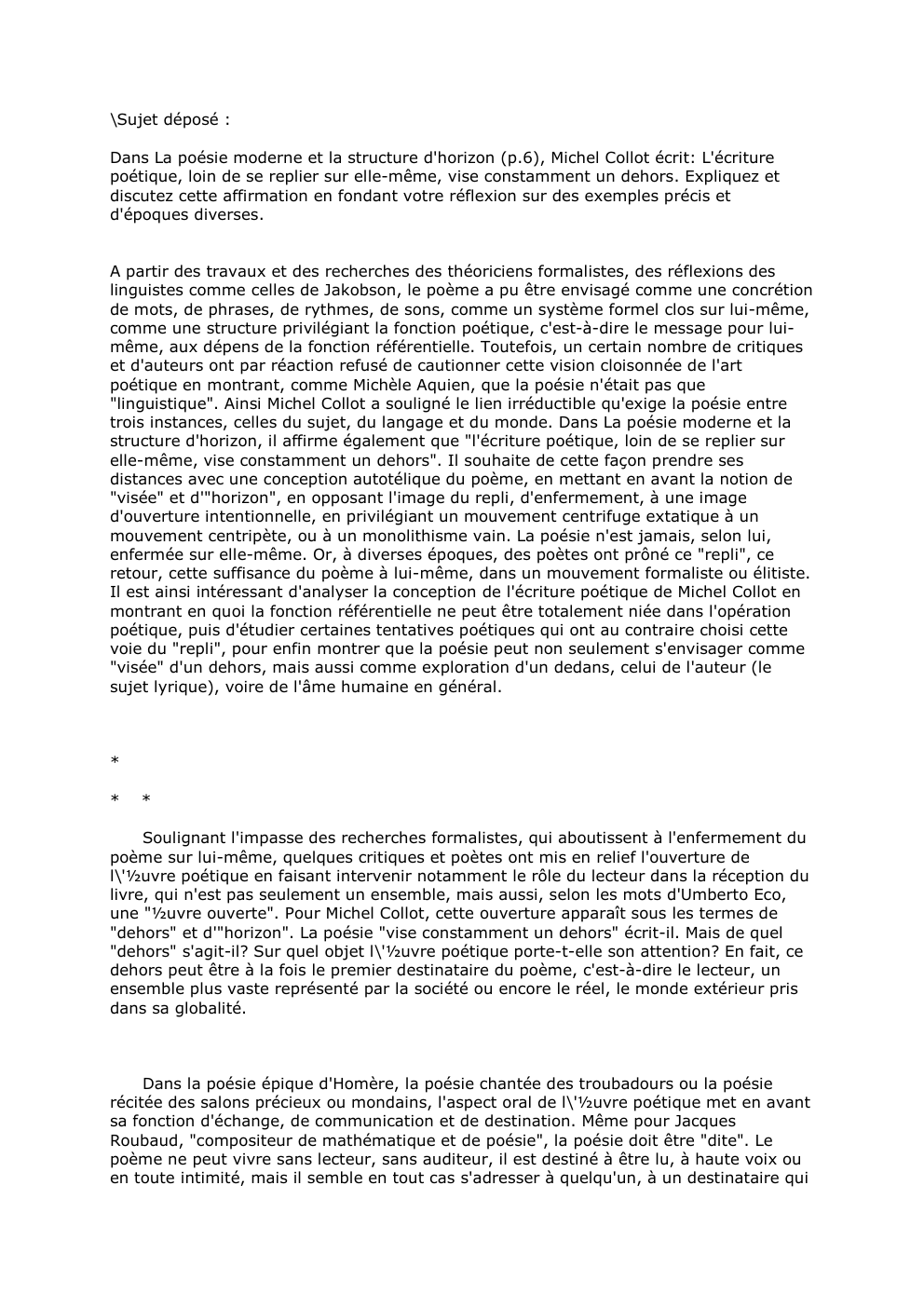\Sujet déposé : Dans La poésie moderne et la structure d'horizon (p.6), Michel Collot écrit: L'écriture poétique, loin de se...
Extrait du document
«
\Sujet déposé :
Dans La poésie moderne et la structure d'horizon (p.6), Michel Collot écrit: L'écriture
poétique, loin de se replier sur elle-même, vise constamment un dehors.
Expliquez et
discutez cette affirmation en fondant votre réflexion sur des exemples précis et
d'époques diverses.
A partir des travaux et des recherches des théoriciens formalistes, des réflexions des
linguistes comme celles de Jakobson, le poème a pu être envisagé comme une concrétion
de mots, de phrases, de rythmes, de sons, comme un système formel clos sur lui-même,
comme une structure privilégiant la fonction poétique, c'est-à-dire le message pour luimême, aux dépens de la fonction référentielle.
Toutefois, un certain nombre de critiques
et d'auteurs ont par réaction refusé de cautionner cette vision cloisonnée de l'art
poétique en montrant, comme Michèle Aquien, que la poésie n'était pas que
"linguistique".
Ainsi Michel Collot a souligné le lien irréductible qu'exige la poésie entre
trois instances, celles du sujet, du langage et du monde.
Dans La poésie moderne et la
structure d'horizon, il affirme également que "l'écriture poétique, loin de se replier sur
elle-même, vise constamment un dehors".
Il souhaite de cette façon prendre ses
distances avec une conception autotélique du poème, en mettant en avant la notion de
"visée" et d'"horizon", en opposant l'image du repli, d'enfermement, à une image
d'ouverture intentionnelle, en privilégiant un mouvement centrifuge extatique à un
mouvement centripète, ou à un monolithisme vain.
La poésie n'est jamais, selon lui,
enfermée sur elle-même.
Or, à diverses époques, des poètes ont prôné ce "repli", ce
retour, cette suffisance du poème à lui-même, dans un mouvement formaliste ou élitiste.
Il est ainsi intéressant d'analyser la conception de l'écriture poétique de Michel Collot en
montrant en quoi la fonction référentielle ne peut être totalement niée dans l'opération
poétique, puis d'étudier certaines tentatives poétiques qui ont au contraire choisi cette
voie du "repli", pour enfin montrer que la poésie peut non seulement s'envisager comme
"visée" d'un dehors, mais aussi comme exploration d'un dedans, celui de l'auteur (le
sujet lyrique), voire de l'âme humaine en général.
*
*
*
Soulignant l'impasse des recherches formalistes, qui aboutissent à l'enfermement du
poème sur lui-même, quelques critiques et poètes ont mis en relief l'ouverture de
l\'½uvre poétique en faisant intervenir notamment le rôle du lecteur dans la réception du
livre, qui n'est pas seulement un ensemble, mais aussi, selon les mots d'Umberto Eco,
une "½uvre ouverte".
Pour Michel Collot, cette ouverture apparaît sous les termes de
"dehors" et d'"horizon".
La poésie "vise constamment un dehors" écrit-il.
Mais de quel
"dehors" s'agit-il? Sur quel objet l\'½uvre poétique porte-t-elle son attention? En fait, ce
dehors peut être à la fois le premier destinataire du poème, c'est-à-dire le lecteur, un
ensemble plus vaste représenté par la société ou encore le réel, le monde extérieur pris
dans sa globalité.
Dans la poésie épique d'Homère, la poésie chantée des troubadours ou la poésie
récitée des salons précieux ou mondains, l'aspect oral de l\'½uvre poétique met en avant
sa fonction d'échange, de communication et de destination.
Même pour Jacques
Roubaud, "compositeur de mathématique et de poésie", la poésie doit être "dite".
Le
poème ne peut vivre sans lecteur, sans auditeur, il est destiné à être lu, à haute voix ou
en toute intimité, mais il semble en tout cas s'adresser à quelqu'un, à un destinataire qui
peut représenter ce "dehors" visé par l'écriture poétique dont parle Michel Collot,
s'apparenter en d'autres termes à la conscience du lecteur.
dans son épitaphe, Villon
s'adresse ainsi aux "Frères humains" de la postérité.
Dans ses sonnets, Ronsard
s'adresse à Hélène ou à Cassandre.
Le poème se veut séduction dans tous les sens du
terme, et notamment dans son sens étymologique et apologétique "se ducere", d'amener
à soi.
La femme désirée est à la fois l'origine du poème et sa "visée".
Dans ses Fables, La
Fontaine s'adresse également plus ou moins directement à des êtres humains, au roi ou
à la cour, à travers ses morales.
La poésie officielle du XVIIème siècle, comme celle de
Malherbe, auteur de "l'Ode à la reine", ou la poésie satirique "vise", évoque ou interpelle
des individus ou des lecteurs en particulier.
Dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire choisit
comme destinataire "l'hypocrite lecteur", son "semblable" et son "frère".
Le poème n'est
pas considéré qu'en lui-même, mais comme une ½uvre qui va être parcourue, comme
des instants qui vont être partagés.
Sartre dira ainsi qu'il n'y a d'art que "pour et par
autrui".
Le lecteur pourrait de cette façon être ce "dehors" visé dès l'écriture poétique,
dès l'élaboration du poème ou du recueil par l'auteur lui-même.
Mais "l'horizon" envisagé par Michel Collot pourrait également s'apparenter à un
ensemble plus vaste, à la société entière.
La poésie engagée semble en effet revendiquer
la transmission d'un message destiné à la civilisation, aux hommes et à leur société.
Elle
se définit comme une action, une force agissante, comme une révolte contre toute forme
de soumission ou d'acquiescement.
Elle "vise" la tyrannie, la barbarie, la discrimination.
Qu'il s'agisse des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné qui "vise" les guerres de religion qui
"afflig[ent]" la France, des Châtiments de Victor Hugo qui "vise" et ridiculise Napoléon
III, de La Diane Française d'Aragon, ou des "Feuillets d'Hypnos" de René Char, les mots
deviennent des armes.
Forger des phrases, c'est alors prendre les armes pour un corpsà-corps textuel, pour une lutte qui "vise constamment un dehors" monstrueux et injuste.
Les poèmes sont des "chants égorgés" selon la formule d'Aragon dans "Elégie à Pablo
Neruda", ou des "voeu[x] en révolte" selon René Char.
Le "dehors" peut s'apparenter au
nazisme, à la guerre, à la torture, à la cruauté du monde extérieur.
La voix poétique, la
"voix qui monte des fers" comme l'écrit Aragon dans "La ballade de celui qui chanta sous
les supplices", s'élève et prend à partie cette insupportable et inadmissible ignominie.
C'est un cri poussé, c'est une insurrection permanente contre l'horreur, mais aussi contre
"les ennuis et les vastes chagrins / qui chargent de leur poids l'existence brumeuse",
nous dit Baudelaire dans "Elévation".
Cependant, la visée poétique peut s'élargir encore davantage et embrasser le monde
entier, le réel pris dans sa diversité et dans sa globalité.
Refusant toute idée de repli,
d'enfermement, toute attitude monolithique, certains poètes ont choisi de tendre vers un
"horizon" terrestre ou céleste, de prendre la route en ne regardant que devant soi.
Ces
poètes nomades, tels que Blaise Cendrars, Apollinaire ou Saint-John Perse privilégient le
mouvement.
En marchant dans Paris, Apollinaire voyage parmi un kaléidoscope de
visages, une foule d'êtres humains.
Il dépasse la "zone", le cercle en parcourant même
les contrées de sa mémoire.
dans la poésie persienne, les figures de conquérants,
parcourant les plaines et franchissant les montagnes dans "Anabase" et dans "Vents",
reflètent la volonté du poète d'embrasser le monde entier, d'aller plus loin et plus haut
pour dépasser ses limites.
L'écriture poétique se veut mouvement, se veut quête
ontologique et cosmique, confirmant la définition de Heidegger de la poésie comme
"topographie de l'Etre".
Ce monde du dehors est parcouru et célébré également par
d'autres poètes au début du XXème siècle, appartenant au mouvement du naturisme,
tels que Francis Jammes ou Saint-Georges de Bouhélier.
Tous ces différents poètes, en
prenant des voies esthétiques et poétiques variées, ont tous en point de mire la nature et
le réel dans sa beauté, dans sa diversité et dans sa simple présence.
La poésie
deviendrait alors un mouvement extatique, une tentative d'approche et de conquête de
ce monde extérieur, ou comme l'écrit Adonis dans Autre Sud, l'écriture d'un "isthme"
entre le monde et le poète.
L'opération poétique, en célébrant l'univers ou en le transformant, par une alchimie
verbale ou par l'imagination, garderait ainsi le dehors comme l'objet premier de son
attention et de son projet esthétique.
Par conséquent, la place de la fonction référentielle
tendrait à confirmer l'approche de Michel Collot de la poésie, non comme repli, mais
comme ouverture sur un horizon qu'il soit "fabuleux" ou réel.
*
*
*
Pourtant, le refus de l'engagement politique ou de l'épanchement, la volonté de
restreindre le public récepteur, ont engendré chez certains poètes un mouvement de
repli.
Ces tentatives apparaissent à des dates diverses, la conception formaliste de "l'art
pour l'art", la recherche de l'hermétisme et l'élaboration du poème comme système
autotélique peuvent être ainsi perçues comme des attitudes de "repli" sur l'objet poétique
pris pour lui-même.
Tout d'abord, dans une perspective différente, les Grands Rhétoriqueurs qui
privilégient le travail sur la matière verbale, l'ingéniosité, l'inventivité, et les précieux qui
concourent pour faire les plus beaux poèmes, pour rechercher la perfection formelle,
l'harmonie verbale, ont manifesté la volonté de mettre l'accent non sur le dehors, mais
sur le verbe poétique.
Au XIXème siècle, rejetant l'épanchement du romantisme
sentimental, Théophile Gautier prépare lui aussi un retour au formalisme de "l'art pour
l'art".
Dans Emaux et camées, il demande au poète de "sculpte[r]", de "lime[r]", de
"cisele[r]".
Il faut que celui-ci taille dans un "marbre sans défaut".
Les courts poèmes
deviennent des bijoux d'orfèvre.
On retrouve cette même approche dans les ½uvres de
Théodore de Banville, qui remet en valeur les règles prosodiques dans Petit traité de
versification française.
Les poètes Parnassiens comme Leconte de Lisle, Sully Prudhomme
ou Hérédia, refusant de traiter l'actualité politique ou d'étaler les souffrances et les affres
de leur monde intérieur, privilégient la forme, et se coupent du "dehors" contemporain.
Hérédia se perfectionne dans l'art du sonnet dans Les Trophées, et travaille notamment
le dernier vers dans un souci de beauté formelle.
Ainsi, dans "Soleil couchant": "Et le
soleil couchant[...] / Ferme ses branches d'or de son rouge éventail".
Théodore Banville,
le jongleur verbal de L'Ode funambulesque, a également mis en avant l'intérêt et la
valeur de la rime, ce que Verlaine rejettera au bénéfice de l'assonance.
Ce souci de
perfection verbale et esthétique, cette recherche de la beauté pour elle-même, est ainsi
une expérience poétique qui s'apparente à une attitude de repli.
La recherche de l'hermétisme, de l'obscurité et de l'élitisme en matière de poésie est
une autre démarche....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓